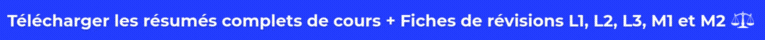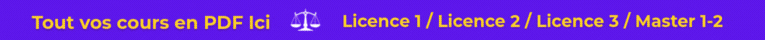Maîtrisez l’AUA 2017 : convention d’arbitrage, constitution du tribunal, procédure arbitrale, recours contre la sentence et exequatur. Le guide ultime de l’arbitrage OHADA.
Chers avocats d’affaires, investisseurs internationaux et chefs d’entreprise, bienvenue sur sagessejuridique.com. Aujourd’hui, nous décortiquons la loi qui vous permet de choisir votre juge et votre procédure : l’Acte Uniforme relatif au Droit de l’Arbitrage (AUA), révisé en 2017.
Cet Acte Uniforme est le reflet d’une modernité juridique essentielle. Dans l’espace OHADA, le règlement des différends par voie judiciaire peut être long et complexe. L’arbitrage offre une alternative basée sur la rapidité, la confidentialité et l’expertise des juges choisis. L’AUA 2017 remplace la version de 1999 et consolide le régime de l’arbitrage ad hoc et institutionnel.
Si vous êtes venu pour télécharger l’Acte Uniforme Droit de l’Arbitrage OHADA en PDF, le lien est disponible ci-dessous. Mais pour quiconque signe un contrat d’investissement en Afrique de l’Ouest ou Centrale, la compréhension des 36 articles de ce texte est vitale. L’arbitrage n’est pas qu’une clause de fin de contrat ; c’est un instrument de sécurité juridique qui garantit l’exécution de vos droits.
I. Champ d’Application et Principes Fondamentaux (Chapitre 1)
L’AUA 2017 s’applique à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans l’un des États Parties de l’OHADA (Art. 1er).
1. L’Arbitrabilité et l’Exception d’Ordre Public (Art. 2)
L’AUA maintient un principe d’arbitrabilité très large : « Toute personne physique ou morale peut recourir à l’arbitrage sur les droits dont elle a la libre disposition. »
- Personnes Publiques : Le texte est clair. Les États, les autres collectivités publiques territoriales et les établissements publics peuvent également recourir à l’arbitrage. Cette disposition est essentielle, car elle garantit que les contrats entre un État et un investisseur étranger peuvent être soumis à l’arbitrage sans contrainte juridique majeure.
- Exclusions : L’arbitrage est exclu pour les questions qui touchent à l’ordre public interne de l’État et pour lesquelles la loi n’autorise pas la libre disposition (exemples : statut personnel, droit pénal, certaines procédures collectives).
2. La Distinction Cruciale : AUA vs Règlement CCJA
Il est crucial de ne pas confondre l’AUA et le Règlement d’Arbitrage de la CCJA :
- AUA (Acte Uniforme) : C’est la loi de l’arbitrage. Il s’applique obligatoirement à tout arbitrage (ad hoc ou institutionnel) si le siège est dans un État OHADA. Il régit la validité de la convention, la procédure de nullité de la sentence et l’exequatur (force exécutoire).
- Règlement CCJA : C’est le règlement de procédure de l’arbitrage institutionnel organisé par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA). Il ne s’applique que si les parties l’ont expressément choisi ou si elles ont opté pour la CCJA.
L’AUA est la norme suprême du droit de l’arbitrage en OHADA.
II. La Convention d’Arbitrage : Le Consentement à la Justice Privée (Chapitre 2)
L’arbitrage est un processus consensuel, et le point de départ est la convention d’arbitrage.
1. Forme et Indépendance (Art. 3 et 4)
- Forme : La convention d’arbitrage doit être constatée par un écrit (y compris tout support électronique ou communication qui la matérialise). Cette exigence garantit la certitude du consentement.
- Autonomie (Principe de Séparabilité) : L’AUA consacre explicitement le principe de l’autonomie de la clause d’arbitrage. L’invalidité du contrat principal (par exemple, un contrat de vente jugé nul) n’entraîne pas automatiquement l’invalidité de la clause d’arbitrage. La clause survit pour permettre au tribunal arbitral de statuer sur la validité du contrat lui-même (principe de Kompetenz-Kompetenz).
2. La Clause Compromissoire et le Compromis (Art. 3)
La convention d’arbitrage prend deux formes :
- La Clause Compromissoire : Elle est insérée dans le contrat principal et prévoit que les litiges futurs (non encore nés) découlant du contrat seront soumis à l’arbitrage. C’est la forme la plus courante.
- Le Compromis : Il est conclu après la naissance du litige et porte sur un différend précis et déjà identifié.
III. Le Tribunal Arbitral et la Procédure (Chapitres 3 et 4)
L’AUA établit les règles pour la constitution du tribunal et le déroulement de la procédure, laissant une grande liberté aux parties.
1. Constitution du Tribunal Arbitral (Art. 5 et 6)
- Liberté des Parties : Les parties sont libres de convenir du nombre d’arbitres (qui doit être impair, sauf si les parties choisissent un nombre pair, ce qui impose alors la désignation d’un arbitre supplémentaire) et de la méthode de désignation.
- Rôle du Juge d’Appui (Le Juge Étatique) : Si les parties n’arrivent pas à désigner les arbitres (par exemple, le défendeur refuse de nommer son arbitre), la partie la plus diligente peut saisir le juge étatique d’appui (le Président de la juridiction compétente). L’intervention du juge étatique est ici limitée à la constitution du tribunal pour débloquer la situation, sans se prononcer sur le fond du litige.
- Récusation : Un arbitre peut être récusé s’il existe des circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance. La demande de récusation est tranchée, en l’absence de convention contraire, par le juge d’appui.
2. La Procédure Arbitrale (Art. 13 à 26)
Le principe est celui de l’autonomie procédurale : les parties sont libres de déterminer les règles de procédure. À défaut, l’arbitre les détermine lui-même. Cependant, trois principes sont impérativement respectés :
- Principe du Contradictoire : Chaque partie a le droit de présenter sa cause et de répondre aux arguments de l’adversaire. Les parties doivent être traitées sur un pied d’égalité.
- Lieu de l’Arbitrage : Le tribunal est libre de se réunir où il le souhaite, mais le siège de l’arbitrage (fixé par les parties ou les arbitres) détermine l’application de l’AUA et la juridiction compétente pour les recours en annulation.
- Droit Applicable au Fond : Les parties choisissent librement les règles de droit que le tribunal doit appliquer. À défaut de choix, l’arbitre applique la loi désignée par les règles de conflit qu’il juge appropriées. Nouveauté de 2017 : L’arbitre peut également statuer en qualité d’amiable compositeur si les parties lui en ont donné l’autorisation expresse.
IV. La Sentence Arbitrale : Nature et Recours (Chapitres 5 et 6)
La sentence arbitrale est l’acte par lequel le tribunal arbitral tranche le litige.
1. Forme et Effets de la Sentence (Art. 27 et 28)
- Forme : La sentence doit être rendue par écrit, motivée (sauf si les parties ont convenu du contraire), et signée par les arbitres.
- Effet de la Chose Jugée : Dès son prononcé, la sentence possède l’autorité de la chose jugée (Art. 28) à l’égard des parties. Elle s’impose à elles.
2. L’Exequatur : Rendre la Sentence Exécutoire (Art. 30)
Pour être exécutée de force par la puissance publique (par exemple, par un huissier), la sentence doit être revêtue de l’exequatur (force exécutoire).
- Procédure : La partie la plus diligente dépose l’original de la sentence et la convention d’arbitrage auprès du juge d’appui (le Président de la juridiction compétente dans l’État où l’exécution est demandée).
- Rôle du Juge : Le juge étatique a un rôle limité. Il vérifie uniquement si la sentence est conforme aux critères manifestes de l’ordre public international de l’OHADA. Il ne peut pas réexaminer le fond du litige.
3. Le Recours en Annulation : Le Seul Recours Possible (Art. 33)
L’AUA est fondamental : le seul recours contre la sentence arbitrale est le recours en annulation, porté devant le juge d’appui de l’État du siège de l’arbitrage.
Le juge ne peut annuler la sentence que pour des motifs strictement limités :
- Nullité de la Convention d’Arbitrage (ex: incapacité d’une partie).
- Irrégularité du Tribunal Arbitral (ex: composition illégale, arbitre non indépendant).
- Irrégularité de la Procédure (ex: violation du contradictoire).
- Excès de Pouvoir (le tribunal a statué au-delà de sa mission).
- Violation de l’Ordre Public International de l’OHADA (ex: sentence sur une matière non arbitrable).
Si l’un de ces motifs est avéré, le juge prononce l’annulation. À défaut, la sentence est maintenue.
V. Le Contrôle de la CCJA : La Garantie de l’Uniformité
Bien que l’AUA régisse l’arbitrage ad hoc (non institutionnel), la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) joue un rôle indirect, mais stratégique :
- Juge de Cassation du Recours en Annulation : Une décision du juge étatique qui statue sur le recours en annulation d’une sentence peut être elle-même soumise à un pourvoi en cassation devant la CCJA. Ce mécanisme assure l’uniformité de la jurisprudence sur les motifs d’annulation dans l’ensemble de l’espace OHADA.
- Arbitrage Institutionnel CCJA : Pour l’arbitrage institutionnel mené sous son Règlement, la CCJA est directement l’autorité de gestion et c’est son Règlement qui s’applique, avec l’AUA comme loi de base. La CCJA elle-même est l’autorité d’exequatur de ses propres sentences.
Conclusion : La Clé de la Confiance des Affaires
L’Acte Uniforme relatif au Droit de l’Arbitrage (AUA 2017) est une pièce maîtresse de la législation de l’OHADA. En proposant un droit de l’arbitrage moderne, flexible et aligné sur les standards internationaux (notamment la Loi-Type CNUDCI), l’OHADA s’est dotée d’un instrument de confiance pour attirer et sécuriser les investissements étrangers.
Pour les professionnels, l’AUA représente la garantie que l’issue de leurs litiges ne dépendra pas uniquement des systèmes judiciaires nationaux, mais d’une justice privée et efficace, soumise à un contrôle de légalité harmonisé par la CCJA. L’enjeu est stratégique : l’arbitrage est souvent la solution la plus rapide et la plus sûre pour protéger les actifs et les intérêts commerciaux.