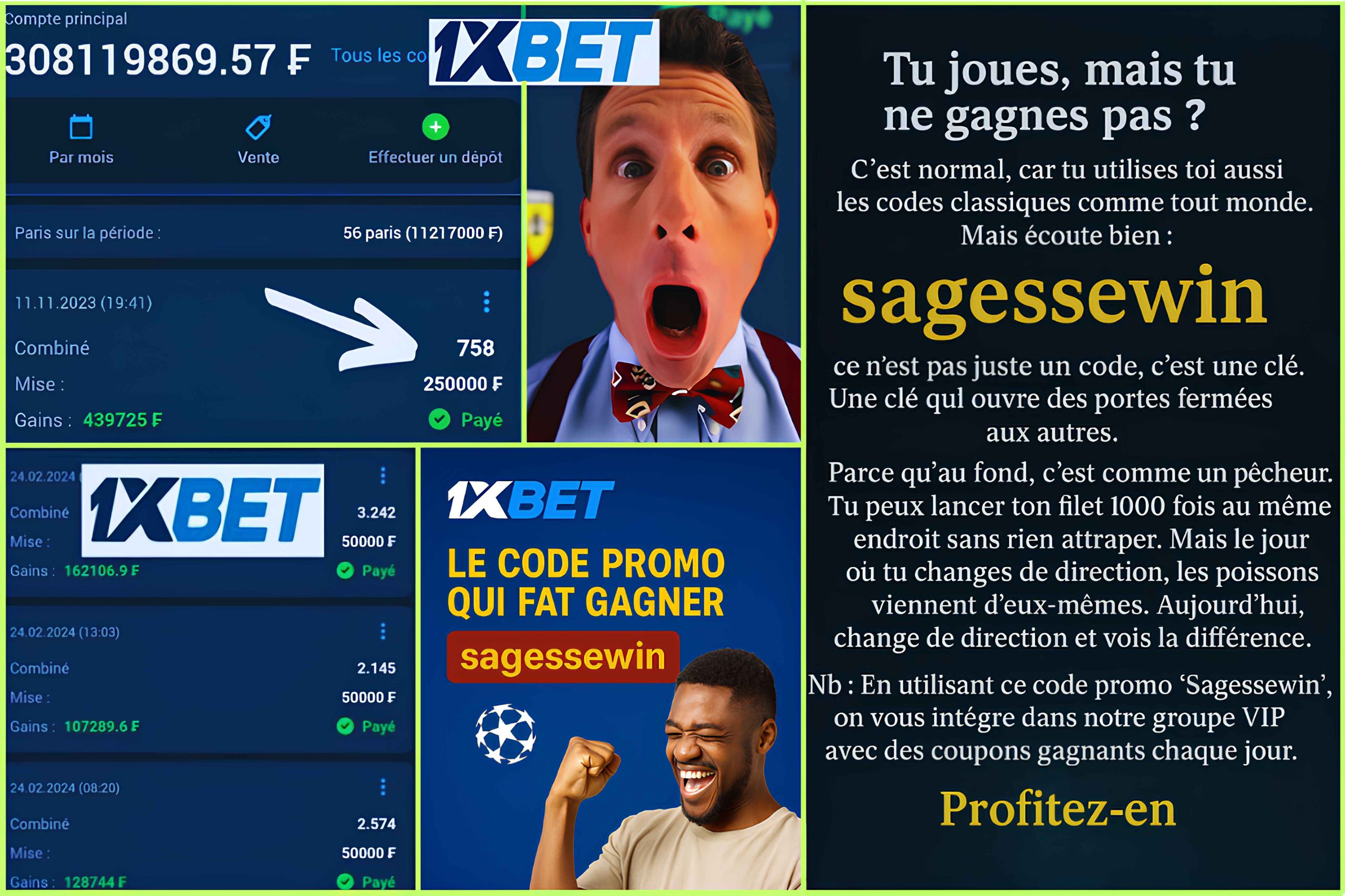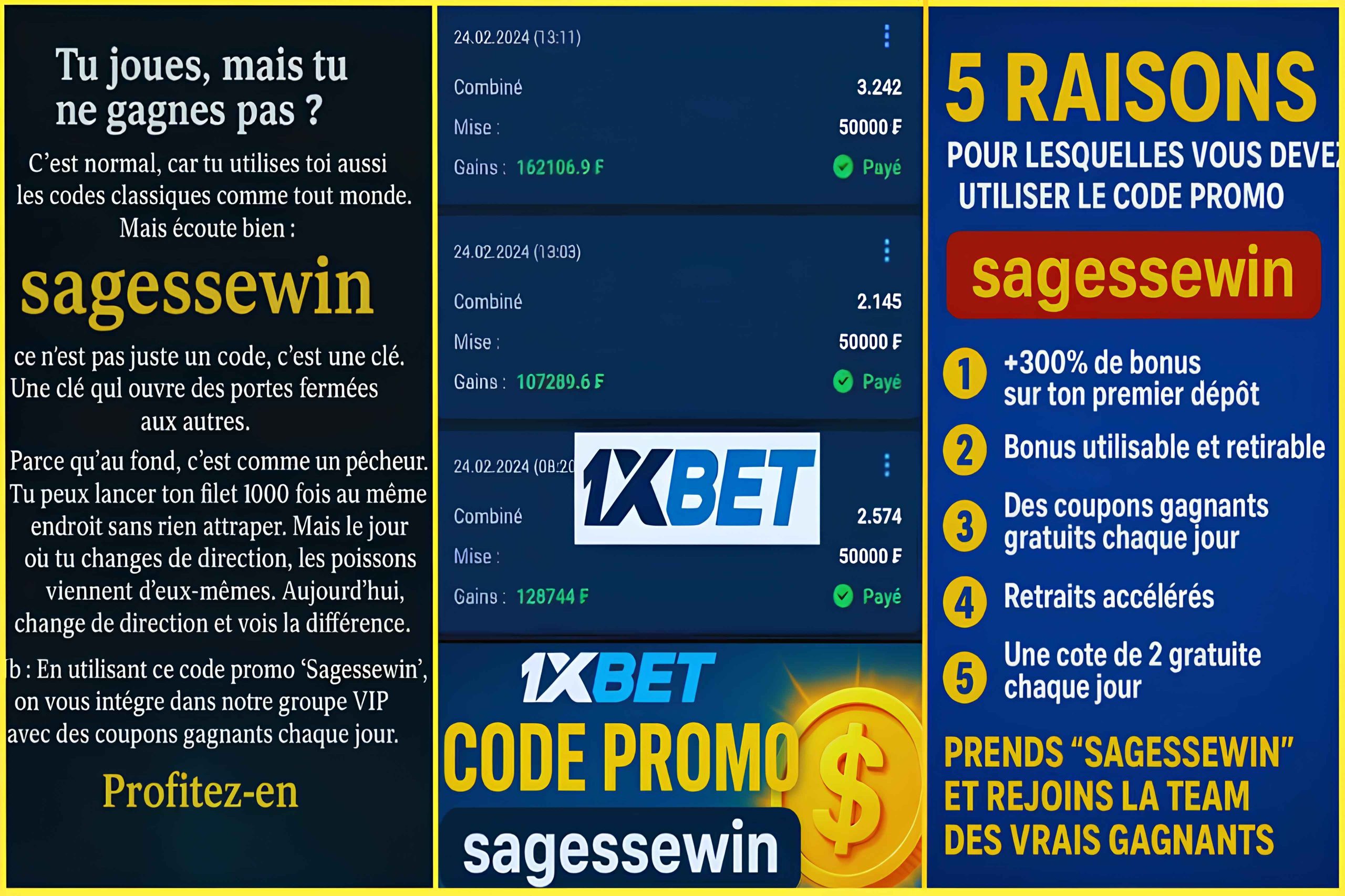Cours droit foncier rural en PDF Complet : notions clés, régimes juridiques et principes essentiels pour étudiants et praticiens du droit.
INTRODUCTION
Selon Elias Olowale « la terre appartient à une grande famille dont beaucoup de membres sont morts, quelques uns vivants et dont le plus nombre est à naître ». La terre occupe et a toujours occupé une place de choix dans les questions qui se posent avec acuité dans notre pays. Pris sous l’angle d’un adjectif, il est appréhendé comme « le foncier ». C’est en substance tout ce qui se rattache à la terre, au sous-sol et tout ce qui se réalise au-dessus. Le terme foncier est issu de l’ancien français fonds, dérivé à l’aide du suffixe ier au sens de « relatif à un fonds de terre », puis de fonds + suffixe – ier au sens de « relatif au fond de la nature de quelque chose, de quelqu’un ». Le foncier, nous l’avons dit est relatif à un fonds de terre, à sa propriété, à son exploitation et à son imposition. Lorsqu’en 1850, débute la colonisation française en Afrique, il s’agissait aussi sans doute de la culture des terres en vue de leur rentabilité.
Plus tard avec les États indépendants, ce sont les mêmes intérêts économiques qui ont guidé les nouveaux États africains en général mais l’État ivoirien en particulier. Selon Houphouët Boigny, la Côte d’Ivoire n’a pas de terres à répartir mais à mettre en valeur. Car la terre appartient à celui qui la met en valeur. Depuis cette célèbre phrase, l’agriculture est devenue le fer de lance de l’économie ivoirienne au point où elle occupe environ les 2/3 de la population active soit plus de 26% du produit intérieur brut. C’est sans doute ce qui a favorisé dans les années 70, le miracle ivoirien. Avec une forte pression sur l’agriculture.
Selon des estimations, la forêt ivoirienne est passée de 16 millions d’hectares à 12 millions d’hectares puis à 3 millions d’hectares. Dans ce contexte, il convient d’agir urgemment pour préserver le patrimoine forestier objet de fortes pressions voire de conflits. Car selon Dumont A. « qui achète une terre, achète un procès ou une guerre ».
En effet, l’administration coloniale et bien plus tard, l’État moderne, ont mis en marge les modes traditionnels de gestion de la terre au profit d’une appropriation privative des terres. Cette façon de faire et de voir à conduire à la foire aux conflits fonciers.
I- Le problème du foncier
Les civilisations négro-africaines sont étroitement liées à la terre. Elles sont pour la quasi-totalité, des civilisations agraires[1]. Leur rapport avec la terre est de type particulier car l’essentiel de leur être et de leur revenu y est fonction.
Or force est de constater que l’accès à la terre est en passe de devenir l’un des problèmes les plus difficiles à gérer et à organiser de manière durable[2].
En effet, du Zimbabwe au Rwanda jusque dans les régions forestières de la Côte d’Ivoire et de la Sierra Leone, l’insécurité foncière, l’accès précaire aux terres de culture sont aujourd’hui entre autres, les principaux problèmes sur lesquels butent les chercheurs et décideurs africains en quête de solutions viables et fiables.
Au Liberia, selon un rapport de NRC, la commission foncière établie en 2009, soumise au parlement, un projet de loi sur les cessions illégales des terres pour régler les conflits fonciers entre les réfugiés rapatriés de leurs voisins [3]. Toutefois, une augmentation des conflits fonciers non liés à la guerre a été constatée. La majorité de ces conflits découle de la faiblesse des lois foncières.
Au Mali de petits paysans tentent de récupérer, par la voie judiciaire, les terres qu’ils ont perdues au profit de gros investisseurs privés.
A Madagascar, le Collectif tany a publié ses propositions pour une nouvelle politique de gestion des terres malgaches après les considérations préalables dont les points essentiels ont été : « L’arrêt des accaparements de terres, qui se manifeste par la vente de terres aux étrangers, par le bail emphytéotique, ou par l’attribution de concession et le respect des intérêts et droits fondamentaux des communautés locales »[4].
Cet état des lieux a conduit David N. Houedeingar[5] à dire que l’accès à la terre étant une question vitale pour les sociétés, les différents groupes sociaux définissent des règles écrites ou non pour préciser l’usage, le partage et la transmission de ce bien « sacré »[6], objet de contestations, de palabres et de conflits[7].
Les enjeux de l’accès équitable à la terre sont liés au fait que cette ressource constitue l’un des substrats essentiels des activités productives en milieu rural notamment pour les familles africaines qui sont des peuples agraires. L’aggravation de la crise qui affecte les zones arides et semi-arides et l’instauration d’une insécurité alimentaire généralisée s’accompagne de l’exacerbation des conflits liés à l’accès à la terre et/ou au contrôle des ressources naturelles.
Autour de toutes ces questions, aujourd’hui sources de nombreux problèmes, l’on pourrait évoquer toutes les tensions et conflits qui existent entre différents groupes d’acteurs qui revendiquent les mêmes droits sur une ressource commune (terres de culture, zones de parcours ou de pêche etc. qui doivent être appréhendés comme la résultante d’un accès non équitable à la ressource… »
Face aux enjeux de la rivalité économique, sociale, politique et environnementale, l’importance du foncier pour les familles en tant que source de conflits, n’est pas toujours correctement perçu. Or les conflits fonciers, signale Oussoubi Touré, sont devenus une donnée constante dans de nombreux pays d’Afrique subsaharienne confrontés au processus de paupérisation accrue des lignages qui rendent encore plus complexe la gestion équitable des ressources naturelles. A l’en croire, Ils revêtent une acuité particulière dans les zones frontalières des pays voisins et à l’intérieur de chaque pays, autour des lignes de partage entre différents groupes ethniques obligés de cohabiter dans un même espace de vie. Ailleurs, des terres agricoles sont aménagées aux prix d’importants investissements ; ceux qui ont fait le travail ne veulent pas en être dépossédés par d’autres.
L’évocation de ces différentes situations fait apparaître clairement que si l’on ne trouve pas de solutions raisonnables et réalistes, ces questions vont continuer à empoisonner l’existence de la société africaine[8].
En effet, les mutations de la famille tout comme les règles d’accès à la terre et de gestion des ressources renouvelables sont au cœur des questions de développement agricole, de gestion durable des écosystèmes et de sécurité alimentaire[9].
En Côte d’Ivoire en particulier, la question de la terre laisse apparaître que la loi foncière[10] est difficilement appliquée et applicable. Mais aussi qu’il y’a une vente accrue et une compétition rude acteurs entre intervenant dans le domaine foncier. Occasionnant une insécurité foncière. Cette insécurité peut contribuer à court terme, à réduire les investissements dans la terre et à moyen terme, à la dégradation des ressources. Pour autant, les acteurs ne restent pas inactifs, et de nouvelles règles mobilisant les pouvoirs locaux et les représentants de l’État émergent parfois, avec une efficacité variables[11].
En effet, depuis plusieurs années, la question foncière est au cœur des débats12. L’accès aux ressources est un processus dynamique et évolutif : tous les acteurs s’adaptent en permanence à un contexte qui évolue, ils se réfèrent en même temps et de façon changeante aux diverses règles, aux divers pouvoirs et sources de légitimité qui peuvent être utiles dans leur stratégie. Les acteurs du foncier sont en même temps dans le système foncier coutumier (qui est lui-même une réalité changeante), dans le système moderne (même si le droit des textes légaux n’est souvent pas appliqué) et dans le changement »[12].
Ces débats portent également sur la promotion systématique de la propriété individuelle de la terre et des ressources. Mais aussi sur la reconnaissance aux « communautés » locales en occurrence les familles, d’une autonomie dans la gestion des terres et des ressources, et le type de « communauté » dont il s’agit alors de promouvoir. Enfin la résolution ou du moins la réduction du divorce entre légitimité, légalité et pratiques qui caractérisent aujourd’hui la question foncière en Afrique. Le foncier matérialise et signifie, à la fois, la vie, la condition de la reproduction des lignages14. C’est par l’agriculture que chaque famille peut se nourrir et vendre pour obtenir les revenus monétaires nécessaires aux besoins de la vie quotidienne[13]. Cette reproduction est menacée par la rareté des terres arables, la mauvaise qualité des sols, l’inexistence d’une agriculture familiale inégale des terres.
Le manque de terre pour les membres de la famille, ou sa mauvaise répartition par ceux qui en ont la gestion, entraîne une incertitude quant aux possibilités de se nourrir et d’obtenir un revenu monétaire suffisant. Elle est aussi menacée par la maladie qui empêche une personne du lignage, une unité d’énergie disponible, de travailler la terre au moment opportun.
Le principal défi dans le cadre de l’examen des principes qui régissent le système foncier ici en Côte d’Ivoire, consiste à démêler les différents écheveaux, c’est-à-dire à clarifier les interrelations souvent subtiles entre intérêts collectifs et intérêts individuels, notamment en ce qui concerne la terre agricole. À ce niveau, on doit faire remarquer que le système foncier coutumier commande qu’on distingue clairement trois aspects différents de cette même question : l’aspect dit Possession, l’aspect dit Administration et l’aspect dit exploration ou jouissance. Parmi les différents aspects du droit foncier coutumier qui viennent d’être évoqués deux se démarquent clairement et constituent les causes profondes des tensions qu’on observe depuis que la terre a commencé à revêtir une valeur monétaire en région. Il s’agit des aspects ‘Possession’ et « Exploitation ». On retiendra d’ores et déjà que pour ce qui est de la possession, elle est traditionnellement considérée comme un droit détenu par la communauté familiale et ou villageoise tout entière. En des termes plus simples, on dira que la terre appartient au chef de famille dans ce sens qu’il exerce sur elle un contrôle nominal. Quant à l’exploitation, elle correspond au droit accordé à chaque membre de la communauté qui peut ainsi satisfaire ses besoins existentiels. Ce droit très concret est traditionnellement garanti quand deux conditions essentielles sont remplies : le membre bénéficiaire occupe réellement la parcelle mise en disposition, d’une part, et se montre respectueux de la loi coutumière et des décisions de l’autorité traditionnelle, d’autre part. Traditionnellement, la « propriété coutumière foncière » est essentiellement collective, inaliénable et imprescriptible.[14]
Mais cette appropriation collective donc familiale, n’empêche pas que des droits d’usage soient accordés sur la terre aux membres de la collectivité familiale et éventuellement aux étrangers qui en font la demande selon les règles coutumières qu’ils s’engagent à respecter.
En droit moderne, la propriété foncière est essentiellement individuelle. Elle s’acquière par la procédure de l’immatriculation.
Deux régimes fonciers continuent de nos jours à coexister en Côte d’Ivoire : le régime coutumier et le régime moderne. Leurs actions qui revêtent deux formes sont soit directes, soient indirectes.
De façon directe, à partir des années 1990, des réformes sont intervenues en Côte d’Ivoire comme au Burkina Faso et au Mali, et visent l’organisation du peuplement et l’affectation des terres, le contrôle et l’intégration des migrants, les rapports entre pouvoirs locaux et pouvoirs politiques. Ces réponses répondaient aux soucis de promouvoir le développement agricole auquel le système coutumier de gestion et d’utilisation de la terre constituait un frein. Le but était « d’organiser une meilleure répartition et une plus judicieuse utilisation de la terre »[15]. Par le biais de cette législation, la Côte d’Ivoire entendait affirmer sa volonté d’intervenir dans l’accès à la terre : en effet, il pouvait selon les dispositions de ces réformes agir directement en attribuant à des paysans qui en font la demande des terres dites incultes préalablement récupérées[16].
Quant à l’action indirecte, elle réside en ce que l’État a influé sur la transmission du foncier (aussi bien en milieu rural qu’urbain). Il intervient dans l’acquisition des droits sur la terre à travers l’organisation de la propriété foncière. C’est ainsi que des procédures de constatation et d’enregistrement de droits fonciers, d’immatriculation des termes datant de la période précédant l’indépendance ont été maintenues.
L’enjeu de cette politique est d’arriver par le contrôle de l’accès à la terre à mettre à la disposition de ceux qui peuvent effectivement la mettre en valeur et à leur accorder toutes les garanties qu’il faut sur cette terre pour les inciter à s’y installer et à y investir.
Aujourd’hui, plus d’un demi-siècle après son indépendance, et vu de l’escalade de la violence autour du foncier, l’on est en droit de se demander si les moyens que s’est donnés la Côte d’ivoire, lui ont permis de réaliser ses ambitions en termes de gestion de la terre ?
II- Approche définitionnelle
Mot ayant plusieurs sens, « la terre » peut être définie comme la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse croissante. Il s’agit dans ce cas de la plus grande et la plus massive des quatre planètes telluriques, les trois autres étant Mercure, Vénus et Mars. La Terre se trouve ainsi dans la zone habitable du Système solaire. Elle est couramment appelée en français Terre, planète Terre, planète bleue ou encore Monde. Elle a pour particularité d’être le seul endroit de l’univers connu pour abriter la vie, et accessoirement l’espèce humaine. Les cultures humaines ont développé de nombreuses représentations de la planète, dont une personnification en tant que déité, la croyance en une terre plate, la Terre en tant que centre de l’univers et la perspective moderne d’un monde en tant que système global nécessitant une gestion raisonnable. La terre est selon nous une richesse et une source de richesses.
Pour les africains, la terre revêt une importance toute particulière. Cette importance capitale de la terre dans les croyances traditionnelles africaines, présente la terre comme un bien sacré. Selon El Hadji Mohamed Diop (1983), la terre constitue un trait d’union entre le monde des vivants et celui des morts. Pour lui, la terre constitue un lien entre les hommes, elle donne lieu à des rapports sociaux de production, qui sont liés à la fois à la gestion des espaces sacrés et à l’organisation sociale.
Les conceptions religieuses des individus ne sont pas plus éloignées des principes qui structurent le droit de la terre. En effet, la tradition africaine considère la terre, comme une entité cosmobiologique. Ce lien qui unit l’homme à la terre est à l’image de celui qui dépend de l’enfant à ses géniteurs biologiques. Dans une conception avoisinante, la terre mère est conçue comme une personne morale, un génie avec lequel le conducteur du peuple a conclu une alliance pour l’usage et l’exploitation du sol.
En tant qu’enjeu social lié à la reproduction du groupe, la terre assure à l’homme ses moyens de subsistance. Son utilisation est indispensable pour survivre. L’accès à la terre est donc par principe ouvert à tous et chacun un droit potentiel d’exploitation. Ceci explique d’une part que le droit de jouissance de la terre constitue un attribut de la personne et non pas un droit réel ; cela justifie d’autre part le fait que ce droit s’exprime dans le cadre d’une communauté lignagère.
L’individu isolé n’a pas d’existence juridique car il ne correspond à aucune réalité sociale. Ce n’est qu’en tant que membre d’une communauté qu’il est considéré : « tout homme est ainsi le sujet potentiel d’un droit d’exploitation de la terre, mais cette potentialité n’accède à la réalité qu’à travers l’existence de cette communauté ». L’individu ne s’affirme qu’au sein de la communauté, support des droits portant sur la terre. La terre représente un enjeu pour la société dont la reproduction dépend, de telle sorte que le droit d’exploitation de l’individu sur le sol dépend du groupe auquel il appartient. L’homme s’y attache donc de génération en génération, ce qu’affirmait un chef nigérien en 1912 devant le « West African Lands Committee » : « la terre appartiendrait à une grande famille dont beaucoup de membres sont morts, quelques-uns sont vivants, et dont le plus grand nombre est encore à naître ».
Cette parentalisation de la terre caractérise fondamentalement la société traditionnelle qui organise son alliance avec la terre en territorialisant la parenté à travers un chef de terre. Mais le sol ne peut être considéré sous l’angle uniquement agraire, dans la mesure où les activités halieutiques cynégétiques et pastorales donnent également lieu à des rapports fonciers dans lesquels les communautés familiales et villageoises gèrent des ressources naturelles renouvelables. Elles sont inféodées par une « territorialisation » à travers le maître de pâturage, le maître des eaux, le maître de chasse, le chef ou conseil de village et le chef de lignage.
La terre, en tant que fonds, entretient un lien avec l’invisible qui lui confère un caractère d’espace cosmogonique sur lequel repose la communauté lignagère ou villageoise (passée, présente et future). Ainsi, le rapport à l’invisible interdit toute considération matérielle du fonds, support des ressources renouvelables (terre, pâturages, pêcheries…) et de surcroit constitutif de l’élément de survie des hommes. L’espace-ressource n’est donc pas un bien.
On ne peut ainsi les assimiler à des choses communes quoique n’étant pas des biens, choses par ailleurs fongibles et parfois consommables (l’air, l’eau) et de plus limité à un usage d’effet souvent insignifiant sur la substance même de la chose (tel que le prélèvement de l’eau de mer, la respiration de l’air…). On notera aussi que les « res communis »[17], qualifiant un contenant, sont d’accès libre à tous et ne sont pas communs à un groupe particulier autre que l’humanité.
Dans le cadre de notre étude nous verrons la terre en tant que foncier. Le terme foncier (anciennement fonsier) est issu de l’ancien français fonds, dérivé à l’aide du suffixe -ier au sens de « relatif à un fonds de terre », puis de fond, fonds + suffixe -ier au sens de « relatif au fond de la nature de quelque chose, de quelqu’un ». Le mot français fond (anciennement fons, fonds) remonte au gallo-roman FUNDU, du latin fundus, -i « fond de quelque chose (récipient, mer, pays, organe du corps, etc.) ; limite, point extrême ; partie essentielle de quelque chose ; fonds de terre » ; en droit « garant d’une chose »
Concernant le foncier, on peut retenir principalement deux critères de définitions : le foncier est constitué à la fois par la terre et les ressources naturelles qui y sont directement attachés et l’ensemble des relations entre individus, groupes pour l’appropriation et l’utilisation de ces ressources.
Ces relations englobaient à la fois des règles et des principes de la maitrise, d’appropriation et d’usage de la terre ainsi que les contextes institutionnels et relationnels qui déterminent la mise en œuvre de ces principes. On devrait donc parler dans cette optique de foncier agricole, de foncier pastoral, de foncier pour l’habitat, et d’un foncier halieutique…
Le concept de foncier définit le rapport de l’homme a son environnement par rapport à un système d’interrelation entre, d’une part, les sphères de l’action sociale, individuelle et collective (l’organisation sociale, politique, le sacré, le religieux) et, d’autre part, les dynamiques écologiques20.
Le « Foncier » ayant valeur d’adjectif, le mot désigne ce qui est « relatif à un fonds de terre, à son exploitation, à son imposition ». D’où les notions de : Propriétaire foncier, propriété foncière, Taxe foncière. La propriété foncière, souvent confondue avec la propriété terrienne, est un type de propriété qui concerne les biens immobiliers.
La notion de bien foncier, très voisine de la notion de bien immobilier, ne doit pas cependant être confondue avec elle. Dans le langage de la promotion immobilière, le foncier désigne généralement le terrain qui sert de support à une construction immobilière. Il reste que l’adjectif « foncier », dans l’usage courant, désigne « un bien relatif à la propriété non-bâtie mais aussi à la propriété bâtie ».
Ainsi, dans cette acception, les immeubles, constructions et autres bâtiments sont réputés aussi être des biens « fonciers ». Avec des variations selon le contexte et la législation et la loi du marché (autrement dit, la loi de l’offre et de la demande), le sol prend une certaine valeur (ou en perd), ce qui génère ou entretient un « marché foncier ». Ce marché est généralement défini pour un territoire particulier, ou de manière générale comme l’ensemble des ventes échanges ou mises en vente de terrains, qu’elles soient faites dans le but d’exploiter les sols (ou sous-sol) qui ne sont pas homogènes, des biens immobiliers ou sans volonté de les exploiter (par exemple pour protéger la nappe ou protéger la nature (ex : cas d’un parc national ou d’une réserve naturelle). Ce marché se traduit par la formation d’un prix, qui peut évoluer dans l’espace et dans le temps. La valeur foncière d’un terrain varie selon l’utilisation envisagée ou permise (agricole, minière, touristique, urbanisation, protection de la nature, etc. En tant que ressource surfacique support d’activités humaines : Sur une « planète finie » où la population augmente rapidement, le foncier apparait comme une ressource finie, non-renouvelable (en tant que surface au sol, mais la construction en étage ou sous le sol permet, dans la ville dense par exemple de mieux « valoriser » et exploiter le mètre carré au sol), et susceptible d’être dégradé par la pollution ou la dégradation des sols et d’alors perdre de la valeur (pour le foncier agricole et forestier en particulier, mais aussi pour le foncier urbain en cas de fortes pollutions).
III- La représentation traditionnelle de la terre
Dans les sociétés caractérisées par l’animisme et le communautarisme, comme les sociétés traditionnelles composant la Côte d’Ivoire ante coloniale, la représentation de l’espace est topo-centrique. Le rapport des groupes à l’espace est organisé en fonction d’endroits autour desquels leurs activités sont centrées. C’est à partir de ces endroits que les membres des différents groupes exercent un contrôle sur l’usage ou la gestion des sols. Ce contrôle est fonction de leur ordre d’arrivée et du type d’activité qu’ils exercent. Chaque activité implique une maitrise particulière de cet espace. Les activités et les usages sont idéalement pensées comme complémentaires et interdépendants.
La terre, pour ces groupes, est le réceptacle des activités de la campagne, de la vie paysanne, cynégétique et revêt chez peuples des caractères ontologiques. D’ailleurs, dans toutes les civilisations de la planète, la terre a toujours fonctionné dans 1es mentalités collectives à la fois comme le connecteur du sacré si ce n’est le sacré lui-même et la sève nourricière des vivants et des choses avec lesquelles le matériel et l’immatériel ont des relations d’existence. C’est pourquoi, la terre conjuguant la réalité matérielle et immatérielle ne peut s’appréhender qu’à travers une double démarche : la démarche liée au sacré et celle liée à la réalité matérielle.
C’est cette dualité de la terre qui explique que sa surface et sa profondeur sont considérées comme des lieux où se rencontrent à la fois le sacré et la réalité matérielle. Voilà pourquoi la surface de la terre sur laquelle vivent les êtres, les choses se divisent en domaine du sacré et en domaine réservé aux vivants. Ainsi, sans que l’homme n’intervienne pour prendre contact avec la terre, il a toujours présenté à l’esprit la coexistence de ce double domaine : le domaine du sacré et le domaine des vivants.
La terre et tout ce qui le peuple rappelle constamment la dualité d’existence.
En effet, pour les communautés traditionnelles, la terre (non pas la planète appartenant au système solaire -) est la richesse des richesses. L’on vit de la terre et l’on vivra dans la terre. Elle est le commencement de toute vie et en même temps la fin de toute vie. Cette dualité est telle que, pour ces communautés quiconque perd la terre, perd la double existence.
La terre est incrustée dans la conscience des hommes, elle est le modèle, modèle leur « création » et leur vie.
La terre, en effet, était pour ces populations, non pas une chose à s’approprier, mais un « être » auquel on demandait le strict minimum pour la survie du groupe, et qui inspirait un profond respect. D’où le fait qu’elle était déifiée. Comment pouvait-il en être autrement ? C’est elle qui préside aux naissances et partant, perpétue le groupe.
Elle est la puissance fécondante. C’est encore elle qui entretient la vie des hommes par la nourriture qu’elle produit, la végétation qu’elle porte, les animaux qu’elle anime. C’est aussi sur elle que tous les hommes se meuvent, prennent leurs appuis pour s’épanouir, se développer comme l’oiseau s’appuie sur la branche de l’arbre pour voler. Ainsi, la terre est-elle perçue comme élément nourricier, une divinité, la clé du développement et plus fondamentalement de la survie. Elle est aussi source de noblesse. Et comme nous l’avons noté, le rapport à la terre, avant d’être un mode de subsistance, est une manière d’être et de vivre, un mode de penser et d’agir ; elle est source de vie. Elle est enfin, l’habitacle des défunts, des ancêtres, et partant, elle est intermédiaire entre les morts et les vivants.
Cette question est épineuse et essentielle. En effet, l’on vit de la terre et l’on vivra dans la terre. C’est donc le commencement de toute vie et en même temps la fin de toute vie[18].
A- La naissance des droits fonciers traditionnels
Les droits fonciers traditionnels naissent par un acte a fondateur : la prise de contact effectuée par le chef de terre.
1- La prise de contact
La prise de contact a lieu par la première occupation qui se réalise elle-même par un défrichement et/ou par un parcours de territoire vierge.
Le défrichement qui lie l’homme à la terre se réalise par la culture, le droit de feu pour préparer l’installation du village, du marché ou la création de nouvelles plantations.
Pour ce qui est du parcours de territoire vierge ; on notera : que c’est à partir du lieu d’installation du village, que les chasseurs qui, dans les expéditions, reconnaissent les environs et marquant des arbres sur leur passage pour retrouver leur chemin, ébauchent en même temps un domaine.
Le « droit d’accès » des individus à la terre est étroitement subordonné à leur position au sein de leur communauté respective. Dans les relations entre individus de communautés différentes les liens qui unissent ces groupes entre eux, commanderont encore les rapports fonciers.
L’appartenance au groupe. Le droit d’exploiter une terre découle originellement de l’appartenance à un groupe de parenté localisée. Il faut, par ailleurs, avoir la capacité juridique au sens du droit traditionnel, c’est-à-dire être un homme. Les femmes peuvent également cultiver sur les terres en jachère pour y planter des condiments (piment, aubergine etc.) de leur choix dans un but alimentaire et/ou commercial.
Il peut arriver que des personnes n’appartenant pas à la communauté se soient vues attribuer des terres à usage individuel : ce sont les alliés et les étrangers.
L’allié. L’alliance est réalisée le plus souvent soit par le mariage soit à partir d’un pacte entre communautés auparavant en relation conflictuelle. Le pacte peut se réaliser par le sang versé des représentants des parties en présence ou par un sacrifice rituel à la frontière des deux communautés. L’allié est intégré au groupe fondateur (lignage primitif) comme membre à part entière et peut donc se voir attribuer une parcelle de terre de ce dernier.
L’étranger est l’individu qui n’est pas membre de l’un des lignages primitifs du village. Il ne peut y exercer des droits d’exploitation que s’il est autorisé par les autorités compétentes à y résider. Cette autorisation est presque toujours accordée ; elle est gratuite car, dit-on, « on n’est jamais trop nombreux sur une terre ».
L’acte qui crée le droit du groupe sur une terre est posé par le chef de terre.
2- Le chef de terre
Le chef de terre est celui ou le descendant de celui qui s’est installé le premier sur la terre et autour duquel les autres sont venus s’installer. Le chef de terre est avant tout, celui qui est partie au pacte avec le sol, c’est-à-dire l’homme de l’alliance primordiale avec les forces telluriques et les esprits fertiliseurs du sol. Et comme le culte de la terre se transmet par succession dans la même famille, le chef de terre, aujourd’hui, est le descendant mâle par ordre de primo progéniture – du premier occupant qui noua avec la terre une alliance éternelle, sacrée.
Descendant du premier occupant, le chef de terre sacrifie à la terre du village et invoque les ancêtres. Il est soumis à plusieurs obligations et protégé par de nombreux interdits. Homme d’autorité, homme de paix, le chef de terre veille à la concorde et à la justice dans la communauté : par sa présence, il fait cesser une querelle ; par sa parole, il réconcilie les adversaires ; par des sacrifices, il répare les fautes qui menacent la terre de stérilité.
Lorsqu’un conflit éclate entre des agriculteurs au sujet des limites d’un champ, le collège des anciens intervient pour régler les problèmes des hommes installés sur les terres. Mais, un tel conflit pourra apparaître également comme un outrage fait à la terre. Pour à la fois réparer l’outrage et entériner la résolution du conflit, l’intervention du chef de terre est nécessaire.
Dans l’exercice de ses fonctions, il désigne les terres à cultiver par les étrangers et alliés ou accueillera dans le village de nouveaux arrivants. Mais, il n’exerce pas ce droit en vertu de son titre chef de terre, mais en tant que porte-parole de son groupe car il remplit aussi la fonction de chef de village ([19]).
3- Les effets de la prise de contact
L’espace découvert devient l’espace territorial, la zone de juridiction des lignages primitifs, c’est-à-dire, l’espace sur lequel ils assurent la réglementation des activités de toutes sortes et exercent la plénitude de leur souveraineté. C’est le lieu où l’autorité politique s’exerce effectivement. Ainsi, les lignages primitifs « possèdent » une surface de sol sur laquelle ils peuvent tout à la fois imposer leur propre puissance et repousser l’intervention de toute puissance étrangère.
Sur leur territoire, les lignages primitifs exercent une puissance, c’est le pouvoir politique. Ce pouvoir a la charge d’assurer l’ordre et la sécurité, de construire et de maintenir l’unité du groupe. Ce pouvoir, une fois le rituel de prise de contact effectué, n’est soumis à aucun autre pouvoir, ni dans l’ordre interne ni dans l’ordre externe. »
B- Les caractères de la terre en droit traditionnel
Pour ce qu’elle inspire aux hommes, la terre en droit traditionnel est grevée du principe de l’inaliénabilité.
1- Le principe de l’inaliénabilité
La signification du principe. La terre est inaliénable. Elle ne peut faire l’objet d’appropriations privatives. Elle est le support de subsistance et de reproduction de la communauté qui développe, par la même occasion, un esprit de prévision car « l’on sera certainement plus nombreux demain ».
Le sol attribué dans un village à une famille est sa « propriété », entendue comme un droit sans doute plus fort que celui du code civil parce qu’il réside précisément dans la collectivité qui ne disparaît jamais. De plus, suivant le concept de l’ordre social négro-africain, la présente génération a des obligations envers le passé et le futur. Et l’attachement au sol est une preuve de l’attachement aux ancêtres dont les esprits veillent sur le groupe. Ainsi, vendre la terre, c’est renier ses ancêtres, c’est être un parricide, c’est se priver de protection et refuser la prospérité. Être sans terre, c’est être un esclave, coupé de tout lien, c’est être un apatride ; pire, c’est perdre sa condition humaine. Car, si les oiseaux ont des nids, les rats des tanières, l’homme doit avoir une terre, avoir une relation personnelle et ontologique avec elle. La terre est en outre rendue indisponible par la coutume qui voudrait que chaque génération transmette intacte à la suivante le « patrimoine commun ». La terre en effet, ne s’individualise pas malgré les droits individuels qui peuvent s’y exercer. De ce fait, l’individu ne peut valablement aliéner les droits particuliers dont il est titulaire sur la terre, droits qui s’analysent en droits d’usage. La terre n’appartient pas aux générations présentes mais elle est un emprunt aux générations futures.
2- Les effets de l’inaliénabilité.
« Le principe de l’inaliénabilité est destiné à sauvegarder l’intégrité du patrimoine foncier et à en assurer le maintien dans la famille et sa transmission aux générations futures ». C’est la raison pour laquelle en Afrique traditionnelle, les droits ne se perdent pas, même pas par non-usage. Les notions de prescription acquisitive ou extinctive n’existent pas. Les effets principaux sont la nullité de toutes transactions tendant à aliéner le patrimoine commun et l’imprescriptibilité qui se présente comme le corollaire de l’inaliénabilité. Ainsi, parce que la terre est le ciment qui unit tous les membres du groupe, Parce qu’elle inspire protection, sécurité aux hommes, Parce qu’elle est source de vie, Parce qu’elle est sacrée, elle est et demeure inaliénable. Mais, la forme collective et le caractère inaliénable de « l’appropriation » foncière ne s’opposent pas à l’existence et à l’exercice de droits individuels ainsi que l’exploitation de la terre. En conséquence, la terre peut donc circuler.
3- La circulation de la terre
Le mode d’appropriation de la terre renvoie toujours à l’organisation des groupes sociaux, et les règles de transmission n’ont de sens que comme illustration de leur logique interne ». Aussi, les droits sur la terre et les ressources sont-ils liés aux appartenances sociales ; l’accès aux ressources est subordonné aux relations sociales et aux rapports de clientèle. Ainsi, l’individu n’a pas en tant que tel une autonomie qui l’autorise à s’approprier une terre à titre privatif. L’appropriation par un individu d’une parcelle de terre implique la médiation de la communauté à laquelle il appartient. Le rapport à la terre, qu’il soit d’ordre collectif ou individuel, est toujours d’ordre personnel. Il ne saurait avoir de droits réels absolus et exclusifs sur la terre au sens du droit occidental. Il n’est pas interdit à un individu ou à une collectivité de se dessaisir à titre temporaire d’une partie des droits qu’il a sur la terre. Ainsi, est-il permis de donner un terrain en garantie de paiement d’une dette. Cependant, comme l’ont montré les travaux de R. VERDIER cité par N. ROULAND, « on doit distinguer selon que l’opération de transfert de la terre est interne ou externe au groupe » A l’intérieur du groupe, l’endo-transmissibilité de la terre. En droit traditionnel, « un individu accède moins à une terre qu’à une position sociale. L’objectif du groupe n’est pas la terre en tant que telle, mais la reproduction des rapports sociaux ». « La mort d’un individu ou de groupes d’individus n’affectait pas le statut juridique de la terre. Celle-ci ne pouvait donc jamais faire l’objet de dispositions testamentaires de la part d’individus parce que chaque individu était depuis sa naissance bénéficiaire d’une sorte de succession universelle. Elle appartenait absolument aux générations passées, présentes et futures ». La terre circule également au sein de la communauté sous la forme de l’agriculture itinérante, par l’ouverture permanente de terres nouvelles résultant de l’abandon des anciennes, en raison de l’exigence de jachère longue. D’autre part, les concessions entre les membres d’une même communauté ou d’une même famille ne faisant pas de difficulté. Car la terre concédée se trouve toujours dans le domaine communautaire ou familial. La terre pouvait ainsi être cédée en gage d’une créance entre les membres de la même famille ou de la même communauté. A la vérité, c’est le droit d’exploitation qui est cédé pour un temps. Car, nous l’avons noté, en Afrique, la terre est un être ; et les rapports qu’elle a avec les hommes sont des rapports d’être à être. D’ailleurs, les espaces vierges appartenant à la famille sont accessibles à tous les membres de la famille sans qu’aucune autorisation ne soit demandée à qui que ce soit excepté à la terre elle-même. Il apparaît une autre restriction tenant à la capacité juridique de l’individu désireux de créer un champ, d’exploiter un lopin de terre appartenant à la famille : le prétendant à l’exploitation doit être un homme. Les femmes, elles, dépendent pour l’accès à la terre, de leur époux ou de leur fils, par l’intermédiaire de qui elles peuvent obtenir des droits de culture au sein du patrimoine foncier de leur époux. Il s’agit ici donc de droits d’exploitation résultant de l’alliance matrimoniale au lignage de leur époux… Pour autant, leur accès à la terre n’est pas nécessairement précaire, puisque ce droit leur est garanti tant que la situation matrimoniale demeure. Les vieilles filles, les divorcées ou les veuves qui vivent auprès de leurs frères ou de leur père peuvent également avoir accès à la terre, à la terre de leur lignage d’origine. Ce droit d’accès à la terre n’a pas la même étendue que celui qu’exerce leurs frères sur la terre. Elles ne peuvent exercer qu’un droit « d’usufruit ». Ainsi peuvent-elles recevoir « l’usufruit viager » de portion de terre et d’arbres utiles (kolatier, palmier à huile). « L’accès des femmes à la terre est donc lié… à leur investissement réel dans le travail agricole ». Si l’homme libre tient ses droits fonciers de son rattachement à un clan, une famille ayant un « territoire » et à ce « territoire » lui-même, il n’en est pas de même de l’esclave. L’esclave est l’homme coupé de sa terre, « et rattaché au clan de son maître. Il n’a pas de lien direct avec la terre qu’il cultive pour le compte de son maître. A côté de ces types, existait un autre qui se pratiquait dans le cadre de « l’hospitalité ». Il convient d’exposer maintenant ce « nouveau » type. A l’extérieur du groupe, « l’exo-intransmissibilité » de la terre. Une même parcelle peut faire l’objet de différents droits emboîtés ; si certains détiennent des droits d’appropriation ou des droits d’affectation des terres, d’autres n’ont accès aux ressources que par délégation de droit d’exploitation obtenu grâce à la relation sociale avec les premiers. Ces délégataires sont les alliés et les étrangers. L’allié est intégré à la famille comme un membre à part entière et peut donc se voir attribuer une parcelle de la terre de cette dernière aux fins d’exploitation. Au-delà de l’aspect formaliste du droit, un principe domine tous les rapports relatifs à la terre entre Co-villageois et alliés celui par lequel on ne refuse jamais à son « frère » une terre pour se nourrir. Les rapports humains sont à la base de la seule « loi » que l’on puisse énoncer en cette matière. Pour cultiver donc sur les terres vierges mais réservées par une autre communauté que la sienne, il suffit d’en demander l’autorisation à l’aîné sans que celle-ci puisse être refusée à un Co-villageois. L’autorisation de cultiver ne se solde entre Covillageois par aucun transfert, don ou redevance. Ce qui n’est pas le cas pour l’étranger. L’étranger qui arrivait dans un village, après un « stage » voyait attribuer un lopin de terre pour exploitation afin de subvenir à son besoin. Cette attribution se faisait par l’aîné de la famille qui détient des droits exclusifs sur la terre qu’il veut exploiter. En fait « l’allochtone (étranger) qui sollicite son admission sur une terre est tenu de passer par le mandataire de la communauté autochtone. La demande est transmise aux notables qui l’instruisent. La requête est généralement agréée et l’immigrant se fait accompagner sur la portion de forêt qui lui est attribuée. Les limites sont fixées à l’aide de points de repère naturels : marigot, ligne de crête, arbres caractéristiques, l’autorisation ne devenait effective qu’après que l’étranger a offert des offrandes symboliques qui pouvaient être complétée par des redevances. Ces offrandes et redevances font l’objet de libations collectives, au cours desquelles l’aîné de la communauté invoque les ancêtres en versant un peu de vin de palme ou bière de mil sur le sol et sollicite leur approbation. Offrandes et redevances s’interprètent comme une reconnaissance de la souveraineté des autochtones qui accueillent le migrant sur leurs terres. Le droit de l’étranger sur la terre à lui « concédée » est un « droit d’usufruit » limité. L’étranger ne peut pratiquer sur la terre que des cultures saisonnières. Il lui est formellement interdit d’y planter des arbres. « L’usufruitier » abattre des arbres utiles (kolatier, palmier à huile, fromager) se trouvant sur la parcelle à lui « concédée ». Ces arbres sont la propriété des lignages primitifs. Il doit donc conserver ces arbres avec la même capacité de production. « L’usufruitier » doit user de la parcelle sans la détruire ou la détériorer. Il doit la rendre dans l’état où il l’a prise. Il peut y faire des libations qui ne doivent pas violer les coutumes et les interdits de la communauté d’accueil et ceux relatifs à la terre. Par ailleurs, « son fonds » peut être grevé où bénéficier de servitude de passage en cas d’enclave. Toutefois « l’usufruit » n’a pas de délai fixe en droit traditionnel ; les héritiers de « l’usufruitier » peuvent également bénéficier ce droit après sa mort.
La « concession » de terre se fait d’une manière générale pour une durée indéterminée ; l’étranger peut à n’importe quel moment renoncer à ses droits ; soit d’une manière expresse, soit en laissant la terre en friche. Mais, tant qu’il exerce son droit d’usage et que la terre porte les fruits de son travail, on ne peut l’expulser ; la reprise de la terre ne peut avoir lieu qu’après la récolte. Dans tous les cas, l’étranger n’a ni la possession, ni la terre. Ainsi donc, la propriété de la dimension matérielle de la terre anthropomorphisée par la prise de contact avec l’ancêtre du lignage primitif, ne peut pas tomber dans le patrimoine de l’étranger. Ainsi, « à l’extérieur du groupe, s’applique le principe de l’exo intransmissibilité : on peut prêter ou louer la terre à des étrangers au lignage, mais non la céder à titre définitif ». Car, la terre est le ciment qui unit tous les membres du groupe. Et vendre la terre (céder la terre à titre définitif), c’est se vendre, s’aliéner soi-même.
Au total, le droit sur la terre participe du fonctionnement d’ensemble du système spatial. Partage et mise en valeur dépendant d’abord des éléments constitutifs fondamentaux, matériels et idéels, de toute la société territorialisée : écologie, démographie, technologie, attitudes envers la nourriture et le travail, idéologie religieuse et système d’autorité souvent imbriqués, relations de parenté et de solidarité. La conception multidimensionnelle de la terre et l’organisation de l’espace telles qu’on vient de les exposer dans les sociétés traditionnelles vont se heurter à une autre conception de la terre et à une autre organisation de l’espace ; celles de l’Etat moderne colonial avec lequel elles entrent en contact direct au début du XVIIIème siècle.
IV- Intérêt du cours
Le foncier est fondamental, car une bonne connaissance du foncier, pourrait aider à relever les lacune21 qui s’observent dans la mise en œuvre de la politique foncière, afin qu’il puisse y apporter une solution appropriée.
C’est donc un intérêt à la fois social et scientifique.
Au plan social, il s’agit de contribuer à l’amélioration de la gouvernance de la terre. Une bonne administration foncière est capable de résoudre certains problèmes en rapport avec la gestion et l’utilisation des terres. Une bonne administration foncière peut :
- Assurer les garanties des titres fonciers et la sécurité de la tenure foncière ;
- Supporter le processus de taxation foncière (impôt foncier) et générer de ce fait des revenus substantiels à l’Etat ;
- Procurer la sécurité du crédit bancaire par les garanties d’hypothèque.
- Développer et guider les transactions foncières ;
- Protéger le domaine public et le domaine privé de l’Etat et permettre leur bonne gestion ;
- Réduire sensiblement les disputes en matière foncière et contribuer de à bâtir la société et à la réconciliation nationale ;
- Faciliter les réformes foncières en milieu rural ;
- Améliorer la planification et le développement des infrastructures.
La terre devant être aussi un moyen de développement, il est devenu impérieux d’opérer une réforme du régime foncier en République de Côte d’Ivoire afin de rendre efficients les différents programmes tendant à l’accroissement de l’agriculture familiale donc de la production agricole d’une part et de faire de la terre un moyen d’accès au crédit et donc un actif monnayable d’autre part. Pour y parvenir, il faut faire un état des lieux du cadre de gestion foncière et de résolution des conflits fonciers pour analyser leur efficacité.
23(L) KOUADIO, la famille et la terre en Côte d’ivoire : le cas des baoulé, thèse unique de doctorat en droit option histoire du droit et des institutions, soutenue publiquement le 13 septembre 2017 à l’université Alassane Ouattara de Bouake,
En effet le cadre législatif et règlementaire en matière foncière reste en grande partie inadapté à la situation actuelle des conflits en cette matière.
Les différentes structures chargées de la gestion foncière et de régler les litiges en matière foncière ne répondent pas aux attentes des citoyens. La durée des procédures judiciaires est excessive et les décisions ou sentences rendues par les autres structures en ce qu’elles peuvent être remises en cause par des décisions de justice sont inefficaces. Au plan juridique, l’existence d’une législation duale (la coutume et le droit moderne) constitue un obstacle majeur pour la réalisation des objectifs de développement définis par l’Etat à travers différents programmes. La réforme foncière constitue un objectif important et l’unification de la législation foncière une étape primordiale de cette réforme. Elle se heurte à l’existence d’un droit coutumier non codifié mais appliqué par des juridictions suivant une procédure orale, aléatoire quant aux modes d’administration des preuves. Ce droit coutumier régit la majeure partie des terres en Côte d’Ivoire. A côté de cette procédure coutumière, existe une procédure de droit moderne fondée sur les règles du code civil et qui s’applique aux terres immatriculées ou celles qui ont fait l’objet de titres administratifs tels que le permis d’habiter.
Malheureusement cette procédure d’immatriculation des terres demeure inaccessible à la majeure partie des populations à cause des coûts élevés, de la lourdeur et de la longueur des formalités pour y parvenir. De même l’accès des justiciables aux procédures judiciaires reste difficile en raison des coûts, de la durée des procédures et de l’éloignement des juridictions. Aujourd’hui avec la nouvelle loi sur le foncier, l’on n’est toujours pas sorti de l’auberge.
La terre a occupé et occupe encore aujourd’hui une place prépondérante dans la vie de l’Ivoirien. La Côte d’Ivoire est encore essentiellement agricole et pour qui s’intéresse à l’aménagement du territoire, certaines solutions aux problèmes de développement passent par les réponses aux questions que l’on pose à l’espace. Le foncier est un enjeu politique fort et une des données de la vie locale. Il est un enjeu de multiples débats et objet de multiples réformes législatives et réglementaires. En effet, la diversité des acteurs et des pratiques dans le foncier rend l’unification des règles de gouvernance assez ardue. La gouvernance du foncier est appréhendée comme moyen de gouverner des hommes, ce qui donne une fonction sociale et politique de la terre. L’organisation de l’espace et la répartition de la terre entre les familles traduisent l’histoire du peuplement des villages. Le contrôle de la terre différencie les premiers arrivants (parmi lesquels se trouve le chef de terre) et les suivants. Il structure les appartenances communautaires et les clivages de pouvoir. Le foncier reste, pour les gouvernements, un moyen pratique de rétribution des groupes sociaux ou du clientélisme politiques surtout en milieu urbain. Cette fonction ancienne est renforcée par la marchandisation de la production foncière et par l’intensification des conflits pour la terre. Enfin, le foncier est également utilisé comme moyen de pression et de contrôle social. Le pouvoir peut réglementer l’accès au foncier, l’interdire à certains groupes ou interdire aux populations vivant en situation foncière irrégulière d’accéder aux services urbains de base. Les différents acteurs sont conscients qu’il existe un problème de gouvernance sur les terres agricoles toutefois ils ont des difficultés à trouver la manière idoine d’appréhender le problème et à proposer des solutions. La terre est, en effet, le support sur lequel les hommes bâtissent leurs habitations. C’est l’espace cultivé qui fournit à celui qui l’exploite les moyens de subsistance. C’est enfin, un lieu qui permet de situer la provenance, la naissance ou la résidence d’un individu, d’un peuple et, à partir de là, de l’identifier. La terre occupe donc une place prépondérante dans la vie de l’Africain en général et de l’Ivoirien en particulier et est en relation étroite avec les structures sociales. Les « liens qui existent entre les régimes fonciers et les structures sociales et notamment la famille[20] (sont tels que) l’on a pu dire qu’en Afrique la solidarité s’inscrit sur le sol et que l’étude de l’un suppose celle des autres ». Dans ces sociétés traditionnelles africaines, elle était avant tout un objet de cohésion sociale, à la fois sacrée, et facteur essentiel de production[21] dans ces formes d’économie.
La signification ontologique à elle donnée ne se laisse pas enfermer dans une loi. Les enjeux de la terre sont plus étendus encore puisqu’elle est l’objet de crispations, de constrictions, de contractures à la fois sociales mais aussi économiques et politiques.
Sur le plan économique, la réduction considérable des terres en fait un objet de fortes boursicotages, agiotages, spéculations économiques.
En effet, « dans un contexte de démographie galopante, de raréfaction des facteurs de production, la terre devient dans le cas d’une économie agricole un enjeu déterminant et une variable décisive dans l’analyse et la compréhension l’évolution socio-économique du pays et des rapports sociaux production entre les communautés ».
Enfin, sur le plan politique, la question de l’immigration se pose acuité.
La terre est ainsi au centre des préoccupations de la plupart des pays en voie de développement. Elle est en effet un espace disputé. Son accaparement ou son contrôle génère des conflits complexes qui voient s’affronter des revendications puisées à de sources ou légitimités diverses.
Ainsi, elle est l’objet de conflit entre individus, entre communautés ou encore entre corporations professionnelles comme c’est le cas entre éleveurs et agriculteur dans le nord de la Côte d’Ivoire, confirmant ainsi le proverbe : « Qui terre à, guerre a ».
En effet, nombreux sont les conflits qui accompagnent l’acquisition d’un lopin de terre en Côte d’Ivoire, Que ce lopin de terre soit localisé en milieu rural ou urbain, peu importe. « Les questions foncières sont les racines profondes des conflits dans le pays », observe Bert Koenders, représentant spécial du secrétaire général de l’ONU en Côte d’Ivoire. Il observe également que « l’analyse de la situation actuelle reflète la nécessité de prioriser…l’adoption d’une triple stratégie nationale qui traite dans une approche commune les problèmes fonciers, de la sécurité et de la réconciliation ». Pour Monsieur Jeannot Ahoussou KOUADIO « La question du foncier, tant dans son aspect rural que sous sa forme urbaine, est une problématique essentielle au cœur de l’histoire et de la vie de notre pays et l’enjeu est de taille puisqu’il s’agit de circonscrire au mieux les conflits récurrents autour de la question.
CHAPITRE PRELIMINAIRE : LE CADRE JURIDIQUE DU FONCIER RURAL EN COTE D’IVOIRE
Le cadre juridique est constitué par la Constitution ivoirienne, mais aussi par la loi n°98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural, modifiée par les lois n° 2004-412 du 14 août 2004 portant amendement de la loi de 1998 et la loi n° 2013-655 du 13 septembre 2013 relative au délai accordé pour la constatation des droits coutumiers sur les terres du domaine coutumier et portant modification de l’article 6 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au Domaine Foncier Rural.
Une série de textes d’application précise les règles et les principes relatifs à l’occupation et à l’exploitation de la terre dans le domaine foncier rural.
La loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au Domaine Foncier Rural est l’instrument juridique de la politique foncière rurale de la Côte d’Ivoire. On la qualifie de « bible » du foncier en Côte d’Ivoire. Elle est un cadre précis pour le règlement et la prévention des conflits fonciers. Elle vise à :
- Clarifier les droits fonciers ruraux ;
- Sécuriser les investissements dans le domaine foncier rural ;
- Instaurer la sécurité de la propriété foncière rurale ;
- Stabiliser et moderniser les exploitations ;
- Encourager l’accès au droit moderne plus sécurisant ; – Donner une valeur marchande au bien foncier rural.
Elle comporte comme principale innovation, l’instauration du certificat foncier qui constitue la preuve de la reconnaissance et la formalisation des droits fonciers coutumiers. Dans le cadre de sa mise en œuvre, un décret a été pris pour définir la procédure de détermination des territoires des villages, e, vue de faciliter délivrance des certificats fonciers.
Pour assurer l’application de la loi de 1998, quatre le décrets et quinze (15) arrêtés ont été adoptés par le gouvernement.
Les textes juridiques relatifs au Domaine Foncier protègent Rural protègent les détenteurs de droits coutumiers, les occupants de bonne foi et les concessionnaires provisoires de terres de l’Etat ces derniers pouvant consolider leurs droits dans les conditions fixées par la loi.
Dans le but d’améliorer le cadre institutionnel, le Gouvernement a pris le décret n° 2016-590 du 03 août 2016 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Agence Foncière Rurale dénommée AFOR.
Au demeurant, il convient de dire que la loi de 1998 interagir avec un ensemble de textes juridiques ayant des implications da la gestion du domaine foncier rural en Côte d’Ivoire. En ce sens qu’il s’agisse de textes Antée ou post loi de 1998, tous ont et en sont en rapport avec la question foncière. Il s’agit entre autres :
Ø De la Loi n° 2015-537 du 20 juillet 2015 d’Orientation Agricole de Côte d’Ivoire
Elle définit la politique de développement agricole de l’Et en général et les grandes orientations de la politique foncière et particulier. Celle-ci vise notamment la sécurisation des droits de détenteurs coutumiers, la valorisation de la ressource foncière l’accès équitable des hommes et des femmes à ladite ressource et sa gestion durable.
Ø Des directives et conventions régionales et internationales
Elles constituent des déclarations formelles de principes qui ont pour but d’uniformiser les normes applicables à la gestion des ressources naturelles, notamment foncières pour assurer leur durabilité. Il s’agit notamment de la politique agricole de la CEDEAO et de l’UEMOA.
Ø De la loi n°61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la nationalité ivoirienne modifiée en 1972, 2004 et 2013
L’accès à la propriété de la terre rurale est lié à la nationalité ivoirienne. En effet, l’article 1er de la loi sur le foncier rural dispose : « Sont admis à la propriété d’une terre du domaine foncier rural, L’Etat, les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes », cette disposition s’exerce conformément au code de la nationalité qui détermine les conditions d’attribution de la nationalité ainsi que les droits qui y sont rattachés.
Ø De la loi n° 64-379 du 7 octobre 1964 relative aux successions
La transmission du patrimoine foncier est régie en droit par la loi n° 64-379 du 7 octobre 1964 relative aux successions.
Ø De la loi n°64-380 du 07 octobre 1964, relative aux donations entre vifs et aux testaments
La donation qui a pour objet le patrimoine foncier, s’opère légalement conformément aux dispositions de la loi n° 64-0380 du 07 octobre 1964, relative aux donations, entre vifs et aux testaments.
Ø Du Code pénal
Le règlement de certains conflits fonciers nécessite le recours à des mesures d’ordre public, voire l’application du code pénal. En effet, certaines contestations peuvent dégénérer peuvent dégénérer en violences. De même des transactions foncières frauduleuses peuvent nécessiter des poursuites judiciaires.
Ø Du code civil
Les dispositions du code civil des biens et des obligations précisément les articles 552 et suivants de la section première relative aux droits d’accession aux choses immobilières, précisent les droits dont un individu peut se prévaloir en matière foncière
Ø De la loi n° 2014-427 du 14 juillet 2014 portant Code forestier
Le nouveau code forestier lie désormais la propriété de la forêt et la propriété foncière. En effet, les articles 19 ; 36 ; 37 et 40 accordent la propriété des forêts aux titulaires de titres de propriété foncière selon la nature des forêts et le type d’acte détenus.
Ø De la loi n 2014-138 du 24 mars 2014 portant code minier
Le code minier prévoit, en son article 127, que l’occupation des terrains nécessaires à l’activité de prospection, de recherche ou d’exploitation de substances minérales donne droit à une justice indemnité au profit de l’occupant et de l’occupant légitime du sol. L’occupant du sol étant la personne physique ou morale qui a mis en valeur une parcelle du sol et l’occupant légitime du sol, ce qui a obtenu auprès de l’Administration, l’autorisation d’occupe une parcelle du sol ou celui qui, par usage depuis des générations occupe une parcelle du sol.
Ø De la loi n° 96-766 du 3 octobre 1996 portant Code de l’Environnement
Les articles 10 et 11 de ce Code prévoient que l’usage du sol et du sous-sol doit être fait en respectant les intérêts collectifs attachés à leur préservation. A ce titre, le droit de propriété doit être exercé sans qu’il nuise à l’intérêt général. Les statuts du sol doivent établir les droits et obligations du titulaire vis-à-vis d’une protection du sol. Les sols doivent être affectés à des usages conformes à leur vocation. L’article 12 soumet à une autorisation préalable la réalisation de tout projet d’aménagement et d’affectation du sol à des fins agricoles, industrielles ou urbaines, tout projet de recherche ou d’exploitation des matières premières du sous-sol.
Ø De la loi n° 2014-139 du 24 mars 2014, portant Code du Tourisme
Le code du tourisme prévoit notamment, en son article 7, la mise en place de zones de développement et d’expansion touristiques à travers l’identification, la délimitation, l’aménagement et la protection de zone de développement et d’expansion touristique, la libération de ces zones de toutes servitudes et la création de structures chargées de la gestion de travers zones de développement et d’expansion touristiques.
Ø De la loi n°98-755 du 23 décembre 1998 portant code de l’eau
Cette loi a pour objet une gestion intégrée des ressources en eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques. Au terme de l’article 7, l’eau ne peut faire l’objet d’appropriation que dans les conditions déterminées par les dispositions de ladite loi.
Ø Du décret du 29 septembre 1928, portant réglementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique en Afrique Occidentale Française (AOF), modifié par les décrets du 7 septembre 1935 et du 3 juin 1952
Ce décret définit le domaine public par énumération dans les colonies et territoires de l’Afrique-Occidentale française.
Ø Du droit pastoral
Le droit pastoral est régi par plusieurs textes juridiques notamment :
- Le décret 98-70 du 13 février 1998 fixant les règles générales d’installation des exploitants d’élevage dans le domaine foncier rural notamment ;
- Le décret n° 96-433 du 03 juin 1996 relatif au règlement des différends entre les agriculteurs. Ce décret porte sur la mise en place de commissions à divers niveaux (villageois, sous-préfectoral et préfectoral), pour le règlement à l’amiable des différends opposant un éleveur et un agriculteur au sujet d’un dégât causé aux cultures ou d’un préjudice subi par un ou plusieurs animaux ;
- Le décret 96-431 du 03 juin 1996 portant réglementation du pâturage et des déplacements du bétail qui interdit notamment le pacage et le passage des animaux sur les terrains portant des cultures et prévoit la délimitation des pistes pastorales et des zones pastorales dans lesquelles les cultures sont soit interdites soit autorisées à l’intérieur de parcelles clôturées.
Ø Du décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière en Afrique Occidentale Française
Pour l’essentiel, ce décret définit la procédure d’immatriculation des terres et prévoit les règles relatives à la gestion des Livres fonciers.
Ø Décret n° 2014-25 du 22 janvier 2014 modifiant le décret n° 2013-224 du 22 mars 2013 portant réglementation de la purge des droits coutumiers sur le sol pour l’intérêt général. Ce décret définit le coût de la purge pour la perte des droits liés à l’usage du sol.
CHAPITRE 1 : LA NOTION DE DOMAINE FONCIER RURAL
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 portant réforme foncière, le domaine foncier rural se définit comme l’ensemble des terres mises en valeur ou non et quelle que soit la nature de la mise en valeur. Sont visées par cette définition de façon non limitative, les terres affectées à l’ensemble des activités du milieu rural telles que les activités agricoles, forestières, pastorales, cynégétiques, halieutiques, etc. Sont également visées les terres qui n’ont fait l’objet d’aucune mise en valeur, c’est-à-dire les terres exemptes de toute activité anthropique.
Section 1 : La composition du domaine foncier rural
Du point de vue de sa composition, le domaine foncier rural apparaît comme une catégorie résiduelle par rapport au domaine public, au domaine urbain et au domaine forestier classé. Les terres du domaine rural ont fait l’objet d’une classification reposant d’une part, sur les terres ayant un statut permanent (Para 1), d’autre part, sur les terres ayant un statut transitoire (para 2).
Paragraphe 1- Les terres du domaine foncier rural permanent
Le domaine foncier rural est composé à titre permanent d’une part, des terres appartenant à l’Etat, et aux Collectivités territoriales (A), d’autre part, des terres appartenant aux particuliers (B) et enfin des terres sans maître (C).
A- Les terres appartenant à l’Etat ou aux Collectivités territoriales
Le domaine foncier rural des entités publiques est essentiellement composé des terres appartenant à l’Etat (1) et de celles des Collectivités territoriales (2).
1- Les terres appartenant à l’Etat
Le domaine foncier rural de l’Etat se caractérise par sa diversité. Il comprend les terres rachetées (a), les terres immatriculées (b), les terres expropriées ou retirées (c) et enfin les terres sans maître (d). a) Les terres rachetées
Plusieurs parcelles de terre antérieurement acquises par les particuliers ont été rachetées par l’Etat. C’est notamment le cas des vastes concessions foncières obtenues par les particuliers sous le régime colonial, en application soit des dispositions du code civil, soit du système de l’immatriculation. Il en est ainsi par exemple du domaine de San-Pedro d’une superficie de 270 000 ha. Ce domaine qui avait été attribué en concession définitive à la compagnie Française de Kong, par arrêté du 7 août 1900, sera plus tard racheté par l’Etat ivoirie[22]. Les parcelles rachetées font partie du domaine privé de l’Etat ; elles sont gérées conformément aux règles qui régissent ce domaine27.
b) Les terres immatriculées
Suivant le régime foncier en vigueur, l’Etat a toute latitude d’immatriculer de son propre chef les terres dont il a besoin pour la réalisation de travaux d’intérêt général. Avant la loi n » 98-750 du 23 décembre relative au domaine foncier rural, les terres rurales étaient d’abord immatriculées au nom de l’Etat qui les rétrocédait ensuite aux particuliers qui en faisaient la demande. Alors qu’elle a été supprimée pour les terres du domaine coutumier[23], cette procédure d’immatriculation préalable au nom de l’Etat existe encore pour les terres concédées provisoirement sous réserve des droits des tiers avant la loi du 23 décembre 1998[24].
Il en résulte qu’avant leur rétrocession au concessionnaire qui en a fait la demande, ces terres demeurent provisoirement dans le patrimoine de l’Etat. Mieux, elles peuvent y demeurer si le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d’une concession de propriété. C’est le cas notamment des personnes physiques non ivoiriennes et des personnes morales qui au regard de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 ne peuvent plus bénéficier de la propriété foncière.
En tout état de cause, n’étant plus que propriétaire des terres immatriculées à son nom[25], l’Etat devrait désormais procéder à l’immatriculation, à son nom, des terres dont il revendique la propriété. Or sur ce point, l’Etat avait coutume, avant la réforme foncière de 1998, de laisser l’initiative aux particuliers. Il est à craindre aujourd’hui que ce manque d’initiative ne perdure car en la matière, au regard de la réglementation particulière. En effet, contrairement à la législation foncière Burkinabé[26][27], la législation foncière ivoirienne n’oblige pas l’Etat à immatriculer les terres de son domaine privé dans un délai déterminé. En l’absence d’une telle contrainte en vigueur, l’Etat n’a aucune obligation et faute d’immatriculation, l’Etat n’est donc plus fondé à revendiquer la propriété des terres rurales non immatriculées comme cela fut le cas avant la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998. En effet, avant cette loi, l’Etat, soutenu en cela par une jurisprudence constante, s’était proclamé propriétaire des terres non immatriculées. La loi domaniale et foncière non promulguée du 20 mars 1963 en avait énoncé le principe en affirmant la propriété de l’Etat sur l’ensemble des terres non immatriculées à l’exception de celles qui avaient fait l’objet d’une mise en valeur32. Ces prétentions foncières que l’Etat justifiait par la primauté de l’intérêt général sur les intérêts particuliers, avaient été dénoncées par la doctrine qui considérait, à juste titre, qu’elles n’avaient pas de fondement légal[28][29]. Le législateur de 1998 a donc emboité le pas à la doctrine en mettant un terme aux prétentions de l’Etat sur les terres non immatriculées34.
Conformément à la loi n°98-750 du 23 décembre 1998 (art.21), les terres rurales immatriculées au nom de l’Etat sont gérées librement par l’Administration à travers des contrats à durée déterminée conclus avec les personnes concernées. Les locations sont consenties moyennant le paiement d’un loyer dont les bases d’estimation sont fixées par la loi de finances. La cession directe du contrat par le locataire et la sous-location sont interdites (art.15 alin.3 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998). Enfin, à condition qu’il ne porte atteinte aux droits des tiers, le contrat de location se transfère par l’Administration sur demande expresse du cédant.
Les contrats de location comportent obligatoirement des clauses de mise en valeur dont le non-respect expose le locataire défaillant à des sanctions, notamment la résiliation ou la perte de la superficie non mise en valeur. En cas de résiliation pour non-respect des clauses du contrat, les impenses réalisées par le locataire défaillant sont vendues aux enchères. Le produit de la vente est remis au locataire défaillant après déduction des frais éventuels et apurement de son compte vis-à-vis de l’Etat.
Outre la location, les terres immatriculées au nom de ‘Etat peuvent être vendues à l’ancien concessionnaire ou à tout demandeur remplissant les conditions d’accès à la propriété foncière.
Les terres rurales peuvent être expropriées au profit de l’Etat au moyen de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique conformément à la réglementation en vigueur (décret du 26 novembre 1930)35.
Destinées à des travaux d’intérêt général, les terres expropriées pour cause d’utilité publique le sont par décision de justice, laquelle fixe l’indemnité à verser au propriétaire36 (article 20 du décret précité).
Notion d’expropriation
L’expropriation est un terme juridico-administratif utilisé à juste titre dans la procédure domaniale en vigueur à l’effet priver quelqu’un (personne physique ou morale) d’une propriété immobilière pour cause d’utilité publique et moyennant une indemnité.
Notion d’utilité publique
Notion à la fois essentielle et incertaine en droit administratif. Dans son acception générale, l’utilité publique d’une activité est l’élément principal de son rattachement à la catégorie des actes administratifs et partant à la compétence des juridictions administratives pour en connaître en cas de litige. Elle est alors synonyme d’autres mots voisins, tels ceux « d’utilité générale » et « d’intérêt public ». La nature d’utilité publique d’une activité peut ainsi suffire à donner à l’acte par lequel la gestion en a été confiée à une personne privée la qualité de contrat administratif ; elle peut aussi conférer à certains travaux la qualité de travaux publics. Plus généralement, l’utilité publique peut être, à elle seule, la marque d’une véritable mission de service public que la jurisprudence administrative considère comme l’un des critères fondamentaux de la définition du droit administratif.
Dans un sens plus précis, l’utilité publique a aussi été consacrée par divers textes légaux qui appliquent simplement à un domaine particulier certaines conséquences découlant de la notion générale. Ainsi, à côté des établissements publics, il existe des établissements d’utilité publique, personnes morales de droit privé poursuivant un but d’utilité publique, qui relèvent en principe du droit privé mais que la loi soumet à des règles spéciales pour en favoriser et en contrôler la gestion. De même la procédure légale de reconnaissance d’utilité publique est destinée à permettre à certains groupements de jouir d’une pleine capacité juridique et de bénéficier d’importantes subventions, en contrepartie d’un contrôle assez strict de leurs activités. Enfin, la loi organise la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, opération par laquelle une collectivité administrative oblige un particulier à lui céder la propriété de son immeuble dans un but d’utilité publique et moyennant une indemnité juste et préalable à l’expropriation.
Expropriation pour cause d’utilité publique
L’expropriation pour cause d’utilité publique est un mode original d’acquisition des biens immobiliers par la puissance publique. Elle se définit comme l’opération par laquelle l’Etat ou d’autres personnes de droit public, dans un but d’utilité publique, contraignent un particulier à lui céder son immeuble détenu en pleine propriété, moyennant le payement d’une indemnité juste et préalable.
- Sur l’expropriation pour cause d’utilité publique : voir supras.
- Décret n° 72-116 du 9 février 1972, portant fixation du barème d’indemnisation de cultures.
Décret n° 95-817 du 29 septembre 1995 fixant les règles d’indemnisation pour destruction de cultures.
Arrêté interministériel n°28 MINAGRA/MEF du 12 mars 1996 portant fixation de barème d’indemnisation des cultures détruites.
Arrêté interministériel n°247IMINAGRIIMPMEFIMPMB du 17 juin 2014 portant fixation du barème d’indemnisation des cultures détruites.
Arrêté interministériel n° 453/MINADER/MIS/MIRAH/MEF/MCLU/MMG/MEER/MPEER/SEPMBPE du 01 août 2018 portant fixation du barème d’indemnisation pour destruction ou projet de destruction des cultures et autres investissements en milieu rural et abattage d’animaux d’élevage.
C’est l’une des manifestations les plus fortes des prérogatives de puissance publique en ce qu’elle porte atteinte à l’un des droits individuels auquel les particuliers sont le plus rattachés : le droit de propriété, droit fondamental présenté par la déclaration française des droits de l’homme et du citoyen de 1789 comme « inviolable et sacré » et protégé par la même déclaration en son article 17 ainsi que l’article 15 de la Constitution Ivoirienne de 2000 qui n’admettent la violation de ce droit que pour une cause d’utilité publique sous la condition d’une juste et préalable indemnisation.
Le cadre institutionnel légal
Au-delà de la Loi fondamentale de la République de Côte d’Ivoire en son article 15 sus visé, l’expropriation pour cause d ‘utilité publique est organisée par le Décret du 25 novembre 1930 modifié par le Décret du 24 août 1933 et du 8 février 1949 ainsi que la Loi n° 84-1244 du 8 novembre 1984 portant régime domanial des Communes et de la ville d’Abidjan. Ces textes précisent les conditionnalités du recours à l’expropriation pour cause d’utilité publique ainsi que les modalités de son intervention.
Les conditionnalités L’objet et le but de l’expropriation
Seuls les biens immeubles détenus en pleine propriété par les personnes privées (individus, associations ou sociétés, à l’exception des locaux des ambassades ou légations étrangères en vertu des privilèges et immunités diplomatiques) ou les personnes publiques (collectivités territoriales, établissements publics) relativement à leur domaine privé (la règle de l’inaliénabilité interdisant toute expropriation du domaine public), peuvent faire l’objet d’une appropriation en cas d’expropriation.
Seule l’utilité publique peut justifier qu’une personne soit privée, contre sa volonté, de son droit de propriété sur un immeuble ; en d’autres termes, l’expropriation ne peut être prononcée que pour cause d’utilité publique, c’est-à-dire dans le but de satisfaire un besoin d’intérêt général. Il faut préciser que la notion d’utilité publique en matière d’expropriation fait l’objet de contrôle par le juge administratif et l’opération d’expropriation est sanctionnée lorsque la cause d’utilité publique alléguée par l’administration n’est pas justifiée ou est inopérante.
Les acteurs de l’opération d’expropriation
On distingue trois (3) catégories d’acteurs dans une opération d’expropriation : Les expropriants :
- L’Etat, seul compétent pour prendre les actes qu’exige la procédure d’expropriation.
- Les autres personnes morales de droit public que sont les collectivités territoriales et les établissements publics sont également investies du droit d’initiative en matière d’expropriation. Toutefois, le législateur peut à travers des textes spéciaux reconnaître le droit d’initiative à des personnes privées (sociétés d’Etat, sociétés concessionnaires).
- L’Etat demeure le seul titulaire du droit d’expropriation. Les autres entités se contentent de provoquer le déclenchement de l’opération d’expropriation qui est mise en œuvre par l’Administration étatique et ses démembrements.
Les expropriés :
- Personnes publiques en ce qui concerne les biens immobiliers de leur domaine privé.
- Personnes privées titulaires d’un titre de propriété sur le bien immobilier dont la puissance publique veut prendre possession.
Les bénéficiaires de l’expropriation :
Si généralement les bénéficiaires sont les expropriants, il n’en va pas toujours ainsi. L’expropriant peut être différent du bénéficiaire, c’est-à-dire, celui qui va recueillir dans son patrimoine le bien exproprié. En la matière, il est admis qu’un expropriant peut céder le bien exproprié à un tiers ne bénéficiant pas du droit de déclencher une procédure d’expropriation, alors que l’activité qu’il développe est profitable à la collectivité.
Les modalités d’intervention
Les modalités d’intervention de l’expropriation varient selon que l’opération est diligentée en période normale ou en cas d’urgence.
La procédure normale
En période normale, la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique comprend deux (2) phases :
La phase administrative : C’est la phase de préparation. Elle est conduite par l’Administration et est marquée par quatre (4) étapes dans son déroulement qui sont :
- L’adoption d’un acte (loi ou décret) autorisant les travaux à réaliser. o L’adoption d’un acte déclarant l’utilité publique des travaux (l’article 3 alinéa 2 du Décret de 1930) : la déclaration d’utilité publique a pour objet de constater l’intérêt général, le bien-fondé de l’opération et de permettre à celle-ci de s’effectuer avec la prise de possession des immeubles nécessaires à sa réalisation. La déclaration d’utilité publique est publiée par arrêté si l’utilité publique n’est pas déjà prononcée dans l’acte autorisant les travaux.
- La réalisation d’une enquête publique de commodo et incommodo : elle est prévue par l’article 6 du Décret de 1930 supra cité et vise à informer les administrés, singulièrement les éventuels expropriés et à recueillir leurs avis.
- L’adoption de l’arrêté de cessibilité : il a pour objet d’identifier les immeubles dont l’expropriation est poursuivie et son adoption doit intervenir au plus tard dans un délai d’un (1) an après publication de la déclaration d’utilité publique. L’arrêté de cessibilité doit être notifié aux propriétaires, occupants et usagers des immeubles visés et publié au journal officiel (JO) de la République de Côte d’Ivoire ainsi que dans le journal d’annonces légales de la situation des lieux. L’adoption de l’arrêté de cessibilité clôt la phase administrative et donne lieu à une tentative de fixation amiable de l’indemnité d’expropriation dont le résultat conditionne le déclenchement de la phase immeubles judiciaire.
La phase judiciaire :
Elle intervient qu’en cas d’échec de la procédure amiable conduite durant la phase administrative. Le Tribunal territorialement compétent est celui du lieu de situation des immeubles à exproprier. Le jugement d’expropriation rendu porte transfert de propriété des biens immeubles au profit de la collectivité expropriante et ce jugement est exécutoire, nonobstant toute procédure d’appel et moyennant consignation de l’indemnité d’expropriation qui est également fixée par le juge d’expropriation en cas de désaccord entre les parties. Le montant de l’indemnité est déterminé en tenant compte de la valeur de l’immeuble à la date du jugement d’expropriation, la plus-value ou la moins-value résultant de la partie de l’immeuble non expropriée ainsi que le dommage actuel et certain directement cause par l’expropriation.
La procédure exceptionnelle ou d’urgence d’expropriation
Cette procédure est prévue et organisée par l’article 27 du Décret de 1930 sus visé aux termes duquel lorsqu’il y a urgence de prendre possession de terrains bâtis ou non, de bâtiments en bois ou autres matériaux provisoires soumis à l’expropriation, et notamment en matière militaire et d’assainissement, l’urgence doit être déclarée en même temps que l’utilité publique. Il est important de préciser que :
- Cette procédure ne vise que les terrains non bâtis ou les terrains bâtis avec des matériaux provisoires
- Il n’y a pas de phase administrative, ni amiable dans son déroulement car seule l’intervention du juge, qui, par référé, ordonne la prise de possession des immeubles concernés ;
- La prise de possession des terrains par la collectivité expropriante est subordonnée à la consignation de l’indemnité d’expropriation.
Avant la réforme foncière de 1998, les terres rurales pouvaient également faire l’objet de retrait au bénéfice de l’Etat pour absence ou insuffisance de mise en valeur. Mais ce retrait n’est désormais plus possible depuis la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998. En effet, en lieu et place du retrait, cette loi prévoit la contrainte sans cependant en indiquer la nature37.
d) Les terres sans maître38
Aux termes de l’article 6 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998, les terres sans maître appartiennent à l’Etat. Sont considérées comme sans maître :
- Les terres objet d’une succession ouverte depuis plus de trois ans mais non réclamée ;
- Les terres du domaine coutumier sur lesquelles des droits coutumiers exercés de façon paisible et continue n’ont pas été constatés dix ans à compter de la date de publication de la loi n° 2013-655 du 13 septembre 201339,
- Les terres provisoirement concédées sur lesquelles les droits du concessionnaire n’ont pu être consolidés cinq ans à compter de la date de publication de la loi n° 2013-655 du 13 septembre 2013 précitée.
Les terres sans maître font partie du domaine privé de l’Etat et sont gérées conformément aux règles qui régissent ledit domaine40. La preuve de l’absence de maitre sur une terre incombe désormais à l’Etat. En effet, il est à souligner que certaines pratiques agricoles notamment la jachère pratiquée par les populations permettait du repos à la terre, de reconstituer l’écosystème sans pour autant être vue comme vacante et sans maitre. En dehors de l’État, les Collectivités territoriales peuvent se voir attribuer des terres conformément à la réglementation en vigueur.
2- Les terres des Collectivités territoriales
Conformément à la législation en vigueur41, le domaine foncier rural des Collectivités territoriales (districts, régions, communes) est composé des terres qui leur sont transférées ou cédées (a), des terres acquises (b) et des terres d’intérêt local (c).
37article 20 de la loi du 23 décembre 1998 indique que les propriétaires de terres du domaine foncier rural qui n’ont pas mis leur terre en valeur peuvent y être contraints dans les conditions déterminées par décret pris en Conseil des Ministres. Mais jusqu’à ce jour, ce décret n’a pas encore été pris.
38Sur les terres sans maître voir Infra p :
39Loi n°2013-655 du 13 septembre 2013 relative au délai accordé pour la constatation des droits coutumiers sur les terres du domaine coutumier et portant modification de l’article 6 de la loi n° 98-750 du 23 décembre relative au domaine foncier rural, telle que modifiée par la loi n° 2004-412 du 14 août 2004 JORCI du 14 octobre 2013, P.598.
40-Infra p.
41Loi n° 2003-489 du 26 décembre 2003 portant régime financier, fiscal et domanial des Collectivités territoriales modifiée par la loi n°2005-161 du 27 avril 2005 (Articles 202 à 223).
Loi n°2014-451 du 05 août 2014 portant orientation de l’organisation générale de l’Administration Territoriale
Loi n°2014-453 du 05 août 2014 portant statut du District Autonome d’Abidjan
Loi n°2014-454 du 05 août 2014 portant statut du District Autonome de Yamoussoukro
DECRET N°2011-263 du 28 SEPTEMBRE 2011 Portant organisation du territoire national en Districts et en Région
LOI N°2003-208 du 07 JUILLET 2003 portant transfert et répartition de compétences de l’Etat aux collectivités territoriales
Loi n°2003-489 du 26 décembre 2003 portant régime financier, fiscal et domanial des collectivités Territoriales Loi n°2014-451 du 05 août 2014 portant orientation de l’organisation générale de l’Administration Territoriale Loi n°2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales.
a- Les terres transférées ou cédées
L’Etat ou une Collectivité territoriale peut transférer ou céder à titre gratuit ou onéreux des terres aux Collectivités territoriales. Le transfert ou la cession des terres rurales de l’Etat au profit des Collectivités territoriales est autorisé par le décret pris en Conseil des Ministres soit à l’initiative de l’Etat, soit à la requête de la Collectivité territoriale concernée. Les terres transférées ou cédées par l’Etat deviennent la propriété de la Collectivité territoriale concernée. Le transfert ou cession est gratuit lorsque les terres concernées sont destinées au domaine public de la Collectivité territoriale bénéficiaire. Dans ce dernier cas, la loi de finances détermine le montant à allouer à la Collectivité territoriale pour faire face aux charges résultant de la cession ou transfert. b- Les terres acquises
Les Collectivités territoriales peuvent acquérir des terres rurales à titre gratuit à la suite de dons, legs reçus et acceptés, ainsi que par d’autres voies de droit telles que la prescription, la saisie, la confiscation (notions à développer). L’acquisition de terres peut également se réaliser à titre onéreux sous plusieurs formes (achat, échange, marché, préemption, expropriation pour cause d’utilité publique ou pour insuffisance de mise en valeur)[30]. Dans certains cas (achat, échange, donation ou legs), l’acquisition est décidée par une délibération du Conseil et transmise à l’Autorité de tutelle. Dans d’autres (expropriation), la décision est prise par délibération du Conseil dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
c- Les terres d’intérêt local
Font partie du domaine foncier rural des Collectivités territoriales, les terres déclarées d’intérêt local par décret pris en Conseil des Ministres[31].
Les terres rurales ci-dessus énumérées font partie du domaine privé de la Collectivité territoriale. Elles doivent, conformément à la réglementation foncière être immatriculées à leur nom. En conséquence, elles peuvent être vendues dans les mêmes conditions que les terres rurales de l’Etat. Elles peuvent également faire l’objet de lotissement, de location, de permis d’habiter, de concession ou de baux emphytéotiques.
En dehors des terres appartenant à l’Etat ou aux Collectivités territoriales, il convient d’examiner celles dont les particuliers (personnes physiques) sont propriétaires
B- Les terres appartenant aux particuliers
Il s’agit d’abord des terres acquises par la voie de l’immatriculation[32]. En tout état de cause, ces terres sont aujourd’hui de très faible importance en raison essentiellement du manque d’effectivité de la procédure d’immatriculation. En effet, en raison de sa complexité et de son caractère onéreux, cette procédure qui devait consolider la propriété individuelle des terres, n’a pas connu auprès des populations le succès escompté. Selon les dernières données disponibles, seulement 2% environ des terres auraient été immatriculées depuis plus d’un siècle de mise en œuvre de la procédure d’immatriculation. En ce qui concerne les titres d’occupation, les données disponibles indiquent que 248 concessions définitives seulement, ont pu être délivrées par l’Etat[33].
Aux terres immatriculées, s’ajoutent celles que les particuliers ont pu acquérir sous le régime du code civil. En effet, sous ce régime introduit en Côte d’Ivoire par l’arrêté Binger du 10 septembre 1893, l’administration coloniale avait concédé de vastes portions de terres domaniales aux personnes physiques et morales capables de les mettre en valeur46. Mais les droits fonciers résultant de ces concessions n’ont pu légalement être maintenus que par la voie de l’immatriculation. Le décret du 26 juillet 1932 (art. 21) indique en effet que la propriété des biens immeubles de même que les autres droits réels (usufruit, emphytéose, droit de superficie, etc..) ne se conservent et ne produisent effet à l’égard des tiers que s’ils ont été publiés au livre foncier
Les propriétaires de terres rurales immatriculées peuvent en disposer librement sous réserve des dispositions de l’article 1 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural[34]. Quid des titulaires de certificats fonciers dont les droits sont assimilables à la propriété civiliste ? Ceux-ci ont toute latitude de louer leurs terres ou même de les céder par acte authentifié par l’autorité administrative (article 17 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 précitée).
Contrairement aux catégories de terres précitées dont la propriété peut être établie par les personnes ou entités concernées, les terres dites sans maître, ont toujours été au centre d’un contentieux récurrent opposant l’administration aux populations locales.
C- Les terres vacantes et sans maitre
Sous l’empire du décret du 15 novembre 1935 portant réglementation des terres domaniales en Afrique occidentale française, le concept de terres vacantes et sans maitre avait permis la mainmise de l’administration coloniale sur les terres non mises en valeur. Il s’agit de terres sur lesquelles il n’y a aucun constat de présence humaine. En effet, après avoir énoncé qu’en « Afrique occidentale française les terres vacantes et sans maître appartiennent à l’Etat », l’article premier du décret précité indiquait qu’il en est de même des terres qui ne faisant pas l’objet d’un titre régulier de propriété ou de jouissance sont inexploitées ou inoccupées depuis plus de dix ans[35].
La théorie des terres vacantes et sans maître avait suscité le mécontentement des populations autochtones et en particulier des propriétaires fonciers coutumiers qui considéraient à juste titre que l’inexploitation d’une terre, n’implique pas que celle-ci soit inoccupée ou sans maître[36]. Pour la doctrine, cette théorie n’avait aucun fondement juridique et avait uniquement pour but de spolier les autochtones de leurs droits fonciers au profit de l’administration coloniale et des colons capables de mettre les terres en valeur[37]. C’est la raison pour laquelle le Conseiller Jean Baptiste Mockey, après avoir dénoncé les revendications foncières de l’Etat colonial, avait demandé l’arrêt des concessions et le retour dans le patrimoine coutumier des terres déjà concédées[38].
Face à la levée de boucliers des propriétaires coutumiers et des intellectuels africains, les dispositions du décret du 15 novembre 1935 relatives aux terres vacantes et sans maître avaient été abrogées entraînant ainsi une renonciation de l’Etat auxdites terres. Mais en réalité, cette renonciation n’était qu’apparente car, l’article 13 du décret du 20 mai 1955 qui la consacrait, renvoyait à l’article 713 du code civil aux termes duquel les terres vacantes et sans maître appartiennent à l’Etat. Ce qui maintenait implicitement la revendication de l’Etat colonial sur les terres vacantes et sans maître.
En réalité, le mérite du décret du 20 mai 1955, était d’avoir, comme le prévoit l’article 1315 du code civil, réalisé le renversement de la charge de la preuve de la vacance et de l’absence de maître. En effet, sous l’empire du décret du 15 novembre 1935, il appartenait aux autochtones de prouver que leurs terres n’étaient ni vacantes, ni sans maître. Une telle preuve était très malaisée, car bien souvent, ceux-ci ne disposaient pas de titre d’occupation.
Avec le décret du 20 mai 1955, on revenait donc aux dispositions du code civil (art. 1315) de sorte qu’il incombait à l’Etat colonial de prouver la vacance et l’absence de maître. Juridiquement, l’on se trouvait dans une situation paradoxale dans laquelle ni l’Etat colonial, ni les détenteurs coutumiers, n’étaient propriétaires des terres non immatriculées.
Le décret n°55-580 du 20 mai 1955 n’a pas connu d’application en raison de l’accession de la Côte d’Ivoire à l’autonomie interne et plus tard à l’indépendance. Il n’est d’ailleurs pas certain que la situation aurait été fondamentalement différente, si l’indépendance n’était pas intervenue, car les textes antérieurs au décret du 20 mai 1955 ont en réalité connu peu d’application.
En ayant recours au concept de terre sans maître[39], le législateur ivoirien, pour éviter toute équivoque, a pris soin d’en donner la définition. Ainsi, dans la version initiale de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural, étaient d’abord considérées comme des « terres sans maitre » les terres objet d’une succession ouverte mais non réclamée depuis plus de trois ans. Tel était le cas ensuite des terres sur lesquelles des conflits perduraient dix ans après la publication de la loi n°98-750 du 23 décembre 1998. Tombaient enfin sous le coup de cette appellation, les terres concédées provisoirement mais non mises en valeur trois ans à compter de cette publication.
Les délais précités n’ont pu être respectés par les titulaires de droits fonciers concernés. Aussi, pour éviter que ceux-ci ne soient dépossédés de leurs terres par application de la théorie des terres sans maître, le législateur a été amené par la loi n° 2013- 655 du 13 septembre 2013, à proroger les délais initiaux par une modification de l’article 6 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural. Cette prorogation qui prend effet, à compter de la date de publication de la loi du 13 septembre 2013, court pour 10 ans, en ce qui concerne les terres du domaine coutumier et pour 5 ans, en ce qui concerne les terres provisoirement concédées[40].
De ce qui précède, il convient de se demander à qui incombe la charge de la preuve de l’absence de maître ? Cette charge en vertu de l’article 6 de la loi n°98-750 du 23 décembre 1998 précitée, incombe à l’administration. Celle-ci doit à cet effet, délivrer un acte administratif constatant le défaut de maître. Cette disposition qui est conforme à l’article 1315 du code civil, est à l’avantage des propriétaires fonciers coutumiers, car ceux-ci ne disposent pas le plus souvent d’un document attestant de leurs prérogatives foncières.
Cependant, une fois que la preuve de l’absence de maître est établie par l’Etat, les terres concernées[41] peuvent être incorporées au domaine privé de l’Etat et gérées conformément aux textes en vigueur[42]. Si l’on tient compte du nombre important de conflits fonciers non résolus et du manque de moyens des populations rurales pour la mise en valeur des terres, l’Etat apparaît d’ores et déjà comme le potentiel bénéficiaire de l’application du concept des terres sans maître, tout comme ce fut le cas de l’administration coloniale, relativement à la théorie des « terres vacantes et sans maître ».
Dans l’ensemble, malgré leur diversité, les terres du domaine foncier permanent se caractérisent par un statut relativement stable. Tel n’est pas le cas en revanche, des terres du domaine foncier rural transitoire.
Paragraphe 2- Les terres du domaine foncier rural transitoire
Les terres concernées ici ont pour point commun de ne guère appartenir, au sens du régime foncier[43], à ceux qui en sont les occupants.
Il s’agit d’une part, des terres du domaine coutumier (A), d’autre part, des Terres domaniales concédés provisoirement par l’Etat à des personnes physiques et morales (B).
A- Les terres du domaine foncier coutumier
Pour le législateur ivoirien[44], le domaine coutumier est d’abord constitué par l’ensemble des terres sur lesquelles s’exercent des droits fonciers conformes aux traditions. Sont ensuite visées les terres sur lesquelles s’exercent des droits coutumiers cédés aux tiers. Si les droits fonciers conformes aux traditions sont ceux qui sont gérés conformément aux tenures foncières coutumières, qu’en est-il des droits coutumiers cédés aux tiers ? Que l’on se situe antérieurement ou postérieurement à la réforme foncière du 23 décembre 1998, il s’agit, à n’en point douter, des droits découlant des transactions foncières coutumières effectuées par les populations (ventes, donations, locations, etc.).
A l’analyse, l’expression « droits coutumiers cédés aux tiers » renvoie à plusieurs cas de figure. Il y a en premier lieu, les droits coutumiers cédés postérieurement à la réforme foncière de 1998 soit conformément à la réglementation en vigueur[45], soit hors l’intervention de l’Administration[46]. Il y a en second lieu les droits coutumiers cédés antérieurement à cette réforme.
Sous l’empire du défunt décret n°71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières, les transactions foncières coutumières étaient normalement frappées de nullité. Le décret précité (article 2) indiquait à cet effet que « les droits portant sur l’usage du sol, dits droits coutumiers sont personnels à ceux qui les exercent et ne peuvent être cédés à quelque titre que soit ». Frappées de nullité, ces transactions foncières coutumières ne pouvaient donc créer de droits au profit des cessionnaires. Mais en disposant que le domaine coutumier est aussi composé de droits cédés aux tiers, le législateur de 1998 semble consacrer non seulement l’existence, mais aussi la reconnaissance de ces droits.
En ce qui concerne les droits coutumiers cédés postérieurement à la réforme foncière de 1998, dès lors que le législateur ne fait aucune distinction entre ceux qui sont régulièrement cédés et ceux qui ne le sont pas, il y a lieu d’admettre que ces droits sont indifféremment reconnus comme faisant partie du domaine coutumier, au même titre que les droits cédés antérieurement à ladite réforme. En d’autres termes, qu’ils soient antérieurs ou postérieurs à la réforme foncière de 1998, les droits coutumiers cédés sont reconnus. Mais cette reconnaissance ne préjuge en rien de la régularité de la cession. Aussi illogiquement à la jurisprudence d’apprécier au besoin, la régularité ou non des cessions de droits coutumiers. Sur ce point, la Cour d’Appel de Daloa[47]a pu juger à plusieurs reprises que la « cession d’une terre coutumière opère au profit du cessionnaire un transfert des droits coutumiers de sorte que le cédant n’est plus fondé à s’en réclamer ».
Mais à l’analyse, cette solution qui s’accommode des cessions de terres rurales dépourvues de certificats fonciers semble remettre en cause le bien-fondé des procédures domaniales et foncières. En effet, la reconnaissance de droits fonciers coutumiers cédés, sans passer par la certification, s’apparente à un blancseing à la prolifération des actes sous-seing privés ou des conventions coutumières contra-legem. Si elle est déjà discutable pour les droits cédés avant la réforme foncière de 1998, elle l’est davantage pour les droits cédés après ladite réforme, En d’autres termes, cette reconnaissance se concilie difficilement avec la nécessité actuelle de promouvoir la certification foncière.
Or, concernant le domaine foncier coutumier, le certificat foncier constitue le point de départ de la propriété foncière immatricutée[48]. En effet, tout titulaire d’un certificat foncier dispose, conformément à la règlementation en vigueur, d’un délai de trois ans pour demander l’immatriculation de sa parcelle de terre[49][50].
Certes, le titulaire du certificat foncier peut disposer de son bien foncier conformément aux dispositions du Code civil, mais cette faculté ne lui confère pas pour autant la propriété au sens de la réglementation foncière, propriété qui découle nécessairement de l’immatriculation foncière63.
Faute d’immatriculation au nom d’un ayant-droit, les terres du domaine coutumier conservent leur statut transitoire. Il en va de même des terres du domaine concédé.
B- Le domaine foncier concédé
Il comprend les terres attribuées provisoirement aux personnes physiques et morales avant la réforme foncière du 21 décembre 1998. Il en est ainsi des terres attribuées sous le régime du permis d’occuper ou des concessions (concession provisoire pure et simple, concession provisoire sous réserve des droits des tiers, bail emphytéotique).
Les bénéficiaires de ces concessions provisoires disposent d’un délai de 5 ans à compter de la date de publication de la loi du 13 septembre 2013, pour demander (‘immatriculation de leurs terres. Cette immatriculation est d’abord faite au nom de l’Etat qui peut ensuite céder la parcelle de terre concernée à l’ancien concessionnaire si celui-ci a qualité à être propriétaire foncier. Dans le cas contraire, une location peut être consentie par l’Etat à celui-ci.
Faute d’immatriculation, les terres provisoirement concédées demeurent dans le domaine foncier transitoire. Il en résulte que placé dans une situation transitoire, le domaine foncier concédé dont la durée, de vie est fonction de la diligence des acteurs concernés, est appelé nécessairement à disparaître. A terme, et conformément à la réforme foncière du 23 décembre 1998, le système de concession des terres domaniales devra faire place à la location.
Exception faite des terres appartenant déjà aux particuliers, les terres du domaine foncier permanent ou du domaine foncier transitoire peuvent faire l’objet d’attribution, conformément à la réglementation en vigueur.
Section 2 : L’attribution des terres du domaine coutumier
L’attribution des terres du domaine coutumier se fait selon des critères essentiels définis par la réforme foncière du 23 décembre 1998.
Paragraphe 1 : Les critères d’accès à la propriété des terres du domaine coutumier
Le premier critère a trait au constat d’existence paisible et continue de droits coutumiers (A). Quant au second, il se rapporte à la nationalité du demandeur : c’est le critère personnel (B).
A- Le constat d’existence paisible et continue de droits fonciers
Pour les terres du domaine rural coutumier, le constat d’existence continue et paisible de droits fonciers constitue le critère essentiel d’attribution du certificat foncier. Ce constat résulte de l’enquête foncière prévue par le décret n°99-594 du 13 octobre 1999 fixant les modalités d’application au domaine foncier rural coutumier de la loi n°98-750 du 23 décembre 1998. Le caractère continu et paisible suggère l’idée de jouissance non conflictuelle de droits fonciers sur une longue période.
La continuité et la paix dans la jouissance sont donc des conditions cumulatives. Cependant, contrairement aux dispositions du Code civil relatives à la prescription acquisitive, laquelle peut être trentenaire ou décennale la loi précitée ne détermine pas la durée de cette période. Au demeurant, il est permis se demander si la continuité à laquelle renvoie la loi foncière de 1998 n’exclut pas l’idée de limite temporelle ? Cette question se pose d’autant plus que le droit coutumier n’admet pas que le temps puisse créer un droit ou l’éteindre[51]. Il en résulte que c’est l’absence de conflit qui devrait s’avérer déterminante dans le constat d’existence continue et paisible de droits coutumiers.
Mais le constat d’existence paisible et continue de droits fonciers suffit-il pour se voir attribuer la propriété d’un terrain du domaine coutumier ? A cette question, il y a lieu de répondre par la négative. Car en plus du constat d’existence paisible et continue de droits fonciers, il faut aussi satisfaire à un critère lié à la personne du demandeur.
B- Le critère personnel
Aux termes de l’article premier de la réforme foncière du 23 décembre 1998, seuls l’Etat, les Collectivités Publiques et les personnes physiques ivoiriennes sont admises à être propriétaires. Il en résulte que d’une part, les personnes physiques non ivoiriennes, d’autre part, les personnes morales, quelle que soit leur nationalité, ne peuvent requérir en leur nom l’immatriculation d’un terrain du domaine coutumier.
Si ces dispositions d’une importance capitale se justifient par la volonté de l’Etat de mettre un terme à la mainmise croissante des non nationaux sur les terres et à réserver corrélativement aux nationaux la maîtrise du patrimoine foncier ivoirien, elles posent nécessairement le problème des droits acquis des personnes physiques non ivoiriennes et des personnes morales visées.
En ce qui concerne les personnes physiques non ivoiriennes, la loi foncière de 1998, dans la formulation initiale de son article 26, disposait que les droits fonciers que celles-ci avaient déjà pu acquérir étaient maintenus à titre personnel. Autrement dit, ces droits cessaient en principe avec le décès de leur titulaire. Cependant, la loi foncière dans sa première formulation, opérait une discrimination qui permettait aux héritiers de nationalité ivoirienne, de demander l’immatriculation à leur nom. Dans le cas ou ceux-ci n’étaient pas ivoiriens, ils disposaient alors d’un délai de trois ans pour céder les terres à une personne physique ivoirienne, ou pour requérir à leur profit une location, après retour des terres concernées au domaine de l’Etat.
De toute évidence, cette disposition de l’article 26 n’est guère en harmonie avec la théorie des droits acquis.
Aussi avait-elle fait l’objet de critiques virulentes, à telle enseigne que suite aux accords de Linas Marcoussis (en France), consécutifs à la crise sociopolitique de 2002, elle a été modifiée par le législateur ivoirien, à travers la loi n° 2004-412 du 4 août 2004. Cette modification qui a pris forme à travers l’article 26 nouveau de la loi du 23 décembre 1998, indique que les droits de propriété foncière que les personnes physiques non ivoiriennes ont pu déjà acquérir sont maintenus. Autrement dit, ces droits fonciers n’ont plus un caractère personnel et peuvent être transmis aux héritiers, quelle que soit leur nationalité.
En ce qui concerne les personnes morales maintenues dans leur droit de propriété en vertu de la règle des droits acquis, elles ne peuvent céder leurs droits à un cessionnaire qui n’a pas accès à la propriété foncière qu’à la condition de déclarer le retour de leurs terres au domaine de l’Etat. Dans une telle hypothèse, le cessionnaire désigné peut bénéficier d’un bail emphytéotique ou d’une location de la part de l’Etat.
Si les personnes physiques non ivoiriennes et les personnes morales n ‘ont pas accès à la propriété foncière, rien n’interdit qu’elles puissent obtenir un certificat foncier. Il suffit pour cela qu’elles puissent justifier de l’existence paisible et continue de droits sur le domaine coutumier. Mais le certificat foncier qui leur est délivré dans ces conditions ne peut en aucun cas leur ouvrir la voie à la propriété foncière ; tout au plus peut-il après immatriculation du terrain au nom de l’Etat, leur permettre de bénéficier d’une location ou d’un bail emphytéotique.
Paragraphe 2 : Les caractéristiques du domaine foncier rural
I- L’inaliénabilité de la terre du domaine coutumier
Dans la société traditionnelle africaine, les ressources naturelles en l’occurrence la terre et les ressources accessoires (eau, forêts, faune, fourrages) sont la propriété collective des premiers occupants de la terre et de leurs descendants. Elias Olowale disait à ce sujet que « la terre appartient à une grande famille dont beaucoup de membres sont morts, quelques-uns vivants et dont le plus grand nombre est à naitre ». Les descendants des premiers occupants ont qualité de propriétaires fonciers coutumiers et ont pour obligation de gérer les ressources naturelles (terre, eau, forêts, etc.) conformément aux règles régissant chaque communauté. Considérées généralement comme des biens sacrés, ces ressourcés étaient inaliénables. La terre est sacrée. Elle a une vie propre, autant que l’esprit qui l’habite. Et si dans sa générosité, elle se prête aux besoins de l’être humain, elle ne peut être vendue. Elle est mère en effet, mère nourricière, et en tant que telle, ne peut être cédée comme un vulgaire objet marchand. Protégée par des génies, tout manque de considération peut attirer le courroux de ces derniers. Enfin, la terre est l’héritage communautaire, le symbole de l’unité ancestrale et de l’avenir commun. Preuve de l’identité autochtone elle établit les droits des vivants et garantit ceux de la postérité intégrée dans le patrimoine familial du premier occupant avec son accord propre, et celui des génies, la terre reste libre et autonome. Les droits qu’elle a accordés à l’ancêtre doivent être respectés par ses descendants. Ce sont des droits d’usage, certes renforcés et illimités dans le temps, mais qui n’en sont pas pour autant, des droits de propriété. Ils ne peuvent être cédés définitivement à un autre individu. Le changement de la détention coutumière ne peut se faire que si les descendants du premier occupant décident de rompre le pacte établi par leurs ancêtres en accomplissant les sacrifices de rupture. Ils quitteront alors la terre pour s’établir ailleurs. Un nouveau venu tentera alors de pactiser avec la terre et les génies protecteurs, et si le pacte est accepté, le candidat deviendra le nouveau détenteur coutumier. La détention de la terre dans la logique coutumière implique donc forcément l’accord des forces spirituelles qui l’habitent.
II- L’imprescriptibilité, corolaire de l’inaliénabilité des droits sur la terre en vertu de coutume
Les droits coutumiers acquis le sont de manière définitive. C’est un droit illimité dans le temps que le premier occupant a obtenu des Esprits en s’installant sur la terre. De même, ses descendants, conservent la protection des génies et le droit exclusif d’user de la terre tant qu’ils ne remettent pas en cause les termes du contrat originel. Le principe d’hospitalité permet aux membres de la communauté d’accueillir des personnes étrangères à la communauté. Ces personnes pourront alors bénéficier de parcelles leur permettant de subvenir à leurs besoins alimentaires sous le regard scrutateur des ancêtres. Habitant dans un monde parallèle à celui des vivants, les ancêtres participent en effet à la vie du village et rappellent régulièrement à travers les porteurs de masque et autres « Komians » les circonstances de la création du Village et le pacte ancestral. Ainsi, les droits coutumiers des autochtones sur la terre sont imprescriptibles, à cause de l’imprescriptibilité même de ceux qui les leur ont accordés. La communauté autochtone conserve donc ses droits et tant que les ancêtres et les génies en témoigneront, aucun « papier de blanc » ne pourra leur démontrer le contraire. L’imprescriptibilité des droits sur la terre confère par ailleurs de l’autorité à ceux qui en bénéficient. La terre consacre, en effet, le principe d’autochtonie et les droits qui lui sont, rattachés. Elle établit les prérogatives de la communauté et fait valoir les droits de ces membres face à toute prétention « étrangère ». A l’intérieur du groupe, elle consacre l’autorité du chef de terre dont la qualité de gestionnaire de terre en fait un gestionnaire d’hommes. Plus a de terre gérer, plus il a d’hommes à gérer, et plus son autorité grandit. Cependant, à l’instar de tous les détenteurs coutumiers, les droits acquis au nom de la coutume traditionnelle n’ont pas toujours été reconnus par l’Etat et ont connu une très lente évolution. L’imprescriptibilité est le corollaire de l’inaliénabilité.
Selon l’art. 2262 du Code civil, un occupant même de mauvaise foi, devient propriétaire après un délai de trente (30) ans.
Sur le domaine public, l’occupation prolongée ne constituera jamais une acquisition de la propriété par prescription. Le principe de l’imprescriptibilité est une protection efficace destinée à garantir l’affectation et ne souffre d’aucune exception.
CHAPITRE 2 : LES MODES D’ACCES AU DOMAINE DU FONCIER RURAL
Ces modes varient selon que l’on se situe dans les domaines privés et concédé (Section 1) ou dans le domaine foncier coutumier (Section 2).
Section 1 : L’acquisition d’une terre dans les domaines privés et dans le domaine concédé
L’acquisition d’une terre est différente selon qu’on se trouve dans les domaines privés (Paragraphe 1) ou dans le domaine concédé (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L’acquisition dans les domaines privés des personnes publiques et des personnes privées.
La notion de domaine privé en droit foncier implique la propriété foncière c’est-à-dire les droits d’usus, de fructus et d’abusus sur la terre. Ceci suppose que la terre qui va faire l’objet d’un transfert de la propriété (cession) ou d’un transfert du droit d’usage (location ou concession) a été immatriculée au nom du cédant ou du concédant (le propriétaire). A l’intérieur du domaine privé, il faut faire la différence entre le domaine privé des personnes publiques (A) et le domaine privé des personnes privées (B).
A- L’acquisition dans le domaine privé des personnes publiques
L’acquisition d’une terre dans le domaine privé des personnes publiques met en présence un propriétaire qui est une personne publique, notamment l’État et les collectivités territoriales et un acquéreur qui, lorsqu’il s’agit d’une acquisition définitive est un particulier, et, lorsqu’il s’agit d’une location, peut-être une personne morale de droit privé. Ici donc, comme cela a déjà été signalé, le droit de propriété (par le biais de l’immatriculation au livre foncier) existe déjà sur la parcelle qui est partie inhérente d’un domaine prive. Il s’agit de transférer ce droit de propriété du domaine privé d’une personne publique au domaine privé d’une personne privée ou d’en transférer le droit d’usage par le biais d’un bail. Pour comprendre le processus, il faut définir la composition, le processus de constitution et les modes de gestion du domaine privé des personnes publiques avant d’aborder le contentieux.
a) La Composition et définition
Le domaine privé des personnes publiques est composé des biens d’une personne publique qui ne sont pas affectés à l’usage direct du public ou du service public. Non défini de façon positive et exhaustive, le domaine privé des personnes publiques est constitué, selon Bonnard, des « Propriétés administratives, qui n’étant pas à l’usage de tous, ne sont, par ailleurs, pas affectées à un service public déterminé pour être utilisées ou consommées par ce service » Par ailleurs, si l’on se réfère au droit français dont le droit ivoirien est issu, font également partie du domaine privé, par détermination de la loi : les immeubles à usage de bureaux, à l’exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public ; les réserves foncières; les chemins ruraux ; les bois et forêts relevant du régime forestier (article 22 code forestier 2019 : le domaine forestier privé de l’Etat est composé des forêts classées, des agro-forêts, des forêts acquises ou crées dans le domaine rurale par l’Etat et des jardins botanique). b) Constitution
La constitution du domaine privé se fait comme pour le domaine privé d’une personne privée, c’est-à-dire par achat, échange, donations ou legs. Les acquisitions à l’amiable d’immeubles ou de meubles à titre onéreux font l’objet de contrats d’achat public, qui sont l’équivalent du contrat de vente des articles 1582 et suivants du code civil. Les contrats par lesquels les collectivités publiques acquièrent à l’amiable des biens immeubles sont de droit privé et se voient donc appliquer l’ensemble des règles du droit civil. Selon le droit français, l’État peut, en outre, constituer son domaine privé, en procédant à la nationalisation ; à l’expropriation ; ou encore à l’exercice d’un droit de préemption. Par ailleurs, par le biais du déclassement et de la désaffectation, un bien du domaine public peut tomber dans le domaine privé. Concernant les biens sans maître, les successions tombées en déshérence et les libéralités, le droit français permet que ces biens soient intégrés dans le domaine privé des personnes publiques, mais en droit ivoirien, l’article 539 du code civil n’envisage leur intégration que dans le Domaine Public.
c) Les règles de gestion du Domaine privé de l’État
Le domaine privé, en tant que propriété d’une personne publique, est soumis à l’insaisissabilité des biens, même s’il est aliénable. En tant que tel, il est aussi soumis à l’interdiction de cession à vil prix, bien que relevant du code civil. Toutefois, le domaine privé n’est pas entièrement soumis au Code civil et certaines règles lui sont propres, comme le fait que la cession ou la concession d’un bien du domaine prive obéit à plusieurs conditions, notamment, l’évaluation du bien. En droit ivoirien, l’Administration gère librement les terres du Domaine Foncier Rural immatriculées en son nom (art. 21 de la loi de 1998), dans le cadre de contrats conclus directement entre l’Administration et les personnes concernées (art. 22). Les procédures varient selon qu’il s’agit d’une cession ou d’un bail. La cession des biens relevant du domaine privé d’une personne publique : La cession des biens et droits mobiliers du domaine privé de l’Etat qui ne sont plus utilises est autorisée. Cette cession est soumise aux exigences de publicité et de mise en concurrence et réalisée soit par adjudication publique, soit par voie de marchés d’enlèvement. La cession amiable reste possible notamment pour un motif d’intérêt général. Des régimes spéciaux sont applicables aux biens meubles de caractère historique, artistique, ou scientifique ainsi qu’aux cessions de terrains de l’État. Contrairement à l’État, les collectivités territoriales ne sont pas soumises à des obligations de publicité et de mise en concurrence avant toute cession de leurs biens immobiliers, sauf lorsque la collectivité décide elle-même de s’y soumettre ou lorsque les contrats de vente immobilière des collectivités territoriales sont couplés avec des contrats de commande publique. L’acte par lequel une personne publique cède un bien de son domaine privé est un acte administratif créateur de Droit. En droit foncier rural ivoirien, cet acte est un Acte de Concession Définitive (ACD), similaire à celui qui est pratiqué dans le droit foncier urbain. En effet, en l’absence d’acte spécifique.
En droit foncier rural ivoirien, cet acte est un Acte de Concession Définitive (ACD), similaire à celui qui est pratiqué dans le droit foncier urbain. En effet, en l’absence d’acte spécifique au foncier rural, l’administration est contrainte à délivrer un ACD pour toutes les cessions de terres du domaine privé de l’Etat. Les baux sur les biens relevant du domaine privé d’une personne publique : Les personnes publiques ont la possibilité de conclure avec un opérateur des contrats de location. Ces contrats sont à durée déterminée et comportent obligatoirement des clauses de mise en valeur. Par ailleurs, la location des terres du Domaine Foncier Rural de l’État est consentie moyennant paiement d’un loyer dont les bases d’estimation sont fixées par la loi de Finances (article 19 de la loi de 2019 modifiant la loi de 1998). Il peut s’agir de baux simples ou des baux emphytéotiques. Les baux simples couvrent une large gamme : bail commercial, bail professionnel, bail à construction, bail à réhabilitation, bail rural. Le bail emphytéotique se distingue par sa longue durée. L’acte par lequel une personne publique accorde une concession (provisoire) sur un bien de son domaine privé est un acte administratif créateur de Droit. Il s’agit bien souvent d’un Bail Emphytéotique conclu pour une durée comprise entre 18 et 99 ans. Si l’on s’en tient aux règles du Bail Emphytéotique Administratif (conclu sur le domaine Public), il peut être reconduit dans la limite de cette durée totale de 99 ans, mais pas de façon tacite Quoiqu’il en soit, la cession de terres ou la location d’une terre du domaine privé d’une personne publique est conditionnée par une décision de son organe délibérant. Cette décision doit être portée à la connaissance des administrés intéressés par l’effet d’une publicité adaptée, qui conditionne le caractère exécutoire de l’acte pris par la personne publique.
Concernant le contentieux de la transaction sur les biens du domaine privé d’une personne publique :
L’article 22 de la loi de 1998 relative au Domaine foncier Rural prévoit qu’en cas de non-respect des clauses du contrat de bail, le contrat est purement et simplement résilié ou ramené à la superficie effectivement mise en valeur. Par ailleurs, précise l’article 23 de la loi de 2019 modifiant la loi de 1998, en cas de non-paiement du loyer les impenses réalisées par le locataire constituent le gage de l’état dont les créances sont privilégiées même en cas d’hypothèque prise par des tiers ; et cela, outre les poursuites judiciaires qui peuvent être menées contre lui. Concernant ces poursuites judiciaires, le principe est que le contentieux de la gestion du domaine privé appartient au juge judiciaire. Toutefois, en ce qui concerne les biens immobiliers (dont fait partie le foncier), le Tribunal des conflits en France a précisé que les litiges relatifs aux contrats de vente de biens immobiliers appartenant au domaine privé de l’État relèvent de la compétence du juge administratif. De même, c’est le juge administratif qui est compétent, lorsque le litige survient à propos de la délibération qui autorise la conclusion d’un bail emphytéotique. Par ailleurs, c’est le juge administratif qui s’avère compétent lorsque le contrat portant occupation du domaine privé contient des clauses exorbitantes de droit commun. Tout comme, il demeure compétent pour l’annulation de tous les actes administratifs relatifs à cette occupation du domaine privé.
B- L’acquisition dans le patrimoine des personnes privées
L’acquisition d’une terre dans le domaine privé des personnes privées met en présence un propriétaire qui est une personne privée, et un acquéreur qui, lorsqu’il s’agit d’une acquisition définitive est un particulier, et, lorsqu’il s’agit d’une location, peut-être une personne morale de droit privé. Ici donc (comme dans le paragraphe précédent), le droit de propriété existe déjà sur la parcelle qui a été immatriculée au nom du cédant ou du concédant et qui constitue, avec les autres biens de ce dernier, son domaine privé. Il s’agit maintenant de transférer ce droit de propriété du domaine de ce propriétaire au domaine d’une autre personne privée ou d’en transférer le droit d’usage par le biais d’un contrat de bail. Pour comprendre le processus, il faut définir la composition, le processus de constitution et les modes de gestion du domaine privé des personnes publiques avant d’aborder le contentieux. a) Composition et définition
Le domaine privé d’une personne privée physique ou morale est son patrimoine, c’est à dire l’ensemble des biens et des obligations appréciables en argent et dans lequel entrent les actifs (valeurs et créances) ainsi que les passifs (dettes et engagements). Le patrimoine, envisagé dans sa généralité, implique donc les propriétés financières, foncières, meubles et immeubles (intellectuelles aussi, quand il y en a) de la personne. b) Constitution
La constitution du domaine privé d’une personne privée physique ou morale se fait par achat, échange, donations ou legs, ou à la suite d’une décision de justice. Les acquisitions d’immeubles ou de meubles à titre onéreux font l’objet d’un contrat de vente des articles 1582 et suivants du code civil. c) Les règles de gestion du Domaine privé de l’État
Le domaine privé, en tant que propriété d’une personne publique, est soumis à l’insaisissabilité des biens, même s’il est aliénable. En tant que tel, il est aussi soumis à l’interdiction de cession à vil prix, bien que relevant du code civil. Toutefois le domaine privé n’est pas entièrement soumis au Code civil et certaines règles lui sont propres, comme le fait que la cession ou la concession d’un bien du domaine privé obéit à plusieurs conditions, notamment, l’évaluation du bien. En droit ivoirien, l’Administration gère librement les terres du Domaine Foncier Rural immatriculées en son nom (art. 21 de la loi de 1998), dans le cadre de contrats conclus directement entre l’Administration et les personnes concernées (art. 22). Les procédures varient selon qu’il s’agit d’une cession ou d’un bail. La cession des biens relevant du domaine privé d’une personne publique : La cession des biens et droits mobiliers du domaine privé de l’État qui ne sont plus utilisés est autorisée. Cette cession est soumise aux exigences de publicité et de mise en concurrence et réalisée soit par adjudication publique, soit par voie de marches d’enlèvement. La cession amiable reste possible notamment pour un motif d’intérêt général. Des régimes spéciaux sont applicables aux biens meubles de caractère historique, artistique, ou scientifique ainsi qu’aux cessions de terrains de l’État. Contrairement à l’État, les collectivités territoriales ne sont pas soumises à des obligations de publicité et de mise en concurrence avant toute cession de leurs biens immobiliers, sauf lorsque la collectivité décide elle-même de s’y soumettre ou lorsque les contrats de vente immobilière des collectivités territoriales sont couplés avec des contrats de commande publique. L’acte par lequel une personne publique cède un bien de son domaine privé est un acte administratif créateur de Droit. L’augmentation du patrimoine d’une personne privée obéit aux mêmes règles que celles qui président à leur réduction.
d) Les règles de gestion du patrimoine d’une personne privée
Les biens du patrimoine d’une personne privée sont divisibles en trois catégories : droits réels, droits personnels, droits intellectuels. Les droits fonciers font partie des droits réels. Le droit de propriété foncière permet à son titulaire de retirer toutes les utilités économiques de la terre en usant de trois prérogatives : L’usus ou le fait d’utiliser la chose ; le fructus ou le droit d’en retirer les fruits ; et enfin l’abusus, c’est-à-dire le droit d’en faire ce qu’il veut. Les biens fonciers sont donc saisissables par voie judiciaire, transmissibles après la mort et cessibles du vivant de son propriétaire.
Paragraphe 2 : L’acquisition dans le domaine concédé et « Les terres sans maître »
Le domaine concédé, en tant que catégorie du domaine foncier rural, est prévu par l’article 2 de la loi de 1998 Ce domaine est constitué des terres concédées par l’Etat à titre provisoire antérieurement à la date de publication de la loi (art.3). Il s’agit donc de l’ensemble des terres que l’État a attribué à des personnes par le biais d’actes administratifs de « lettres d’attribution », de « Concessions provisoires » Ou encore de « permis d’occupation immatriculation préalable de ces terres en son propre nom ce qui est une aberration en soit. Cela signifie, en effet, que l’État a accordé des concessions sur des parcelles dont il n’était pas propriétaire. Toute la procédure de consolidation des droits sur le domaine concédé vise donc à réparer cette aberration.
Selon l’article 6 nouveau, en effet, les terres qui n’ont pas de maître appartiennent à l’État qui les gère librement. Ces terres sans maître sont les terres objet d’une succession ouverte depuis plus de trois ans, non réclamées ; les terres du domaine coutumier sur lesquelles les droits coutumiers exercés de façon paisible et continue n’ont pas été constatés dans un délai non encore défini ; ainsi que les terres concédées sur lesquelles les droits du concessionnaire n’ont pu être consolidés dans un délai non encore défini. Le défaut de maître doit être constaté par décret pris en Conseil des Ministres. En cas de demande d’accès faite par une personne sur ces terres sans maître, les conditions d’accessibilité s’avèrent très proches de celles prévues pour le domaine concédé. Ainsi, outre le fait que ces terres sont immatriculées au nom de L’État qui les vendra ou les donnera à bail selon le statut du demandeur, celui-ci doit supporter les frais d’immatriculation. Aussi, en l’absence du décret d’application prévu pour les Terres sans Maîtres, nous nous en tiendrons à la procédure définie par le décret d’application pour les Terres du Domaine concédé pour se faire une idée de celle qui prévaut actuellement pour les terres sans maître. En effet, si la loi de 1998 pose dans ses articles 12, 13 et 14 le principe de la nécessité d’immatriculer les terres pour en avoir la pleine propriété, c’est le décret n°2019-265 du 27 mars 2019 qui fixe, dans les détails, la procédure de consolidation des droits des concessionnaires provisoires de terres du Domaine Foncier Rural. La procédure suit les étapes suivantes :
– Un dossier de demande d’immatriculation au Livre Foncier est remis par le concessionnaire au Directeur Général de l’Agence Foncière Rurale (AFOR). Le dossier comprend :
- Une requête rédigée sur papier libre demandait une immatriculation de la terre au nom de l’État avec réattribution (sous forme de vente ou de concession) au demandeur (article 14 de la loi de 1998).
- La copie certifiée conforme de l’acte de concession, o Une fiche de renseignements sur l’identité du demandeur,
- Le dossier technique d’immatriculation élaboré par un géomètre-expert agréé dont les spécifications sont précisées par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Agriculture et du Ministre chargé du Budget. o Le fichier numérique du plan du bien foncier.
- Le dossier de demande d’immatriculation est transmis par le Directeur de l’Agence Foncière Rurale, pour appréciation, au Conservateur de la propriété foncière et des Hypothèques qui, après acceptation, en publie l’avis au Journal Officiel, ainsi que par affichage dans des endroits clés de la localité abritant la parcelle concernée. Les affiches sont maintenues pendant une durée de 3 mois.
- Un procès-verbal de clôture de publicité constate l’absence d’oppositions. En cas contestation ou de réclamation, le Sous-préfet qui entreprend des négociations entre les parties en litige. A défaut d’accord amiable, le litige est soumis à la décision d’une Commission spéciale présidée par le préfet de Département. – En cas de non-opposition ou après règlement des litiges le Directeur Général de l’AFOR transmet les certificats d’affichage, les procès-verbaux de clôture de publicité et les actes de règlement des litiges au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques pour immatriculation du bien foncier au nom de l’Etat.
- Les terres immatriculées au nom de l’État sont données à bail ou vendues à l’ancien concessionnaire s’il remplit les conditions d’acquisition de la propriété. L’article 14 de la loi de 1998 fait obligation au requérant de l’immatriculation de demander une réattribution (sous forme de vente ou de concession). Lorsque Cette demande est faite, le requérant bénéficie alors d’une sorte de droit de préemption sur la réattribution de la parcelle immatriculée au nom de l’État. Évidemment, celui-ci conserve ses prérogatives de puissance publique, comme cela est précisé à l’article 21 de la loi de 1998. Dans le domaine foncier coutumier, l’acquisition d’une terre obéit à une procédure bien plus complexe.
Section 2 : L’accession à la propriété d’une terre dans le domaine foncier coutumier
Le Domaine Foncier Coutumier est constitué par l’ensemble des terres sur lesquelles s’exercent des droits coutumiers conformes aux traditions et des droits coutumiers cédés à des tiers. Il s’agit donc des terres sur lesquelles s’exercent des droits conformes aux coutumes précoloniales ainsi que les terres sur lesquelles ces droits coutumiers ont été cédés sur la base de contrats sous-seing privées à caractère définitif (lesquels contrats sont désormais interdits par l’article 17 bis de la loi de 2019 modifiant la loi de 1998 relative au domaine Foncier rural). L’acquisition d’une terre dans le Domaine Foncier Coutumier implique une procédure de constat de droits coutumiers (Paragraphe 1) donnant lieu à un certificat foncier puis a une immatriculation au livre foncier (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La procédure de constat des droits coutumiers
Bien que la loi indique une procédure d’établissement des droits fonciers ruraux, ce sont les décrets n°2019264 du 27 mars 2019 portant organisation et attribution des comités sous-préfectoraux de gestion foncière rurale et des comités villageois de gestion foncière rurale et n°2019-266 du 27 mars 2019 fixant les modalités d’application du Domaine Foncier Rural Coutumier de la loi n°98-750 du 23 décembre 1998, qui en donnent les détails. La procédure connaît deux grandes étapes. Une première étape qui consiste à établir les droits coutumiers, et une deuxième qui tend à les traduire en droits légaux afin d’en permettre la transmission.
A- L’enquête de constat ou le début de la procédure
Le législateur prévoit le déroulement de l’enquête, ainsi que les structures habilitées à la mener.
1- Les structures habilitées à réaliser l’enquête
Selon l’article 7 de la loi de 1998, les droits coutumiers sont réalisés après une enquête officielle menée par les autorités administratives ou leurs délégués, et les conseils des villages concernés. Les décrets d’application de mars 2019 viennent indiquer la création de deux comités de gestion foncière rurale : un à l’échelle de la souspréfecture : le Comité Sous-Préfectoral Gestion Foncière Rurale (CSPGFR) et un deuxième à l’échelle villageoise : le Comité Villageois de Gestion Foncière Rurale (CVGFR).
Concernant le comité sous-préfectoral (CSPGFR) : il est créé par arrêté du Préfet du département. Présidé par le Sous-préfet, il comprend :
Avec voix délibérative :
- Un représentant de l’Agence Foncière Rurale,
- Un représentant du Ministère en charge de la Forêt,
- Un représentant du Ministère en charge de l’Urbanisme,
- Un représentant du Ministère en charge des Infrastructures Économiques,
- Un représentant du service du Cadastre,
- Six représentant des villages des autorités coutumières désignés sur proposition des populations pour une durée de trois ans renouvelables.
Avec voix consultative :
- Les personnes concernées par les questions devant faire l’objet des délibérations du Comité, notamment des représentants des comités villageois tels que prévus à l’article 9 ci-après et des exploitants des terres rurales, toute personne utile à la bonne fin des travaux du Comité.
- Le CSPGFR est compétent pour délibérer sous forme d’avis conformes sur :
- La validation des enquêtes officielles de constat de droits fonciers coutumiers,
- Les oppositions ou réclamations survenant au cours des procédures d’immatriculation des terres du
Domaine Foncier Rural concédé, o Les conflits non résolus au cours des enquêtes foncières.
Il délibère aussi, sous forme d’avis simples sur les implications foncières des différents projets de développement rural, projets d’urbanisation ou projets de reboisement, ainsi que sur toute question relative au Domaine Foncier Rural.
Concernant le comité villageois (CVGFR) : il est créé par le sous-préfet et composé de onze membres au moins et de seize membres au plus. Parmi ses membres, le CVGFR comprend nécessairement :
- Le chef du village ou son représentant,
- Le chef de terre ou son représentant,
- Les chefs de lignages ou les chefs des grandes familles,
- Les représentants des communautés,
- Un représentant de la jeunesse,
- Une représentante des femmes,
Les autres membres sont ceux dont la présence ost considérée comme utile à la bonne fin des travaux du comité. La Vocation générale du CVGFR, est « l’étude de toutes questions relatives à la gestion du foncier rural dans leur ressort territorial ». Son rôle est donc assez large, même si le décret n°2019-264 du 27 mars 2019 précité, n’énumère que ses missions dans le cadre de la procédure de constat des droits coutumiers pour laquelle il intervient à toutes les étapes, des enquêtes à la transmission du dossier de constat d’existence continue et paisible des droits coutumiers objets de la procédure. Le CVGFR tient par ailleurs, a jour, un registre foncier villageois pour enregistrer toutes les informations foncières concernant le village. Leur fonction essentielle est directement liée à la procédure d’établissement des droits fonciers et leur rapport valide ou invalide les enquêtes officielles de constat des droits coutumiers. C’est sur la base de ce rapport que les préfets de département prendront la décision finale de reconnaissance ou non de la détention coutumière.
2- Le déroulement de l’enquête
Il est défini par Décret n°2019-266 du 27 mars 2019 fixant les modalités d’application du Domaine Foncier Rural Coutumier de la loi n°98-750 du 23 décembre 1998. Elle se déroule en Cinq étapes :
L’intention expresse d’établir les droits fonciers (articles 1 et 2) :
- Soit par une demande individuelle ou collective de la communauté villageoise), adressée au sous-préfet.
- Soit par la mise en œuvre d’un programme public d’intervention.
La désignation d’un commissaire-enquêteur.
- Il est désigné par l’AFOR à partir de la liste nationale des Commissaires-enquêteurs préétablie par l’AFOR). – En cas d’opération groupée, le Commissaire-enquêteur est celui qui est proposé par le titulaire du marché d’exécution de cette opération groupée, sous réserve de figurer sur la liste nationale.
- L’ouverture de l’enquête est publiée et relayée de tout façon utile.
- Le commissaire-enquêteur constitue une équipe d’enquête qui comprend : o Un représentant du Conseil de village ou de la Notabilité, o Un représentant du Comité Villageois de Gestion Foncière Rurale, o Les voisins limitrophes, o Le demandeur toute personne utile à la bonne fin de l’enquête.
L’enquête aboutit à :
- La constitution d’un dossier de délimitation,
- La réalisation d’un dossier de délimitation qui comprend deux documents : o Un plan du bien foncier, qui est établi et signé par l’opérateur technique agréé. o Un constat des limites, qui est consigné dans un formulaire signé par l’opérateur technique agréé et par les parties présentes.
- L’établissement d’un procès-verbal de recensement des droits coutumiers auquel est annexé : o Une fiche démographique, visant à recenser les personnes concernées par l’enquête. o Un dossier foncier comprenant un questionnaire et de déclaration du demandeur. o En cas de droits coutumiers collectifs, la liste exhaustive des détenteurs de ces droits. o Un dossier des litiges fonciers identifiés comprenant les déclarations des parties en conflit signées par celles-ci.
- Un état des droits de propriété ou des droits de concession ou d’occupation accordés par l’Administration, ainsi que toute pièce utile à l’enquête.
- La liste des servitudes et droits d’usage, leur nature et le nom ou la caractérisation des détenteurs du droits. o Les déclarations de toutes les personnes auditionnées au cours de l’enquête.
La validation des résultats
Elle vient clore les enquêtes de constat des droits coutumiers. Elle est prévue en trois étapes :
- Une phase préparatoire de publicité dans les villages concernés. La publicité est effectuée par le commissaire enquêteur sous l’autorité du Comité Villageois de Gestion Foncière Rurale sur une période d’un mois, avec une séance publique de présentation des résultats, suivie par l’enregistrement d’éventuelles oppositions et une séance publique de clôture.
- En l’absence de litige, un « procès-verbal de publicité » est dressé, à partir duquel le comité villageois de gestion foncière établira le « constat d’existence continue et paisible de droits coutumiers. » En cas de litige, un règlement amiable est tenté par le CVGFR d’abord, puis par l’autorité villageoise en cas de désaccord persistant avant d’être porté devant le sous-préfet qui tranche en dernier recours.
- Le dossier complet est adressé préfectoral de Gestion Foncière Rurale pour validation, notification au demandeur et transmission à l’Agence Foncière Rurale pour exploitation.
L’enquête constatant l’existence « continue et paisible des droits coutumiers, donne lieu à la délivrance d’un certificat foncier.
Paragraphe 2 : Le certificat foncier et l’immatriculation
Le certificat foncier vient constater les droits coutumiers (A) avant qu’ils ne soient transformés dans une dernière étape en droit de propriété privée par le biais de l’immatriculation (B).
A- Établissement du Certificat Foncier
Le Certificat Foncier est, sans aucun doute, l’une des innovations majeures de la loi de 1998. Bien que sa nature et sa forme restent à ajuster (1), la procédure d’établissement elle est plutôt précise (2).
1- Une nature et une forme à ajuster
A la vérité, c’est la nature qui mérite surtout d’être précisée, notamment depuis la loi modificative de 2019. Il est important d’insister, en effet sur le fait que cette loi a apporté un changement radical a la loi de 1998 en modifiant la nature juridique du certificat foncier. Celui-ci n’est plus un droit de propriété comme dans la version précédente. Désormais le Certificat Foncier (CF) est le constat des droits coutumiers.
En revanche, la loi ne se prononce pas plus que ça sur la nouvelle nature de ces droits coutumiers, laissant ainsi un vide juridique. En effet, il va de soi de se demander quels droits réels coutumiers le CF constate-t-il ? S’il ne s’agit plus de droit de propriété, s’agit-il désormais de droits d’usufruits, de droits de détention, de droits de possession, de droits d’occupation, de simples droits d’usage etc. ? IL importe que cette question soit résolue pour ne pas en ajouter aux causes de confusion dans l’application de la loi.
Pour la forme du certificat collectif, la nouvelle loi apporte quelque changement, notamment pour ce qui concerne le certificat foncier collectif. Il faut savoir, en effet, que le certificat foncier peut être individuel ou collectif. Le CF est individuel lorsqu’il est établi au nom d’un seul individu. Il devient collectif lorsqu’il est établi au nom d’entités publiques ou privées dotées de la personnalité morale. Toutefois, c’est là l’étrangeté de cette loi modificative, ils peuvent être établis au nom de groupements de personnes physiques dûment identifiées et non dotés de la personnalité morale. En effet, on se demande comment une entité non dotée d’une personnalité juridique peut être détentrice de droits et les faire valoir. A moins, évidement, que par cette formule, le législateur entend une sorte d’indivision où chaque membre serait responsable juridiquement de sa quotepart. Pour ce qui est de l’accessibilité, le certificat foncier est accessible à tous. Il est bon de rappeler que c’est son accessibilité à tous, sans condition de nationalité ou de personne physique (conditions de la propriété dans le domaine foncier rural émises par l’article 12 de la constitution et l’article 1 de la loi de 1998) qui a justifié en grande partie la révision de la loi, car, en tant que droit de propriété, le certificat foncier en devenait inconstitutionnel. Désormais conforme à la constitution, même si sa nature reste à préciser, le certificat foncier s’établit selon une procédure particulière.
2- La procédure d’établissement du Certificat Foncier
La procédure d’établissement du certificat foncier est régie par le décret n°2019-266 du 27 mars 2019 fixant les modalités d’application du Domaine Foncier Rural Coutumier de la loi n°98-750 du 23 décembre 1998. On a vu dans le paragraphe relatif aux enquêtes de constat des droits coutumiers, que le dossier de validation de l’enquête officielle était transmis à l’Agence Foncière Rurale. Celle-ci se charge alors, après contrôle, de préparer le Certificat Foncier qui est soumis à la signature du Préfet de Département, en deux exemplaires originaux. On le voit, l’AFOR prépare le CF, mais ne le signe pas. C’est le PRÉFET qui signe le CF.
Le certificat foncier peut être individuel ou collectif. Il est individuel lorsqu’il est établi au nom d’une seule personne. Le certificat foncier est timbré aux frais du titulaire et enregistré par le Préfet qui en conserve un exemplaire original. Le second original est remis :
- Soit au titulaire lui-même ou à son représentant porteur d’un mandat spécial légalisé par le sous-préfet, dans le cas d’un certificat individuel ;
- Soit au représentant légal de la personne morale titulaire ;
- Soit au gestionnaire du groupement informel désigné par les membres dudit groupement dont la liste est jointe au Certificat. Une copie du certificat foncier est conservée dans le système d’informations foncières tenu par l’Agence Foncière Rurale. En cas de perte d’un exemplaire original du certificat foncier, une copie conforme sera délivrée par le Préfet ou par le Directeur Général de L’Agence Foncière Rurale ; mention en sera portée dans le système d’information foncière.
Le plan du bien foncier est joint au Certificat Foncier. Un cahier des charges signé par le titulaire et le Préfet du Département est annexé au Certificat Foncier. Il précise s’il y en a :
- La liste des occupants de bonne foi non admis au bénéfice du certificat foncier mais titulaires d’un bail. – L’existence de servitudes particulières ou d’infrastructure réalisées par l’État ou par des tiers et dont l’usage est réglementé ;
- Les conditions d’immatriculation au Livre Foncier
Le Certificat Foncier est ensuite publié au Journal Officiel par le Directeur Général de l’Agence Foncière Rurale. Concernant la Gestion du Certificat Foncier, elle est assez complexe. En effet, alors même que la nature juridique du certificat foncier a changé et que celui-ci n’est plus un droit de propriété, le titulaire du certificat foncier peut user de son certificat comme un propriétaire. Ainsi, le certificat foncier confère à son titulaire la capacité d’ester en Justice et d’entreprendre tous actes de gestion relative au bien foncier concerné. De même, le certificat foncier est transmissible, cessible et morcelable ; plusieurs certificats fonciers peuvent être aussi fusionnés. Ces actes doivent être consacrés par un acte authentifié par l’autorité administrative. Par ailleurs, dans tous ces cas ou le titulaire du certificat et/ou les dimensions de la parcelle certifiée changent, de nouveaux certificats fonciers sont établis avec le nom des nouveaux titulaires et/ou les nouvelles dimensions. Dans le cas spécifique du certificat foncier collectif, ce morcellement ne peut se faire qu’au profit des membres du groupement. Le bien foncier objet d’un Certificat foncier peut, par ailleurs, faire l’objet d’un contrat de location.
B- L’immatriculation au livre foncier
C’est l’ultime étape de la procédure d’appropriation d’une terre du domaine foncier coutumier. En effet, une fois sa parcelle certifiée, le titulaire du certificat foncier est tenu de requérir (dans un délai qui sera défini par décret). Alors seulement il pourra se prévaloir de la propriété sur cette parcelle. La procédure d’immatriculation des terres objet de Certificats Fonciers sera définie par un décret actuellement en préparation. En attendant, quiconque, titulaire d’un certificat foncier doit avant s’assurer qu’il respecte les conditions de la propriété soit la nationalité ivoirienne d’une part et d’autre part, le fait d’être une tout personne physique ou une personne morale de droit public, soit l’État ou une collectivité territoriale. Rappelons que cette double exigence est posée, à la fois par l’article 1 de la loi de 1998 modifiée par la loi de 2019, et par l’article 12 de la constitution ivoirienne de 2016 modifiée par la loi constitutionnelle de 2020. En l ‘absence de décret d’immatriculation, il faut considérer que tout demandeur d’immatriculation dans le Domaine foncier rural se verra soumis à la procédure fixée par le décret de 1932.
- Le dossier de demande d’immatriculation est transmis au Conservateur de la propriété Foncière et des Hypothèques qui, après approbation du service du cadastre, en publie l’avis au Journal Officiel ou dans un journal d’annonce légale. L’avis d’immatriculation fait l’objet d’une publicité par affichage pendant une période de 3 mois au cours desquels les conservation contestations et réclamations sont reçues, sous forme d’opposition, au service du cadastre et de la foncière.
- Un procès-verbal de clôture de publicité constate l’existence ou l’absence d’oppositions.
- En l’absence ou à l’épuisement de toute opposition le géomètre assermente du cadastre réalise un contrôle du rapport technique du certificat foncier par un contrôle du système de mesure ou, si cela s’avère nécessaire, par un bornage contradictoire.
- Le géomètre assermenté produit un rapport technique un procès-verbal de confirmation ou d’infirmation du dossier technique du certificat foncier.
- En cas de confirmation du dossier technique du certificat foncier, le conservateur inscrit la parcelle dans le livre foncier.
- En cas d’infirmation du dossier technique du certificat foncier, le rapport technique du cadastre s’impose sur celui du certificat foncier.
- L’immatriculation est réalisée au nom du titulaire du certificat foncier s’il remplit les conditions d’accès à la propriété prévue à l’article 1 de la loi relative au Domaine foncier rural.
- L’immatriculation est réalisée au nom de l’État si le titulaire du certificat foncier ne remplit pas les conditions d’accès à la propriété prévues à l’article 1 de la loi relative au Domaine foncier rural. Dans ce cas, les terres immatriculées au nom de L’État sont données à bail au titulaire du certificat foncier, dans le respect des dispositions en vigueur.
- Le conservateur transmet un état foncier de la parcelle immatriculée au Directeur Général de l’Agence Foncière Rurale pour établissement de l’acte de propriété foncière.
- Les dossiers suspendus pour cause d’oppositions jugées sérieuses par le conservateur sont renvoyés devant le juge du tribunal compétent.
Section 3 : L’accession à la terre rurale par le biais de la contractualisation foncière
La contractualisation, c’est le fait de rendre contractuel, c’est- à-dire lié à un contrat. Or en droit, un contrat est un accord de volontés concordantes entre une ou plusieurs personnes en vue de créer une ou des obligations juridiques. C’est aussi la relation juridique qui découle de cet accord. Dès lors il est possible de contracter sur les terres du domaine foncier rural.
A cet effet, nous avons le bail emphytéotique. L’emphytéose » ou bail emphytéotique » est une convention de bail portant sur une terre rurale et consenti pour une durée comprise entre 18 et 99 ans. Il confère au preneur un droit réel sur la terre donnée à bail (c’est-à-dire qu’il peut l’hypothéquer, le louer ou le sous-louer), à charge pour lui d’améliorer le fonds en échange d’un loyer modique.
La caractéristique de l’emphytéose réside dans le fait qu’en compensation d’une redevance très modeste, sans qu’il ait à indemniser le locataire (appelé emphytéote), en fin de contrat le bailleur devient propriétaire des améliorations et des constructions que le locataire a faites pendant la durée du bail.
En ce qui concerne l’obtention d’un bail emphytéotique, notons que l’emphytéose est soumise pour tout ce qui concerne sa constitution et son usage ainsi que les droits et devoirs réciproques des parties aux dispositions de la loi du 25 Juin 1902[52] qui est déclarée applicable en Afrique Occidentale Française.
L’emphytéose est soumise pour tout ce qui concerne sa constitution et son usage ainsi que les droits et devoirs réciproques des parties aux dispositions de la loi du 25 Juin 1902 gui est déclarée applicable en Afrique Occidentale Française.
Loi du 25 Juin 1902
Le Bail Emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque ; ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. Ce bail doit être consenti pour plus de dix-huit année et ne peut dépasser quatre-vingt-dix-neuf ans ; il ne peut se prolonger par tacite reconduction.
Le Bail Emphytéotique ne peut être valablement consenti que par ceux qui ont le droit d’aliéner, et sous les mêmes formes. Les immeubles appartenant aux mineurs ou interdits pourront être donnés à bail emphytéotique en vertu d’une délibération du conseil de famille homologuée par le tribunal. Le mari pourra aussi donner à bail emphytéotique les immeubles dotaux avec le consentement de la femme et l’autorisation de justice.
La preuve du contrat d’emphytéose s’établira conformément aux règles de code civil en matière de baux. A défaut de conventions contraires, il sera régi par les dispositions suivantes.
Le preneur ne peut demander la réduction de la redevance pour cause de perte partielle du fonds, ni pour cause de stérilité ou de privation de toute récolte à la suite de cas fortuits.
A défaut de payement de deux années consécutives, le bailleur est autorisé, après une sommation restée sans effet, à faire prononcer en justice la résolution de l’emphytéose. La résolution peut également être demandée par le bailleur en cas d’exécution des conditions du contrat ou si le preneur a commis sur le fonds des détériorations graves. Néanmoins, les tribunaux peuvent accorder un délai suivant les circonstances.
Le preneur ne peut se libérer de la redevance ni se soustraire à l’exécution des conditions du bail emphytéotique en délaissant le fonds.
Le preneur ne peut opérer dans le fonds aucun changement qui en diminue la valeur. Si le preneur a fait des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur du fonds, il ne peul les détruire ni réclamer à cet égard aucune indemnité.
Le preneur est tenu de toutes les contributions et charges de l’héritage. En ce qui concerne les constructions existant au moment du Bail et celles qui auront été élevées en exécution de la convention, il est tenu des réparations de toute nature ; mais il n’est pas obligé de reconstruire les bâtiments s’il prouve qu’ils ont été détruits par cas fortuit, par force majeure, ou qu’ils ont péri par vice de la construction antérieure du bail. Il répond de l’incendie, conformément à l’article 1733[53] du Code Civil.
L’emphytéote peut acquérir au profit du fonds des servitudes actives, et le grever, par titre, de servitudes passives pour un temps qui n’excède pas la durée du bail et à charge d’avertir le propriétaire.
L’emphytéote profite du droit d ‘accession pendant la durée de l’emphytéose.
En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, le bailleur devra connaitre le droit de l’emphytéote, conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi du 3 Mai 1844. Des indemnités distinctes sont accordées au bailleur ou au preneur.
Le preneur a seul les droits de chasse et de pêche et exerce à l’égard des mines, minières, carrières et tourbières tous les droits de l’usufruitier.
L’acte constitutif de l’emphytéose n’est assujetti qu’aux droits d’enregistrement et de transcription établis pour les baux à ferme ou à loyer d’une durée limitée. Les mutations de toute nature ayant pour objet soit le droit du, bailleur, soit le droit du preneur, sont soumises aux dispositions de la loi de 22 frimaire an VII et des lois subséquentes concernant les transmissions de propriété d’immeubles. Le droit est liquidé sur la valeur vénale déterminée par une déclaration estimative des parties.
La direction du foncier rural a bien conscience de l’importance des contrats et met d’ailleurs à disposition des propriétaires de terres certifiées six modèles de contrats pour les inciter à clarifier les droits entre propriétaire et usager. Cependant, ces contrats sont réservés aux seules terres rurales certifiées qui représentent moins de 4% de l’espace rural. C’est certes une goutte d’eau mais c’est déjà un pas. Nombre de juristes défendent l’idée de réserver la contractualisation aux terres certifiées. La logique semble imparable : sans certificat foncier on ne peut pas être certain que le propriétaire coutumier soit le bon donc il y a un risque. C’est logique. Mais dans la pratique, dans la « vraie vie », que faire des 96% de terres non certifiées ? Doit-on imposer la certification et en faire un préalable absolu ? Ce serait la solution si seulement les villageois pouvaient en supporter le coût écrasant [2]. Comment faire ? Doit-on rester dans le flou ? Suspendu entre le droit et le fait ? Alors que la sécurité passe aussi (même pour les terres certifiées) par le contrat.
Le droit ivoirien autorise et reconnait le contrat. Cette base légale minimale permet un contrat entre propriétaire et usager. Certes, on peut dire que ce contrat comporte un risque : le risque que le prétendu propriétaire coutumier (partie au contrat) ne soit pas le vrai propriétaire. Cependant, comparé au risque d’une transaction orale vague et imprécise, la réponse s’impose il faut faire la promotion de la contractualisation pour réduire les risques sur ces conventions. C’est urgent quand on évalue l’impact sur la réduction des conflits, la cohésion sociale, l’investissement et donc la création de richesse. De nombreux petits papiers sont signés sans certificat foncier et peuvent améliorer la sécurité immédiatement, s’ils sont crédibles.
Comment crédibiliser les contrats sur des terres non certifiées ?
Sensibilisation : Pour qu’un contrat soit fiable, il doit comporter un certain nombre de points : la désignation claire des parties, l’objet (le terrain concerné), la durée, etc. Ainsi, dans une logique de sécurité, au-delà de la campagne de sensibilisation à la certification foncière, il faut aussi faire une sensibilisation à la contractualisation comportant des recommandations claires, sur les points essentiels que doit comporter un contrat. La télévision et les radios locales peuvent toucher massivement les villageois. La Chambre Nationale des Rois et Chefs Traditionnels pourraient également, par te biais de son fin maillage territorial, faire parvenir aux chefs de village des fiches de recommandations claires pour la contractualisation.
Comités villageois de gestion foncière rurale (CVGFR) en action : De plus, au sein des villages, les CVGFR (organes crées par un décret d’application de la loi foncière 98-750 du 23 décembre 1998) peuvent jouer un rôle important dans l’amélioration de la qualité des contrats. Au lieu de les solliciter seulement pour les rares procédures de certification, ils peuvent devenir, avec un minimum de formation, des conseillers à l’élaboration de contrats clairs et à leur archivage. D’ailleurs, la loi les place au cœur de la procédure de certification foncière, qui permet d’identifier clairement le détenteur de droit cela veut dire que dans le cadre des conventions, ils pourront aussi jouer ce rôle et donc crédibiliser le contrat.
Les nouvelles technologies : L’archivage étant une clé de la sécurité, un simple smartphone équipé d’un logiciel de scanner gratuit permet de doubler la procédure d’archivage numérique et papier. Mieux vaut deux qu’un !
CHAPITRE 3 : LES STRUCTURES DE GESTION DES TERRES RURALES
Plusieurs ministères interviennent dans la gestion du domaine foncier rural. A ces structures étatiques (Section 1), il y a lieu d’ajouter les structures associant les populations à la gestion des terres rurales (section 2).
Section 1 : Les structures étatiques ou parapubliques
Les décrets portant attribution des membres du Gouvernement ont toujours confié la gestion du domaine foncier rural au ministre chargé de l’Agriculture (paragraphe 1).
Cette gestion se fait en liaison avec d’autres Ministères concernés par l’utilisation ou l’exploitation des ressources foncières (paragraphe 2).
Pour assurer une meilleure gestion du foncier rural, il a été créé depuis 2016 l’Agence foncière Rurale ou AFOR (paragraphe 3).
Paragraphe 1 : Le Ministère chargé de l’agriculture, gestionnaire du domaine foncier rural
Le Ministère chargé de l’agriculture assure la gestion technique du domaine foncier rural. Il est chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique de gestion du domaine foncier rural et corrélativement de la réglementation qui s’y rapporte. Depuis plusieurs décennies, les décrets successifs portant organisation des Ministères chargés de l’Agriculture ont toujours créé une Direction en charge du foncier rural.
De façon générale, la Direction du foncier rural assure les missions régaliennes de l’Etat qui sont notamment : la gestion du domaine foncier rural de l’Etat, l’élaboration et la mise en œuvre de la réglementation foncière, la participation à la mise en œuvre de stratégies de gestion durable des ressources foncière et dans l’espace rural sans oublier la participation à la mise en place de cadastre rural.
A l’échelle locale, les opérations techniques relatives à la gestion du domaine foncier rural relèvent de la compétence de chaque direction départementale de Ministère chargé de l’agriculture. La direction départementale de l’agriculture est véritablement l’interface entre l’administration territoriale et des usagers.
Paragraphe 2 : Les autres Ministères intervenant dans la gestion du domaine foncier rural
A- Le Ministère chargé de la gestion financière du domaine immobilier de l’Etat
Même si des aménagements organiques peuvent en disposer autrement, la gestion financière du domaine immobilier de l’Etat relève généralement de Ministère de l’Economie et des finances envisagées dans toutes ces composantes classiques dont le budget. L’intervention du Ministre chargé de gestion du domaine immobilier de l’Etat et en particulier des terres rurales revêt un double aspect technique et financier.
Au plan technique, il intervient à travers d’une part, service de la conversation de la propriété financière et de hypothèques et est chargé des formalités d’immatriculation du livre foncier ; il assure également la tenue des actes et plus relatifs aux meubles immatriculés de même que la communication au public de toute information ayant trait à ceux-ci.
L’ensemble de ces tâches sont accomplies par le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques à qui la réglementation assigne trois tâches principales : création des titres fonciers, inscription sur lesdits titres de droits réels y afférant et conservation des documents d’archives relatifs aux titres fonciers créés.
Quant au service du cadastre, son rôle consiste à constituer des documents officiels qui donnent des informations sur le patrimoine immobilier national.
A ce titre, plusieurs missions lui sont assignées : créer et conserver le cadastre en zones urbaines et rurales, coordonner les activités cadastres des services extérieurs de la Direction Générales des impôts, coordonner les opérations d’assiette, contrôler l’impôt foncier, etc.
Au plan financier, le ministère chargé de la gestion du domaine immobilier de l’Etat perçoit les produits découlant des ventes et locations des biens fonciers ruraux de l’Etat. De même, il définit l’assiette de l’impôt foncier et assure son recouvrement.
B- Le Ministère chargé de l’intérieur et de la décentralisation
Ce Ministre intervient dans la gestion du domaine foncier : à travers ses représentants locaux que sont les préfets et sous- préfets disposent en la matière d’une compétence propre.
À l’échelle locale, les préfets et sous-préfets jouent notamment un rôle important en matière d’attribution des terres et de délivrance des titres d’occupation foncière. Par exemple, les comités de gestion foncière rurale institués par le décret n°99-593 du 13 octobre 1999 sont créés par arrêté préfectoral et présidés par le souspréfet.
De même en ce qui concerne l’attribution des terres du domaine coutumier, c’est le préfet qui signe le certificat foncier et assure sa publication au journal officiel. Il lui revient également de transmettre au Ministre chargé de l’agriculture, les requêtes d’immatriculation à lui adresser.
C- Le Ministère chargé des eaux et forêts
Le rôle de ce Ministère consiste à veiller sur l’intégrité du domaine forestier permanent de l’Etat (forêts classées, périmètres de protection et de reboisement, parcs nationaux et réserves naturelles) et à éviter que celui-ci ne soit attribué par inadvertance ou non à des particuliers.
C’est la raison pour laquelle son intervention a toujours été nécessaire en matière d’attribution des terres pour vérifier si la parcelle de terre demandée n’est pas située dans le domaine forestier classé de l’Etat.
D- Le Ministère chargé de la construction et de l’urbanisme
L’intervention du Ministère chargé de la construction et de l’urbanisme dans la gestion du domaine rural, vise à vérifier si la parcelle de terre demandée à des fins agricoles, ne fait pas partie du domaine foncier urbain. Il s’agit de cette façon de préserver contre toute atteinte les plans directeurs ou d’urbanisme et les zones d’aménagement différé (Z.A.D).
Paragraphe 3 : L’Agence de Gestion Foncière Rurale (AFOR)
Créée par le décret n°2016-590 du 3 août 2016, l’agence de gestion Foncière Rurale est une structure d’exécution dotée de la personnalité morale qui a pour mission de mettre en œuvre la loi n°98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural et ses textes subséquents.
À ce titre, elle est chargée des tâches pratiques qui antérieurement étaient dévolues à la Direction du Foncier rural et du cadastre. Il s’agit entre autres multiples tâches :
- D’exécuter les actions de sécurisation du foncier rural, notamment par la conclusion de conventions ;
- De mobiliser les ressources pour la mise en œuvre des actions de sécurisation du domaine foncier rural ; – De conseiller les pouvoirs publics sur toutes les questions liées à la gestion du domaine foncier rural ; – De recenser et de sécuriser le patrimoine foncier rural que l’Etat ; etc.
L’AFOR comprend deux organes qui sont le Conseil de surveillance et la Direction Générale.
Le Conseil de surveillance assure la supervision des activités de l’AFOR conformément aux orientations politiques de l’Etat en matière foncière. Il est composé de 12 membres représentant les Ministères concernés, la Chambre Nationale d’Agriculture et la Chambre des Rois et Chefs traditionnels.
Quant à la Direction Générale, elle assure au quotidien l’exécution des décisions prises par le Conseil de surveillance.
La mise en place de l’AFOR est attendue dans l’espoir qu’elle pourra contribuer à sécuriser la propriété foncière en milieu rural.
Section 2 : Les structures de gestion participative du domaine foncier rural
Ces structures comprennent d’une part, les comités de gestion foncière commission foncière rurale (Paragraphe 1) et d’autre part, la commission foncière rurale (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les comités de gestion foncière rurale
A- Organisation
Le comité de gestion foncière rurale est organisé par le décret n°593 du 13 octobre 1999.
Créé dans chaque sous-préfecture par arrêté préfectoral, il est composé d’une part, des représentants des Ministères et services qui interviennent dans la gestion des ressources foncières, d’autre part des représentants des communautés rurales, des villages et des autorités coutumières, désignes pour une période de trois ans renouvelable.
L’ensemble de représentants précités, interviennent au processus décisionnel avec voix délibérative. Une autre catégorie de membres, intervient dans le fonctionnement du comité avec voix consultative.
Il s’agit des personnes concernées par l’objet des délibérations du comité, du gestionnaire du plan foncier rural lorsqu’il en existe dans la localité concernée et enfin de toute personne dont la contribution est nécessaire aux travaux du comité.
Le comité de gestion foncière rurale est présidé par le sous-préfet. Celui-ci est chargé de créer des comités villageois de gestion foncière rurale, chargés de la gestion des terroirs. Il est également chargé de transmettre au préfet les dossiers de délibération.
La décision finale revient au préfet qui dispose alors de deux semaines pour donner une suite aux avis et propositions formulés par le comité.
Le Secrétariat du comité est assuré par la direction départementale de l’Agriculture du ressort de la souspréfecture et du siège du Comité.
Si le décret précité a le mérite de fixer une répartition paritaire des acteurs étatiques et des représentants des communautés rurales au sein du comité, il faut veiller à éviter une sous-représentation des femmes et des jeunes.
Car, au regard des tenures foncières coutumière la gestion des terres est plutôt une prérogative des autorités foncières coutumières (chefs de famille, chefs de villages, chefs de lignage, etc.).
B- Attributions et fonctionnement
La création des comités de gestion foncière rurale répond aux soucis de l’Etat d’associer davantage les populations locales à la gestion des ressources foncières.
Elle est en corrélation avec le Programme National de Gestion des Terroirs (PNGTER) dont l’un des objectifs majeurs est d’accroître la participation et la responsabilisation des populations dans la gestion de leur terroir.
Certes dans la réglementation en vigueur avant la réforme avant la réforme foncière du 23 décembre 1998, ces populations en particulier les autorités foncières coutumières, n’étaient pas ignorées.
Cependant, leur rôle en pratique était plus consultatif que décisionnel et se limitait qui plus est, à l’attribution des terres.
Le décret précité portant organisation et attributions des comités de gestion foncière rurale associe non seulement les populations au processus décisionnel mais aussi, il élargit le domaine d’intervention des dites populations dans la gestion des ressources foncières.
Car à travers les comités mis en place, les représentants de ces populations interviennent obligatoirement avec voix délibératives, sous forme d’avis conforme, sur des questions telles que la validation des enquêtes officielles de constat de droits fonciers coutumiers, les conflits non résolus au cours des enquêtes foncières, les demandes de cessions de droits fonciers coutumiers, l’implantation des projets d’urbanisation ou des opérations de reboisement, etc.
Le Comité peut également être saisi pour avis simple par les autorités compétentes de toute question relative au domaine foncier rural.
Les comités constituent les organes essentiels de gestion foncière rurale ; ils sont censés être la cheville ouvrière en matière d’enquêtes foncières et de délivrance des certificats fonciers, l’objectif visé étant la sécurisation foncière. Mais Après plus d’une décennie de mise en œuvre de la réforme foncière du 23 décembre 1998, peu de comités ont été créés. La lenteur dans la mise en place des comités constitue naturellement une tentative notable au processus de sécurisation foncière.
Paragraphe 2 : La Commission foncière rurale
La commission foncière rurale est un organe intersectoriel de suivi de la situation foncière rurale ayant principalement pour missions de :
- Suivre la mise en œuvre de la loi du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural ;
- Constituer un observatoire du domaine foncier rural ;
- Proposer tout complément ou modification du cadre juridique foncier rural existant ;
- Suggérer les études nécessaires à une bonne évolution du domaine foncier rural ;
- Proposer les actions de formation, d’information, et de sensibilisation des populations et des services ruraux en matière foncière.
La Commission foncière rurale est composée des représentants des principaux acteurs du secteur agricoles, Ministères techniques, institution nationales, producteur agricoles, autorités coutumières et religieuses, centres de recherche universitaire, partenaires techniques et financiers du monde rural.
La Commission foncière rurale est dotée, d’une part, d’un secrétariat permanent assure par le Directeur du foncier rural Ministère de l’Agriculture, d’autre part, de deux groupes de travail (comité juridique et comité technique).
Malgré ses missions et sa composition qui suggère une participation effective des acteurs concernés à la gestion du domaine foncier rural, la Commission ne constitue qu’un simple organe consultatif.
Elle n’a guère l’autonomie, nécessaire pour donner une vision extérieure de la gestion du domaine foncier rural. Car le Ministère de l’Agriculture qui est charge de la gestion du domaine foncier rural joue un rôle déterminant au sein de la commission apparaissant à la fois comme juge et partie.
À ces limites s’ajoute le caractère non opérationnel de la commission. Alors qu’elle est censée se réunir au moins une fois tous les six mois, la Commission foncière rurale n’a eu qu’une seule séance de travail depuis sa création.
Le suivi de la situation foncière et la réflexion sur l’optimisation de la gestion du foncier rural qui lui sont confiés sont restés lettre morte.
CHAPITRE 4 : LE CADRE OPÉRATIONNEL DE GESTION
La structuration spatiale s’insère dans la politique globale de l’Aménagement du territoire conçue à travers les différents plans adoptés par le gouvernement ivoirien.
L’aménagement consiste en l’organisation de l’espace destinée à améliorer le cadre de vie des populations. Les plans d’aménagement qui constituent des outils de travail dans divers domaines permettent de planifier le développement projeté.
En Côte d’ivoire, les opérations d’aménagement sont définies au niveau urbain comme rural par divers plans. A partir du cas général d’intervention défini par les plans, des actions spécifiques vont être exécutées sur le terrain, ce sont les techniques de gestion (section 1). Des instruments de gestions sont également mis en place pour garantir les droits des occupants des terres (section 2).
Section 1 : Les techniques de gestion des terres
La planification des opérations d’aménagement urbain se fait à partir de plusieurs documents que sont le schéma directeur d’aménagement du territoire, les schémas directeurs régionaux d’aménagement et le plan d’urbanisme directeur.
À côté de ces documents ces qui ont un caractère général (paragraphe 1), il faut retenir les opérations d’urbanisme à travers le lotissement et la restructuration urbaine (paragraphe 2).
Paragraphe 1- Les documents d’urbanisme
Au titre de ces documents, il faut retenir : le schéma directeur d’aménagement du territoire (A) et le plan d’urbanisme directeur (B). Ce sont des documents publics qui cadrent pays l’aménagement et l’urbanisme à l’échelle d’un territoire ou d’un pays.
Ils comprennent souvent un état des lieux, une évaluation environnementale au regard du développement durable. Ces documents sont périodiquement mis à jour dans le cadre de la loi.
A- Le schéma directeur d’aménagement du territoire
Le schéma directeur d’aménagement du territoire définit des grands axes de la planification générale et fixe les choix stratégiques d’aménagement du territoire ivoirien et de développement urbain. Il prend en compte et harmonise les objectifs et programme d’aménagement de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements et services publics. Il détermine à moyen et long terme la destination générale des sols, les zones à urbaniser, les zones non constructibles, les zones à préserver et prévoir les grands travaux d’équipement et de développement urbain.
Il définit également le domaine urbain de l’Etat à soumettre à la purge des droits coutumiers en vue de la constitution de réserve foncière nécessaire extension de la ville.
L’initiative de l’élaboration du schéma directeur d’aménagement du territoire est de la compétence de l’Etat une fois voté, le schéma directeur fait partie intégrante de la loi et s’impose à tous.
Le schéma directeur d’aménagement du territoire vote est valable pour cinq ans.
Cependant, il peut être révisé dans le but d’éventuelles améliorations, et ce, dans les mêmes formes et conditions que celles prévues par son élaboration.
Après son adoption, le schéma directeur d’aménagement du territoire est décliné en autant de schémas directeurs régionaux d’aménagement qu’il existe de régions en Côte d’Ivoire.
B- Le plan d’urbanisme directeur
Le plan d’urbanisme directeur est un document qui a un rôle d’instrument de planification urbaine et de prévisions foncières.
Il apporte un cadre d’aménagement qui met un terme aux improvisations dans les villes. Il définit les grands axes de développement de l’agglomération dans un contexte aussi large que possible qui permet de prendre en considération les nécessités de l’environnement humain, économique, biologique ou naturel.
Dans ces conditions, le plan est important parce qu’il annonce et par ce qu’il prescrit, mais il l’est encore plus par ce qu’il empêchera de faire, ici ou là, pour des raisons de sauvegarde durable des espaces naturels.
Il fixe le cadre normatif de l’aménagement et du développement de l’agglomération qu’il couvre pour une période prescrite par la loi. L’Etat, les collectivités territoriales, les personnes morales et les personnes physiques sont tenus à la stricte application des prescriptions du plan lorsque celui-ci est adopté et publié.
Le plan d’urbanisme directeur peut être révisé dans les mêmes formes et conditions que celles prévues pour son élaboration.
Paragraphe 2 : Les opérations d’urbanisme
Au titre des opérations d’urbanisme couramment utilisées, il y a le lotissement (A) et la restructuration urbaine (B).
A. Le lotissement
Le lotissement est une opération de création volontaire d’un tissu parcellaire qui consiste à diviser un terrain en plusieurs parcelles destinées à la construction.
Le lotissement est le mode d’aménagement du sol en milieu urbain qui s’appuie sur un principe (1) à partir duquel les différents types de lotissements seront déclinés (2).
1. Le principe du lotissement
La réalisation de l’opération de lotissement comporte deux étapes qui sont d’une part, l’élaboration du plan de lotissement, d’autre part, la procédure de lotissement sur le terrain ou mise en application du plan.
Le plan de lotissement est le résultat d’une recherche ou étude intégrant les contraintes les plus diverses. L’analyse de ces contraintes fait appel à plusieurs données qui ont trait notamment à la vocation de la zone, aux données générales de l’insertion dans la ville, à la densité de la population aux contraintes réglementaires, aux données géographiques et hydrogéologiques etc…
A la suite de cette étude, il faut procéder à l’établissement proprement dite du plan dont les principales étapes sont :
1°) Esquisses d’ilots,
2°) Détermination de la situation des bassins-versants et les principes de l’assainissement naturel,
3°) Détermination des zones pouvant recevoir certains éléments du programme en fonction des caractéristiques du relief,
4°) Tracés possibles des infrastructures principales (voirie, assainissement, alimentation en eau, électricité, téléphone),
5°) Esquisse du lotissement,
6°) Mise au net et découpage parcellaire. En même temps que le dessin définitif du plan, sera précisé, il faut établir le canevas de la réglementation (cahier de charges).
Après l’élaboration du plan, il faut passer à la mise en application. Il s’agit d’une procédure qui comporte plusieurs étapes.
Première étape : il faut procéder à la reconnaissance du site en identifiant les types d’occupation et la nature des droits des occupants de même que l’aptitude et la vocation du site à être urbanisé compte tenu de ses caractéristiques techniques ;
Deuxième étape : à la diligence du Préfet et en collaboration avec la Direction Régionale de l’Urbanisme territorialement compétente, il faut élaborer un avant-projet accompagné d’une notice économique et technique ;
Troisième étape : visa de l’avant-projet de lotissement par le Ministre chargé de l’Urbanisme ou son représentant habilité par lui à cette fin ;
Quatrième étape : enquête consultation et avis à travers des enquêtes de commodo et incommodo de même que la soumission de l’avant-projet à l’avis du Conseil municipal au cas où le lotissement doit être fait sur le territoire d’une commune.
Dans ce cas, les procédures sont conduites par une commission présidée par le Maire.
Cinquième étape : approbation du Ministre chargé de l’Urbanisme à travers un arrêté autorisant le lotissement et ordonnant aux services du domaine urbain d’immatriculer au nom de l’Etat le périmètre à lotir et préparer les actes de concession. Les règles de base du lotissement servent de boussole pour les différents types de lotissement.
2- Les types de lotissement
Conformément, à la réglementation en vigueur il existe plusieurs types de lotissement en zone urbaine notamment le lotissement administratif et le lotissement privé.
Le lotissement administratif est réglementé par l’arrêté du 9 juillet 1936 portant aliénation des terrains domaniaux.
Il est initié soit par le Sous-Préfet (lotissement public de l’Etat), soit par le Maire (lotissement communal).
Le lotissement communal est également régi par la loi n°2003-208 du 7 juillet 2003 portant répartition et transfert de compétences de l’Etat aux collectivités territoriales et le Décret n°2005-261 du 21 juillet 2005 fixant les modalités d’application de cette loi en matière d’urbanisation et d’habitat.
Les Communes disposent d’appréciables pouvoirs en matière de lotissement. Toutefois, l’exercice de la Commune de ces compétences domaniales et d’aménagement foncier n’est possible qu’autant, elle y est autorisée par l’Etat. Sous cette réserve la Commune peut acquérir des sols, les immatriculer à son nom puis les lotir et les concéder.
La demande de lotissement administratif est adressée au Ministre chargé de l’urbanisme et le dossier est instruit par la Direction l’Urbanisme. Une mission de reconnaissance du site est effectuée par les services techniques qui dressent un avant-projet si le dossier de la demande n’en comportait pas déjà. L’avant-projet de lotissement est alors retourné au Préfet pour une enquête publique.
Ce mode d’aménagement toujours en pratique sur l’ensemble du territoire tend à disparaître au niveau d’Abidjan où l’ensemble des travaux de lotissement est dévolu à des sociétés privées.
Quant au lotissement prive, est régi par le décret 70-294 du 13 mai 1970 relatif aux lotissements privés. Le lotissement privé est initié par des personnes physiques ou morales qui procèdent à des morcellements et à la vente de parcelles selon les règles en vigueur et sous le contrôle du Ministère de la contraction.
Les lots peuvent avoir plusieurs destinations, soit d’habitation, de jardins ou d’établissements industriels ou commerciaux.
Le lotissement privé est subordonné à une autorisation délivrée par le Ministère de la construction.
Lorsque le lotissement a été approuvé, le lotisseur doit informer l’administration des dates d’ouverture du chantier et d’achèvement des travaux.
Le Directeur Régional de l’urbanisme procède au contrôle des travaux avec l’aide des services de la mairie ou de la Sous- préfecture.
B- La restructuration urbaine
Elle est régie par l’ordonnance n°77-615 du 24 août 1997 relative aux opérations de restructuration urbaine. La décision de restructuration est prise en Conseil des ministres sur proposition du Ministre chargé de l’Urbanisme. Le District a l’initiative et la réalisation de ces plans de restriction urbaine après avis consultatif des villes et communes qui le composent et de la Région dont il relève.
La restructuration urbaine vise la modernisation et l’équipement de secteur ou quartiers existants. Le plan restructuration qui est approuvé comprend un dossier foncier, un dossier opérationnel et un dossier financier.
Le dossier foncier fait l’état des droits existants du nouveau plan de lotissement, de l’état futur des droits, du programme de relogement et de réinstallation des personnes et activités devant être éventuellement déplacées. Le dossier dresse également la liste des propriétés et parcelles dont l’expropriation et la reprise sont déclarées d’utilité publique. L’enquête publique préalable à l’approbation du plan de restructuration vaut enquête de commodo et incommodo.
Le décret d’approbation vaut approbation arrêté de cessibilité. Le décret portant plan de restructuration contient la déclaration d’utilité publique des travaux et opérations de classement, déclassement, affectation, redressement, acquisition, reprise, expropriation, alignement et lotissement arrêtés par ce plan.
Quant au dossier opérationnel, il dresse le programme et l’échéancier des travaux et des tâches. Il fixe le mode de réalisation de l’opération et désigne le maître d’œuvre.
Enfin, le dossier financier détermine le budget prévisionnel de l’opération, le montant de la contribution des propriétaires privés et des occupants, la nature et les conditions des contributions publiques ainsi que l’échelonnement des versements.
Section 2 : Les instruments de gestion
Les principaux instruments de gestion sont le livre foncier (paragraphe 1) et le cadastre (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le livre foncier
Après avoir été introduit en Côte d’ivoire par le décret du 20 Juillet 1900, le livre foncier sera véritablement institué par le décret du 26 juillet 1932. Le livre foncier est le document sur lequel s’inscrit de façon irréversible la propriété foncière de même que les inscriptions qui peuvent la transformer ou la limiter (vente, donation, héritage, saisie, hypothèque, etc.).
C’est donc un registre fondamental qui assure la publicité, la constatation et la conservation des droits réels immobiliers.
Chaque immeuble à l’immatriculation fait l’objet d’une feuille ouverte dans le livre foncier.
L’ensemble des mentions ainsi consignées sur une feuille constitue le titre foncier lequel est définitif, inattaquable et imprescriptible.
Chaque feuille est divisée en cinq sections destinées chacune à recevoir des mentions spécifiques faisant l’objet de bordereaux analytiques inscrits sur le livre foncier suivant un numéro d’ordre, avec précision de la date d’inscription.
Ces mentions portent essentiellement sur :
- Les caractéristiques de l’immeuble (nature, consistance, situation, état de mise en valeur, limites, etc.) (Section 1) ;
- Les modifications relatives à la superficie et à la consistance de l’immeuble (section 2) ;
- Les modifications ayant affecté l’exercice du droit de la propriété notamment en ce qui concerne l’inscription des droits réels (charges, servitudes, etc.) (section 3) ; – Les mutations consécutives à la cession de l’immeuble (section 4) ; – Les privilèges et hypothèques qui grèvent l’immeuble (section 5).
À chaque titre foncier correspond dans les archives de la conservation, un dossier comprenant : les pièces de la procédure d’immatriculation, le plan définitif de l’immeuble, la série des bordereaux analytiques successivement établis et les actes et pièces analysés.
Outre le livre foncier et les dossiers qui les accompagnent, la réglementation en vigueur prévoit d’autres registres destines soit à la vérification de la suite de la procédure d’immatriculation, soit à la constatation des demandes d’inscription sur les livres fonciers, soit enfin à la communication des informations aux usagers.
Évolution
Du point de vue de sa présentation matérielle, le livre foncier est un registre souvent volumineux et épais. Cette présentation s’explique par le fait que l’histoire de chaque immeuble immatriculé est retracée dans le livre foncier. Instrument de constatation, de conservation et de suivi des droits réels immobiliers, le livre foncier n’est pas seulement utile pour l’Administration.
Tout contribuable moyennant le paiement de droits de recherche et de copie, peut aussi obtenir communication des renseignements consignés dans le livre foncier (état des droits réels appartenant à une personne, état des charges et droits réels grevant un immeuble, etc.)
Au plan institutionnel, le livre foncier est tenu et mis à jour par les services de la conservation foncière. En France par contre, dans les régions de l’Alsace et de la Moselle notamment, le service du livre foncier est assuré au sein des tribunaux d’instance et dépend du Ministère de la Justice.
Dans tous les cas, pour améliorer le fonctionnement des services de la conservation foncière et faciliter l’accès des usagers aux informations du titre foncier, la tendance actuelle est à l’informatisation de certaines données du livre foncier.
C’est dans cette optique que par ordonnance du 24 mars 2015, le Conseil des Ministres électronique. Cette option vise à accompagner le dynamisme des transactions immobilières en sécurisant au mieux les données du livre foncier et en améliorant l’accès aux informations qu’il contient.
Le livre foncier électronique réalise au moyen des nouvelles technologies de l’information et de la communication une centralisation des données relatives aux opérations d’immatriculation et de publicité des droits réels effectuées par l’ensemble des conservations foncières du territoire national. Il s’agit de cette façon de contribuer à l’amélioration l’environnement des affaires en Côte d’ivoire, dans l’intérêt de l’Administration et du contribuable.
Paragraphe 2 : Le cadastre
La définition, les missions et l’évolution du cadastre méritent d’être examinées (A), de même que sa nature juridique (B). Il convient également de faire le rapprochement entre le cadastre et le plan foncier (C).
A- Définition, missions et évolution du Cadastre
Que recouvre la notion de cadastre (1) ? Et quelle est son évolution (2) ?
1- Définition et missions
Le cadastre peut être défini comme un ensemble de documents officiels donnant des informations sur les propriétés bâties et non bâties et sur l’identité de leurs propriétaires. Au sens large, c’est un inventaire de la propriété foncière dont il donne une description plus ou moins détaillée en vue de répondre aux besoins individuels et collectifs de la société.
Cet inventaire se fait généralement par l’établissement d’une documentation graphique (plans cadastraux) et d’une documentation littérale contenue dans un registre. La mise en relation des données graphiques et littérales se fait à travers l’utilisation d’un numéro d’identification qui permet de passer de l’information graphique à l’information littérale.
Au sens strict, le cadastre affecte la forme d’un démembrement foncier établi par l’Etat.
Ce démembrement s’articule sur trois principales opérations concomitantes qui sont :
- L’opération d’arpentage et de levée destinée à lever les plans parcellaires ;
- L’opération d’assiette fiscale qui permet de déterminer l’impôt foncier ;
- L’opération juridique qui a pour finalité de préciser le statut des terres de même que les droits et obligations des propriétaires ou occupants.
La création du service du cadastre remonte à l’époque coloniale avec la création en 1903 du service topographique rattaché à la Direction des travaux publics. Mais au lendemain de l’indépendance, un service du cadastre sera créé par arrêté du 20 avril 1962.
Aujourd’hui, les missions du cadastre se présentement principalement comme suit :
- Mission technique : réalisation, production, gestion et maintenance de l’infrastructure et de la cartographie cadastrale ;
- Mission foncière et juridique : description des immeubles et détermination de leurs limites et superficies assistance au conservateur de la propriété foncière dans la procédure de création des titres fonciers ; – Mission fiscale détermination de l’impôt foncier à partir des déclarations souscrites par les contribuables ; – Mission documentaire, collecte et mise à disposition des données aux utilisateurs.
Il résulte des missions ci-dessus que la documentation graphique du cadastre comporte trois éléments :
- Le plan de titre foncier qui fait partie de l’annexe du livre foncier sur les caractéristiques de l’immeuble et dont le caractère définitif dépend de l’accomplissement des formalités de bornage réalisées en présence du géomètre assermenté du service de la conservation foncière ;
- Le plan cadastral foncier ou tableau d’assemblage qui a pour objectif d’identifier les terrains qui font l’objet de titres fonciers résultant de l’immatriculation ;
- Le plan cadastral fiscal qui recense toutes les parcelles imposées et définit l’assiette de l’impôt foncier.
Au, plan socio-économique, le cadastre présente de nombreux avantages ; il permet :
- Une meilleure connaissance des limites foncières ; ce qui facilite le règlement des conflits fonciers, les études de planification et de développement et l’inventaire du domaine de l’Etat, des collectivités et des particuliers ;
- La sécurisation des transactions foncières en créant une présomption de propriété laissée à l’appréciation des tribunaux ;
- La mise en place d’une fiscalité foncière efficace ;
- La fiabilité des investissements, notamment en milieu rural où les droits fonciers coutumiers sont souvent sujets à conflits ;
- La mise en place d’une politique efficiente, d’affectation et d’exploitation des terres.
2- Évolution du cadastre
L’histoire du cadastre remonte à la civilisation Gréco- romaine et s’articule depuis toujours sur la volonté des gouvernants de prélever sur les terres des particuliers les ressources financières nécessaires au fonctionnement de l’Etat ou des collectivités territoriales ou de façon générale au développement socio-économique du pays.
Cette volonté de prélèvement est à l’origine de l’impôt foncier. Mais bien évidemment, l’imposition suppose que chaque portion de terres soit localisée, identifiée et validée. Or, cette tâche n’est pas toujours aisée pour des raisons techniques, juridiques ou financières.
En Côte d’Ivoire, l’adoption du système de l’immatriculation depuis l’époque coloniale, constituait déjà un pas vers l’identification et la capitalisation des terres.
Mais le caractère facultatif de l’immatriculation n’a guère favorisé la mise en place d’un cadastre général.
En effet, au regard de la réglementation coloniale en vigueur, cadastre était considéré comme le résultat l’immatriculation de proche en proche jusqu’à l’immatriculation de toutes les parcelles d’un secteur donné. Il en résulte le caractère progressif du cadastre, car les opérations de détermination et de confection des plans sont faites au fur et à mesure de mesure des immatriculations volontaires des particuliers.
Consciente de cet obstacle, l’Administration coloniale a pris le décret du 20 mai 1955, lequel a permis de procéder à l’immatriculation obligatoire de toutes les parcelles situées dans les périmètres urbains à cadastrer ayant fait l’objet d’urbanisme.
Ainsi, a été réalisé de 1964 à 1967 le cadastre complet de la ville d’Abidjan.
Si en milieu urbain, notamment à Abidjan, le cadastre a connu une application, il n’en est pas de même en milieu rural. Il faut dire que contrairement au milieu urbain ou du fait de la forte pression foncière, le coût du cadastrage est facilement amorti par l’Etat, en milieu rural, il en va autrement.
Pour remédier à cette situation, le Ministère de l’Agriculture a créé dès 2002 un service du cadastre rural rattaché à la Direction du foncier rural. Ce service est notamment chargé de la délimitation des terroirs villageois laquelle constitue une étape vers la stabilisation des droits coutumiers et le cadastrage des terres en liaison avec, les services compétents du Ministère de l’Économie et des Finances.
A ce niveau, au regard de l’immensité des terres rurales et du coût des opérations de délimitation, un effort financier important est attendu de l’Etat s’il veut procéder à un cadastre général des terres rurales.
B- Nature juridique du cadastre
Les opérations de cadastrage donnent lieu à la confection de plusieurs documents.
Ces documents peuvent être consultés par les contribuables qui peuvent en obtenir des extraits leur permettant de s’informer sur leur situation foncière ou fiscale. D’où l’intérêt de s’interroger sur la nature juridique des documents cadastraux.
En d’autres termes, les documents cadastraux peuvent-ils par exemple, être utilisés par les contribuables pour apporter la preuve de leurs prérogatives foncières ?
À cette question, il convient de répondre par la négative. En effet, les documents cadastraux sont des documents purement administratifs qui décrivent des situations de propriété apparentes ; ils ne peuvent en aucun cas constituer une preuve ou même une présomption de propriété.
En conséquence, ils ne peuvent être utilement produits en cas de contestation du droit de propriété lequel ne peut être établi que par le titre foncier.
Il résulte de ce qui précède que le plan cadastral foncier ou tableau d’assemblage n’a aucune valeur juridique. Il en est de même du plan cadastral fiscal dont le caractère non contradictoire exclut toute opposabilité aux tiers qui peuvent d’ailleurs le contester dans le cadre d’un recours administratif.
En revanche, en ce qu’ils sont considérés comme faisant partie intégrante des données du livre foncier, les plans de titre foncier sont opposables au tiers dès lors que les limites qu’ils indiquent ont été reconnues et approuvées en présence du géomètre assermenté du Cadastre, après une procédure contradictoire de bornage.
S’il est admis que les documents cadastraux ne peuvent établir la propriété, ils peuvent cependant fournir un commencement de preuve de la propriété et des droits réels y relatifs.
C- Cadastre et plan foncier rural
En vue de collecter des données fiables sur l’occupation des terres en milieu rural, l’Etat a initié depuis 1988, le Plan foncier rural. Le Plan foncier rural est une opération qui consiste en une vaste enquête foncière menée en zone rurale sur la base de photos aériennes, complétées par des enquêtes au sol.
Il vise notamment à faciliter le règlement des conflits fonciers, à constituer une base pour l’aménagement et la gestion des terroirs villageois et à faciliter l’accès au crédit.
Après une phase pilote (1990-1996) suivie successivement d’une phase de consolidation (1996-1997) et d’une phase d’extension (1997-1999), le plan foncier rural a couvert au total neuf zones.
A la fin du projet en 2002, 1 117 000 hectares ont été délimités, 44 201 parcelles ont été élevées, 708 villages ont été couverts pour une superficie numérisée s’élevant à 638 550 hectares.
Au plan qualitatif, le plan foncier rural a permis :
- La mise au point d’un outil technique fiable et peu coûteux de levée de parcelles et de recensement des droits, base sur la cartographie ;
- La production de données foncières et agricoles ;
- La création de compétences techniques locales en levée de parcelles et de numérisation des données.
Après 2002, le plan foncier rural est devenu une composante du programme national de gestion des terroirs et de l’équipement rural (PNGTER), programme visant à rationaliser l’utilisation des ressources foncières par l’association et la responsabilisation des communautés rurales dans la gestion de leur terroir.
Ce programme sera suivi du programme national de sécurisation foncière rurale (PNSFR) à travers lequel est mise en œuvre la réforme du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural.
A la différence du cadastre qui porte sur des parcelles aux délimitations plus précises et sur lesquelles s’exercent des droits de propriété, le Plan foncier rural a pour objectif d’établir une cartographie du territoire national.
Cette cartographie précise les limites foncières à l’intérieur de chaque terrain villageois et recense pour chaque parcelle identifiée, l’ensemble des droits qui s’y exercent et les déterminations de ces droits.
De ce point de vue, le plan foncier rural apparaît comme un dispositif technique embryonnaire du cadastre. En effet, la documentation graphique du Plan foncier rural comprend deux éléments essentiels qui sont d’une part, le plan parcellaire et d’autre part, le plan du terroir.
Or, à l’analyse, le plan parcellaire s’apparente au plan de titre foncier du cadastre ; tandis que le plan du terroir se rapproche du plan cadastral foncier ou tableau d’assemblage.
Faut-il en déduire que les documents du plan foncier rural ont la même valeur-juridique que ceux du cadastre ? Une telle déduction ne semble guère possible, car les documents cartographiques du plan foncier rural sont réalisés sans les éléments essentiels du cadastre que sont le bornage, la présence d’un géomètre assermenté et le dossier technique de chaque plan de parcelle.
EXERCICES D’APPLICATION QUESTIONNAIRES
- Quelle est la composition du domaine foncier rural ?
- Définissez les terres vacantes et sans maître ; les terres concédées.
- Pourquoi dit-on que le foncier rural est une catégorie résiduelle ?
- Définissez la théorie du domaine éminent
- Pourquoi certains composants sont à titre permanent ?
- Pourquoi certains composants sont à titre transitoire ?
- Qu’est-ce que le domaine foncier coutumier ?
- Quels sont les types de droits coutumiers ?
- Définitions et caractéristiques du certificat foncier.
- Intérêt du certificat foncier.
- Risque pesant sur le certificat foncier.
- Expliquez la vitalité de la tenue coutumière
- Quels sont les attributions de l’AFOR ?
- Quelle est la composition et l’attribution des comités villageois de gestion foncière ?
- Quels sont les différentes étapes de la procédure de la constatation de l’existence de droits coutumiers ?
- Quels sont les différentes étapes de la procédure d’établissement du certificat foncier de droits coutumiers?
- Quels, sont les différentes étapes de la procédure d’immatriculation ?
- Quels sont les attributions du service de la conservation de la propriété foncière et des hypothèques ?
- Quels sont les attributions du service du cadastre ?
- Quels sont les modèles de contrat qui existent dans le domaine foncier rural ?
- Les lettres d’attribution et les arrêtés de concession provisoire sont des actes créateurs de droits ?
- Qu’est-ce que l’immatriculation ?
- A quel moment commence la procédure d’immatriculation ?
- Quels sont les effets de l’immatriculation foncière ?
- Qui peut requérir à l’immatriculation foncière ?
- Qu’est-ce que le bornage ?
- Quel est le délai pour faire une opposition foncière ?
- Qui peut établir un titre foncier ?
- Que faire en cas de perte du titre foncier ?
- Dans quel procédé est requise l’immatriculation préalable à l’adjudication ?
- Que faire lorsque l’immatriculation est posteriori à l’adjudication ?
- Comment se fait la naissance des droits fonciers traditionnels ?
- Quelle différence fait-on entre chef de terre, chef de village et chef de famille au sujet de la prise de contact de la terre ?
- Quelle est la nature juridique des droit portant sur la terre ?
- Quelles différence faite ton entre espace domestique, lieux de culte et espace villageois ?
- Quels sont les caractères du droit foncier ?
- Que faut-il entendre par théorie du domaine éminent ?
- Comment accède ton à la terre rurale ?
- Que faut-il entendre par droit de propriété ?
- Comment se fait l’appropriation des terre rurales ?
- Qu’est-ce qu’une propriété foncière certifiée ?
- Analyse la nature de la propriété foncière costumière
- Quelles sont les limites de la reconnaissance de la propriété foncière coutumière ?
- Quelle est la portée de la reconnaissance de propriété foncière coutumière ?
- Distinction entre droit foncier rural et droit foncier urbain
- Quelles sont les modes d’appropriation des terrains urbains par l’Etat ?
- Quelles sont les modes d’appropriation des terrains urbains par les particuliers ?
- Comment se fait l’attribution des terrains dits villageois dans les agglomérations ?
- Qu’est-ce le bail emphytéotique ?
- Quelles sont les caractéristiques du bail emphytéotique ?
- Qu’est-ce que le canon emphytéotique ?
- Comment se fait la composition du domaine foncier rural ?
- Quels sont les procédés de location des terre rurales ?
- Qu’est-ce que le certificat foncier ?
- Qu’est-ce la mise en valeur des terres ?
- Qu’elle est la portée de la mise en valeur des terres ?
- Quels sont les critères de mise en valeur des terres ?
- Comment se fait la mise en valeur des terres concédées à titre provisoire ?
- Comment se fait la mise en valeur des terres du domaine coutumier ?
- Comment constat on les droits d’usages de la terre depuis la loi du 23 décembre 1998 ?
- Qu’est-ce que la fiscalité foncière urbaine ?
- Qu’est-ce qu’une taxe foncière ?
- Comment se fait la transmission des terres rurales ?
- Qu’est-ce que la cession des terres à titre gratuit ?
- Qu’est-ce que le marché foncier ?
- Quel est le rôle du notaire dans la procédure de cession des terres objet de titre foncier ?
- Qu’est-ce qu’une cession forcée des terres ?
- Que faut-il entendre par procédure d’expropriation de terre ?
- Comment se fait la succession des terres individualisées et collectives ?
- Comment se fait la gestion des terres foncière ?
- Que faut-il entendre par terre du domaine foncier rural permanent ?
- A qui appartient les terres du domaine foncier rural permanent ?
- Qu’est-ce qu’une terre retirée ou exproprie ?
- Qu’est-ce qu’une terre sans maitre ?
- Qu’est-ce qu’une terre vacante ?
- Qu’est-ce qu’une terre d’intérêt local ?
- Qu’est-ce qu’une terre acquise ?
- Que faut-il entendre par terre du domaine foncier transitoire ? Que faut-il entendre par terre du domaine foncier coutumier ?
- Que faut-il entendre par terre du domaine foncier concédé ?
- Le mode d’attribution des terres rurales selon la loi du 23 décembre 1998.
- Qu’est-ce que le permis d’occuper.
- Qu’est-ce les concessions provisoires des terres ?
- Qu’est-ce qu’une contractualisation foncière ?
Ex : 12 – h ou 15 d, g
- Qui a dit ?
« Affirmer que la brousse africaine n’appartient à personne est contraire à toute la tradition. Le coin le plus reculé de la brousse est toujours sous la juridiction d’un chef quelconque ».
- Elias Olowale
- NENE BI Séraphin
- Albert LEY,
- Qui a dit ?
« L’ordre juridique colonial s’analyse comme un ensemble de procédés juridiques de spoliation des terres coutumières en vue de leur distribution aux colons et surtout aux grandes compagnies » a. René Degni Segui
- Félix Houphouët Boigny
- De Gaule
- Le certificat foncier qui rappelle singulièrement un certificat administratif expérimenté sous l’ère coloniale ne concerne que :
- Les terres du domaine rural coutumier
- Les terres du domaine urbain
- Les terres du domaine rural et urbain
- Qui a dit ?
« L’essence du droit à la terre est fondée sur an contrat religieux passé entre le premier occupant et les puissances chtoniennes des lieux. Ce contrat n’autorise l’utilisation du sol que pour assurer la vie et la postérité du groupe. Il s’établit entre le premier occupant et le lieu où il s’installe un lien qui n’est pas un droit de propriété « mais de médiation biologique » a. J-P RAISON
- NENE Bi Séraphin
- Albert LEY
- Le domaine foncier rural se définit comme l’ensemble des terres mises en valeur ou non et quelle que soit la nature de la mise en valeur.
- Aux termes de l’article 1er de la loi n°98-750 du 23 décembre 1998 portant réforme foncière
- Aux termes de l’article 1er de la loi n°98-751 du 23 décembre 1998 portant réforme foncière
- Aux termes de l’article 1er de la loi n°98-752 du 23 décembre 1999 portant réforme foncière
- La terre est inaliénable
- Elle ne peut faire l’objet d’appropriations
- Elle est partagée à tout le monde de la même manière
- Elle est la propriété du patriarche
Répondre par vrai ou faux Ex : 20 vrai / 20 faux
- Le caractère collectif des droits fonciers ne s’oppose pas à ce que des droits individuels puissent s’exercer sur les terres.
- Les droits des individus portant sur la terre sont un droit d’exploitation, un droit d’usage. Ce droit d’usage est lié à une communauté de résidence.
- L’étranger qui arrive dans un village, se voyait attribuer un lopin de terre pour exploitation, après un stage probatoire du domaine privé.
- Le patrimoine de l’Etat est composé de deux domaine. Le domaine public et le domaine prive.
- Le bail emphytéotique est un droit irréel immobilier conféré par un contrat de longue durée (18 à 99 ans) conclu entre un particulier qui jouit de l’usage du sol et l’Etat qui en reste propriétaire.
- La cession des terres rurales de l’Etat au profit des collectivités territoriales est autorisée par arrêté pris en Conseil des Ministres soit à l’initiative de l’Etat, soit à la requête de collectivité territoriale concernée.
- La propriété d’une terre du Domaine Foncier Rural est établie à partir de l’immatriculation de cette terre au Registre Foncier ouvert à cet effet par l’Administration et en ce qui concerne les terres du domaine coutumier par le livre Foncier.
- L’Etat peut obliger un particulier à lui céder moyennant une juste et préalable indemnité, c’est la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique.
- La propriété d’une terre du Domaine foncier rurale se vend par achat, succession, donation entre vifs ou testamentaire ou par l’effet d’une obligation.
- Le Certificat Foncier peut être cédé, en tout ou en partie, par acte authentifié par l’autorité administrative, à un tiers ou, lorsqu’il est collectif, à un membre de la collectivité.
COMMENTAIRE DE TEXTE
- « Le certificat est un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir ». Commentez
- « Cette propriété foncière établie par le certificat foncier est transitoire et peut être collective. Elle est établie après le constat de l’exercice de droit coutumier paisibles et continues et est accessible à tous car elle peut être cédée sans autre considération de forme physique ou de nationalité. Il n’en est pas pour la propriété définitive établie uniquement par le biais de l’immatriculation au livre foncier »
Extrait AKA ALINE LAMARCHE, Crise foncière et pluralité juridique en Côte d’Ivoire ; communication présentée lors du colloque « Crise et Pluralisme juridique » à l’université de Bordeaux le 19 novembre 2018
DISSERTATION
Sujet : La propriété foncière dans le domaine foncier rural.
Sujet : le foncier et le sang
Sujet : « Si ce n’est pas toujours le cas dans d’autres disciplines, en foncier rural, la coutume est intra legem » commenter
Sujet : La certification foncière.
Sujet : la contractualisation foncière
Sujet : Les innovations de la loi n°98-750 du 23 décembre 1998 Sujet : Les comités sous préfectoraux de gestion foncière rurale.
Sujet : la terre divise le sang et supprime la parenté
Sujet : la sécurisation du domaine foncier rural
Sujet : Les fonds de terre à la colonie de Côte d’Ivoire
Sujet : L’irrévocabilité du titre de propriété foncière en Côte d’Ivoire
Exercice : Faire ressortir le problème de Droit contenu dans cet extrait d’arrêt et traitez -le
« Considérant que, par arrêté n°63/P-GBM/CAB du 12 novembre 2009, le Préfet du département de GrandBassam a dissout le Comité Villageois de Gestion du Foncier rural (CVGFR ) du village de Modeste crée par décision n°14/SP-GBM du 23 janvier 2009 du Sous-préfet de Grand-Bassam en application de la loi n°98-750 du 23 décembre 1998 et du décret n°99-593 du 13 octobre 1999 relatifs au domaine foncier rural aux motifs que le Village de Modeste, du fait de sa situation dans le territoire de la Commune de Grand-Bassam, est mis à double égard , hors du champ d’application de la loi n°98-750 relatif au domaine foncier rural qui en exclut, d’une part, tous les territoires relevant du domaine urbain et d’autre part, tous ceux compris dans la zone au d’aménagement différée au pourtour de l’agglomération d’Abidjan » .
EXTRAIT CHAMBRE ADMINISTRATIVE de la COUR SUPREME, Comité villageois de gestion foncière rurale (CVGFR) de MODESTE C/ PREFET DE GRAND-BASSAM, Audience publique ordinaire du 19 décembre 2012.
CAS PRATIQUE
La société NAL AGRO INDUSTRIE, société de droit privé spécialisée dans la transformation du cacao souhaite acquérir un terrain. Ce terrain est situé dans le village de Brihi dans la sous-préfecture de Ouragahio. Il servira à implanter une usine de transformation de cacao.
Pour éviter tout conflit, la société souhaite s’assurer que ses interlocuteurs du village de Brihi sont les véritables propriétaires de la terre qu’elle sollicite.
Indiquez à la société NAL AGRO INDUSTRIE une éventuelle autre voie pour avoir accès à cette terre.
[1] Guy-Adjété KOUASSIGAN, L’homme et la terre. Droits fonciers coutumiers et droit de propriété en Afrique occidentale, l’homme d’outre-mer collection publiée par l’Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-mer, nouvelle série n°8, o.r.s.t.o.m.
éditions berger-levratilt, 5, rue Auguste-Comte paris (Vle)1966
[2] Mame Aly KONTE, principales sources des conflits en Afrique, aps, 8 mars, 2006
[3] le Rapport nrc, conflit foncier et sécurité alimentaire dans la région frontalière entre le Libéria et la Côte d’Ivoire, oct. 2012, extrait de « famille et terre en Côte d’Ivoire : cas des baoulé », thèse en histoire du droit et des institutions, (L) KOUADIO, soutenue publiquement le 13 septembre 2017
[4] Collectif tany, les défis à relever dans les nouvelles lois sur les investissements, quotidien Madagate affiche, 16 juin 2014. A ce titre il demande l’abrogation de la loi la loi 2007-036 qui autorise l’achat de terrains par les sociétés à capitaux majoritairement étrangers.
Il appelle à une vigilance accrue pour dénoncer les manœuvres et projets des autorités qui pourraient profiter de cette période pour mener des transactions risquant de léser les droits des paysans et familles malgaches actuels et des générations futures.
[5] David N. Houedeingar, l’accès à la terre en Afrique Subsaharienne in « l’accès à la terre et ses usages », rencontres Lascaux 8 & 9
Juin 2009
[6] Ce caractère sacré est particulièrement marqué en Afrique Subsaharienne. La quasi-totalité des auteurs ayant rédigé des articles ou des ouvrages relatifs au foncier y font référence.
[7] Richard ERPICUM, Discours d’accueil du Colloque Scientifique de N’Djaména sur La question foncière au Tchad, 28 juin-1er juillet 2004 in Actes du Colloque, CEFOD-OFT, Septembre 2004, p.10 « La question foncière est devenue centrale au Mali, entraînant de nombreux conflits depuis la fin des années. Ces conflits pour l’accès à la terre qui font couler du sang chaque année sont alimentés par le manque de clarté de la réglementation en matière foncière. » Cf. Jessica NARDONE, Femmes et accès à la terre au Mali,
01/2008
[8] Jérôme TUBIANA, « darfour, un conflit pour la terre ? », In Politique Africaine, N° 101, Mars-Avril 2006, pp 111-131
Selon cet auteur, « Au Darfour, le déplacement de deux millions de civils non arabes ne résulte pas seulement de la répression gouvernementale contre la rébellion. Les groupes arabes parmi lesquels le gouvernement a recruté ses supplétifs avaient été peu dotés en terres par les sultans du Darfour à l’époque précoloniale et ils profitent de la guerre pour remettre en cause cette situation. Ils souhaitent la mise en place d’un droit « moderne » et, sous la pression des groupes rebelles, le gouvernement s’est engagé à restaurer le système traditionnel ».
[9] Selon les archives de documents de la FAO, Gestion de la fertilité des sols pour la sécurité alimentaire en Afrique, l’une des voies vers la sécurité alimentaire est d’assurer que les moyens économiques pour se procurer de la nourriture existent, et que cette nourriture puisse être achetée à un prix abordable. Une importante condition préalable est l’accès à la terre, vu que les personnes en plus grand nombre doivent produire leur nourriture et vivre de la terre. Les systèmes traditionnels de gestion des sols demandent une disponibilité suffisante de terre permettant d’assurer de longues périodes de jachère destinées à maintenir la fertilité du sol. Quand il n’y a plus de nouvelles terres à cultiver, la terre en jachère doit être remise en culture et la fertilité du sol chute.
[10] Chauveau, Jean-Pierre; Colin, Jean-Philippe; Jacob, Jean-Pierre; Lavigne Delville, Philippe ; Le Meur, Pierre-Yves, Modes d’accès à la terre, marchés fonciers, gouvernance et politiques foncières en Afrique de l’Ouest résultats du projet de recherche Claims, Londres, IIED, 2006.
[11] Propos du sous-préfet de Touleupleu lors d’un entretien donné en juin 2014 ; En effet dans cette partie de la Côte d’Ivoire, il n’est pas rare de constater que des accords sont signés entre acteurs sur la question du foncier en vue de favoriser la cohésion sociale. 12Philippe Lavigne Deville, quelles politiques foncières pour l’Afrique rurale ? Réconcilier pratiques, légitimité et légalité, khartala, coopération France 1998.
[12] MATHIEU P « le foncier et la gestion des ressources naturelles », in LAURENT P.J… Louvain-la-neuve, Paris, 1996, pp 46- 59 14Dans le lignage, l’ancêtre commun des vivants n’est disant que de quelques générations (cinq ou six, rarement une dizaine) ; il s’agit d’un homme (ou d’une femme) qui, pendant sa vie, manifesta des qualités remarquables et dont on est fier d’être un « fils » ou une « fille »
[13] Jacqueline Wurtz, Évolution des structures foncières entre 1900 et 1968 à Ambohiboanjo (Madagascar), Études rurales, 1970, volume 37, Numéro 37-39, pp. 449-479
[14] Encyclopédie juridique de l’Afrique, Droit des biens, sous la direction de Guy Adiété Kouassigan, T5 ; Enjeux fonciers en Afrique Noire. Ouvrage collectif, orstom-Karthala, 1983 ; Le Droit de la terre en Afrique au Sud du Sahara, Ouvrage collectif, GP Maisonneuve et larose, 1975, 175.p ; FAO, La Réforme du droit de la terre dans certains pays d’Afrique francophone, Rome, 1987, 108.p ; Les Nouvelles Editions Africaines, 1982, 493 p.
[15] Pierre-Claver KOBO, Spécificités des régimes fonciers Africains, Penant, N° 803, Juillet-Septembre 1990, p. 218.
[16] Ordonnance N 012 du 06 Février 1974 fixant le régime foncier et domanial (au Togo) et ses textes d’application.
[17] Res communis (chose commune, au pluriel « res communes », chose communes) est une expression latine utilisée en jus publicum
(droit public) qui désigne une chose ou un bien commun, c’est-à-dire de par sa nature « ne peut être appropriée. Elle appartient à tout le monde, à tous les citoyens et est de ce fait accessible et utilisable par tous.
Les Romains ont cité comme exemples de res communes la mer, l’océan, l’atmosphère, l’espace aérien ou encore les sanctuaires ou les bains publics. Au contraire, l’eau ou l’air, capables d’être séparés de la mer, de l’océan, de l’atmosphère ou de l’espace aérien, et pouvant faire l’objet d’appropriation à des fins d’usage ou de consommation privés, constituent la res nullius, susceptible de possession et d’appropriation à titre individuel ou même collectif. La res nullius (la chose de personne) désigne en effet les choses sans maître, c’est-à-dire celles qui n’ont pas de propriétaire mais qui sont néanmoins appropriables, tandis que les res communis sont indisponibles, nul ne pouvant priver autrui de leur usage. Le res communis du droit romain se rapprocherait, selon certains auteurs, de la notion d’héritage ou de patrimoine commun de l’humanité – ce point est contesté, certains auteurs romains préférant parler de res universitatis à ce sujet, tandis que la notion de citoyenneté, davantage que d’humanité, est utilisée. Le domaine public en droit civil français (article 714 du Code civil) désigne l’ensemble des choses ne pouvant faire l’objet de droit de propriété et qui sont donc déclarées «res communis ». Les autorités peuvent cependant règlementer l’usage de ces biens par des pouvoirs de police. 20Lexiques du foncier en Afrique noire
[18] On aura compris, le rapport de l’homme à la terre en droit traditionnel négro-africain est plus fort, plus profond que le rapport de l’homme à la terre dans l’ancien droit coutumier romain et dans le droit ancien germanique. Pour ces derniers en effet, « le bien essentiel, celui qui ne pouvait appartenir qu’aux hommes libres, qui conférait la puissance économique et politique, qui est la source de la richesse et de la souveraineté qui traduisait une union presque mystique entre l’homme et la nature, c’était la terre, parce qu’elle était destinée aux descendants et devait être conservée dans la famille. C’était un bien impérissable, au caractère prononcé et on ne pouvait en disposer qu’à des conditions très strictes ; en outre, elle était pratiquement insaisissable » (Philippe MALAURIE et Laurent AYNES, Les biens, 2ème édition, Paris, Dalloz, 2005, p. 26)
[19] VERDIER (R.), « Civilisations paysannes et traditions » in VERDIER (R.) et ROCHEGUDE (A.). Systèmes fonciers à la ville et au village, Paris, L’Harmattan, 1986, p 21.
[20] KOUADIO kouassi Louis, « la famille et la terre en Côte d’Ivoire : cas des baoulé thèse unique de doctorat, soutenue publiquement en 2017
[21] Ici transparaît le caractère économique de la terre.
[22] A. LEY : le régime domanial et foncier et le développement économique de la Côte d’Ivoire p.282 et 283 27supra P :
[23] Ces terres sont immatriculées directement au nom des détenteurs de certificat fonciers : voir décret n°99-594 du 13 octobre 1999 fixant les modalités d’application au domaine foncier rural coutumier de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998.
[24] Voir décret n° 99-595 du 13 octobre 1999 fixant la procédure de consolidation des droits des concessionnaires provisoires de terres du domaine foncier rural.
[25] Ces terres sont gérées librement par l’Administration qui peut les louer ou les vendre, dans les conditions prévues par la réglementation foncière (article 21 de la loi n°98-750 du 23 décembre 1998).
[26] Aux termes de la loi n°034-2012/AN portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso, l’Etat dispose d’un délai de 10 ans pour immatriculer ses terres.
[27] Bien qu’elle ait été adoptée à l’unanimité moins une abstention, cette loi n’a jamais été promulguée par le Président de la République A.LEY op.cit p 28.
[28] Yao N’dré Paul : décentralisation et développement rural en Côte d’Ivoire ; Hyacinthe Sarassoro : le droit foncier ivoirien entre la tradition et le modernisme, EDC n°3/ 1989, PP 9 et 77.
[29] Le législateur malien n’a pas jugé nécessaire de suivre cette évolution. Dans ce pays, les terres non immatriculées détenues en vertu des droits coutumiers exercés collectivement et individuellement font partie du domaine privé de l’Etat (V. loi n°86-91/AN/RM du 12 juillet 1986).
- c) Les terres expropriées ou retirées
[30] -Articles 202 à 204 de la loi n°2003-489 du 26 décembre 2003 précitée.
[31] -Articles 203 de la loi n°2003-489 du 26 décembre précitée.
[32] Voir supra
[33] Source : Ministère de l’Agriculture, Direction du Foncier rural, 31 octobre 2013. 46A. LEY, op.cit p 281 et s.
[34] -Aux termes de l’article 1 de cette loi, seuls l’Etat, les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes sont admis à être propriétaires des terres du domaine foncier rural. Les personnes physiques ou morales ne faisant pas partie de cette énumération peuvent néanmoins bénéficier d’un certificat foncier.
[35] Ce décret abroge le décret du 23 octobre 1904 qui s’inspirant des articles 539 et 713 du code civil disposait que les terres vacantes et sans maître appartiennent à l’Etat.
[36] « Affirmer que la brousse africaine n’appartient à personne est contraire à toute la tradition. Le coin le plus reculé de la brousse est toujours sous la juridiction d’un chef quelconque » : Elias Olowale ; la nature du droit coutumier africain.
[37] L’ordre juridique colonial s’analyse comme un ensemble de procédés juridiques de spoliation des terres coutumières en vue de leur distribution aux colons et surtout aux grandes compagnies : René Degni Segui le diagnostic du droit foncier rural, Etudes et Documents du CIREJ n° 1 avril 1987 p 95 ; voir dans ce sens H.Sarassoro ; Droit foncier ivoirien, occupants et propriétaires coutumiers ; Etudes et documents du CIREJ n° 1 avril 1987 p 125.
[38] René Degni-Segui, op.cit
[39] Il convient de relever que le législateur ivoirien a fait l’économie du concept « terres vacantes » ; ce qui suggère que même les terres mises en valeur peuvent dans les conditions de délais prévus par la loi, être considérées comme des terres « sans maître ». En d’autres termes, l’absence de vacance ou l’exploitation d’une terre ne sont guère synonymes de maîtrise foncière.
[40] Supra.p
[41] Terres objet de conflits interminables et irrésolus 10 ans après la promulgation de la loi n°2013-655 du 13 septembre précitée, de même que les terres concédées n’ayant pas été mises en valeur dans le délai de cinq ans imparti.
[42] Sur la gestion des terres du domaine privé de l’Etat, voir supra. P
[43] L’immatriculation constitue le fondement de la propriété foncière en Côte d’Ivoire. Il en résulte que l’appropriation d’une terre sur la base des dispositions du code civil ne suffit pas pour conférer la propriété telle que résultant du régime foncier.
[44] -Article 3 de la loi n°98-750 du 23 décembre 1998
[45] -Le certificat foncier qui consacre la propriété foncière coutumière peut être cédé en présence de l’Administration compétente (article 20 du décret 99-594 du 13 octobre 1999 fixant les modalités d’application au domaine foncier rural coutumier de la loi n°98750 du 23 décembre 1998).
[46] -Nonobstant la loi du 23 décembre 1998, des transactions foncières coutumières continuent d’être effectuées sans que le cédant ne soit détenteur d’un certificat foncier.
[47] -Cour d’Appel de Daloa, Arrêt n 59/12/ du 1r février 2012, Cour d’Appel de Daloa, Arrêt N°36/12 du 25 janvier 2012 et Cour d’Appel de Daloa, Arrêt n°110/12 du 14 mars 2012.
[48] -voir infra p.
[49] -Voir article 24 du décret n° 99-594 du 13 octobre 1999 fixant les modalités d’application au domaine foncier coutumier de la loi n°98-750 du 23 décembre 1998.
[50] -Infra p.
[51] Intra P.
[52] Article 22 du décret du 26 juillet 1932 portant organisation du régime foncier.
[53] Par application de l’article 1733 du Code civil, le locataire « répond de l’incendie (qui survient dans les lieux qu’il occupe), à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par un cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ».